Un mariage princier à Amboise
Le 13 avril 1519, une petite fille est née sous le signe de la mort. Sa mère, Madeleine de la Tour d’Auvergne meurt en effet le 28 avril et son père qu’elle ne connaîtra pas, car il est malade et alité, va mourir le 4 mai 1519[i].
Le pape Léon X, avait pourtant fondé de sérieux espoirs sur son neveu, petit-fils de Laurent le Magnifique, dont il espérait qu’il serait souverain de fait sinon en titre, de Florence. Il a ainsi demandé à son ambassadeur en France, Vettori (voir sur ce Blog L’ombre de César Borgia sur le prince de Machiavel), de trouver une princesse française pour son neveu. Car le pape a besoin de l’alliance avec François 1er pour stabiliser le pouvoir des Médicis sur Florence.

Laurent II de Medicis Duc d-Urbin (Raffaello Sanzio ou Santi) Lorenzo de’ Medici, 1518 Huile sur toile (97 x 79 cm) Crédit Photo © Christie’s Images Ltd. 2007 Coll Privée
Du côté français, les Médicis ne font pas forte impression, car ils sont envisagés comme une famille de parvenus. Déjà, Louise de Savoie, la mère du roi, a eu le plus grand mal à vaincre les réticences de son demi-frère, le duc de Savoie pour faire épouser Philiberte, la sœur cadette du duc, à Julien de Médicis, le frère cadet du pape, trois ans plus tôt. Il faut donc la double pression du roi et de la reine-mère, qui souhaitent renforcer les liens avec le pape, afin d’obtenir l’investiture du roi de france sur Naples, pour identifier une jeune princesse, Madeleine de la Tour d’Auvergne, d’illustre lignée.

Madeleine de la Tour d’Auvergne Jean Perreal Galerie des Offices
Madeleine est en effet issue de la tige cadette des comtes d’Auvergne et de Boulogne, illustrée par le conquérant de Jérusalem, Godefroy de Bouillon. Sa sœur, Jeanne a épousé son propre cousin germain, le duc d’Albany, John Stuart, régent d’Ecosse, qui passera au service de François 1er à partir de 1524. Les deux sœurs sont orphelines et très riches. Car la famille des comtes d’Auvergne possède les baronnies de La Tour et de La Chaise, en Auvergne, plusieurs seigneuries en Limousin et en Berry et les comtés de Lauraguais et de Castres, soit un revenu annuel de 120 000 livres.
Pour titrer son neveu, le pape n’a pas hésité à spolier François Marie della Rovere, duc d’Urbin et de Sora, en confiant à Jean de Médicis « des Bandes noires »[ii], son neveu par alliance, la conquête du duché d’Urbin, qui fait partie des domaines de l’Eglise (voir sur ce Blog l’article sur le dernier condottiere Jean de Medicis des Bandes noires).

Sebastiano del Piombo Portrait d’un homme en armure Peut-être Jean de Medicis des Bandes Noires Wadsworth Atheneum museum of art Connecticut
Le 26 septembre 1517, Laurent de Médicis reçoit une lettre de la Cour lui proposant ce riche parti, proposition à laquelle il répond favorablement, dès le 6 octobre.
Le roi a décidé de déployer les grands moyens pour fêter dignement les épousailles à Amboise, entre la jeune héritière de seize ans et le duc d’Urbin, de vingt-six ans. Le roi qui vient de donner à Laurent de Médicis une compagnie de gens d’armes et le collier de chevalier de l’Ordre de Saint-Michel, a demandé au duc d’être le parrain du dauphin, lors des cérémonies du baptême, le 25 avril 1518.
Les noces, brillamment célébrées vont durer dix jours, à partir du 28 avril. A cette occasion, le duc d’Urbin a distribué à la Cour, les cadeaux du pape, pour 300 000 ducats et notamment les tableaux de Rafaello Sanzio de la Sainte Famille, pour la reine Claude et de Saint Michel terrassant le dragon, pour le roi[iii].
A partir du lendemain, et sur dix jours, vont se dérouler des tournois parmi les plus beaux que la France ait connus. Le duc d’Urbin y prend part, malgré une blessure à la tête, incomplètement guérie, reçue d’une arquebusade, lors de la conquête d’Urbin, près d’un an plus tôt. Il s’y montre à son honneur. Le clou du spectacle est la prise d’assaut d’un fortin construit en bois et défendu par des canons de bois, cerclés de fer, envoyant des boulets en cuir, pouvant désarçonner des cavaliers, sans faire trop de mal.

Roi René d’Anjou Livre des tournois Combat des tournoyeurs Français 2695, fol. 100v-101, BNF Visualiseur Mandragore
Le duc d’Alençon est dans la forteresse, défendue par cent hommes d’armes, que le connétable de Bourbon attaque avec cent cavaliers et le duc de Vendôme, avec cent hommes d’arme. Fleuranges, qui constate que Alençon commence à plier, se porte à son secours avec quatre cents hommes d’armes. Paraît alors le roi, François 1er, armé de pied en cap, de sa cuirasse, qui prend la tête des troupes de Fleuranges pour effectuer des sorties contre les assiégeants. Les coups donnés et rendus ne sont pas feints. Le spectacle va laisser de nombreux morts sur le champ de bataille, remporté par le roi.
Orpheline à l’âge d’un mois et élevée par sa tante Clarice
Après un voyage en Bretagne, où il a accompagné le roi, le duc d’Urbin rejoint son épouse à Amboise, d’où il part, le 25 juin pour visiter leurs fiefs en France où a lieu le partage des biens entre Anne d’Albany et sa sœur, Madeleine, avant de regagner Florence, via Chambery et Bologne, où ils font leur entrée solennelle le 7 septembre 1518. Dès le mois d’août, l’annonce d’une grossesse a été donnée par le pape, qui craignait fort que la maladie de la syphilis dont souffre de façon chronique le duc d’Urbin, ne l’empêche de procréer. D’ailleurs, dès la mi-novembre 1518, le duc, victime d’un affaiblissement général, a dû s’aliter à la villa des Médicis, sur la colline de Montughi. Puis, il s’est fait ramener à Florence, pour assister à l’accouchement de son épouse, qui, à onze heures du matin, le 13 avril 1519, a donné naissance à une petite fille « belle et grassouillette » selon les propres termes du pape Léon X, dénommée Catherine, l’un des prénoms de sa mère, Marie car Catherine est baptisée un samedi 16 avril, jour de la vierge et Romola parce que c’était une habitude de Florence (d’après Romulus le légendaire fondateur de Fiesole, le berceau de Florence).
Le bébé est tenu sur les fonts baptismaux par le prieur de Saint-Laurent, et les abbesses des couvents des Murates et d’Annalena (voir sur ce Blog l’article sur le dernier condottiere, Jean de Medicis des bandes noires, qui donne la raison pour laquelle le couvent d’Annalena était bien vu des Médicis).
Dès que le cardinal Jules a appris la mort du duc d’Urbin, il est immédiatement venu à Florence, pour pallier la vacance du pouvoir et en qualité de tuteur de la petite Catherine. Le cardinal se souvient des motifs qui ont provoqué l’exil de Pierre II de Médicis en 1494. Il a donc à cœur, dès son arrivée, d’établir un strict respect des libertés républicaines qui va susciter chez les Florentins de très hautes aspirations, qui seront déçues lors de l’accession au trône du futur pontife.
Très malade au mois d’août 1519, Catherine a été conduite à Rome en octobre, par sa grand-mère, Alphonsina Orsini et par le cardinal Jules de Médicis, futur pape Clément VII, le fils illégitime de Laurent de Médicis, frère cadet de Laurent le Magnifique. Le cardinal Jules est le cousin germain du pape Léon X et le cousin au quatrième degré de Catherine.
François 1er, qui souhaite avoir un otage pour obliger Léon X à tenir ses promesses, a réclamé la tutelle du bébé. Mais le pape a déclaré vouloir la marier à son petit cousin Ippolito, fils bâtard de Julien de Médicis, son neveu, ce qui lui permet d’avoir les mains libres sur le plan diplomatique. D’ailleurs, les Français se font chasser de Milan en novembre 1521 et la mort du duc d’Urbin a largement réduit l’intérêt présenté par l’alliance avec la France.
La mort de sa grand-mère, Aphonsina Orsini, est peu regrettée à Florence. On lui reproche l’influence pernicieuse qu’elle a eue sur son fils Laurent. En outre, la fille de Robert Orsini, comte de Tagliacozzo et d’Albe, dans les Abruzzes, a le plus grand mépris pour les mœurs bourgeoises de Florence. Lors des années de gêne et d’errance, qui ont suivi l’expulsion de Florence de sa famille, elle a accepté d’en rabattre sur ses exigences et donner à sa fille Clarice, pour époux, le banquier du pape, Philippe Strozzi, membre de l’une des plus anciennes familles, rivales des Médicis, à Florence. Ce mariage va créer à Philippe Strozzi toutes sortes de difficultés à Florence, pendant l’épisode de la dictature de Soderini, jusqu’en 1513.
Clarisse Orsini, la tante de Catherine, c’est l’homme de la famille car Clarisse a hérité de la violence du tempérament de sa mère, d’un orgueil élevé et d’une volonté de fer. Elle n’a pas peur de dire tout haut ce qu’elle pense et, autant elle est proche des membres légitimes des Médicis, autant elle a de mépris pour les bâtards et autres pièces rapportées, dont son cousin le cardinal Jules et les deux bâtards, Ippolito et Alexandre.
Catherine est élevée par sa tante, Clarisse, qui vit à Rome, dont les enfants les plus jeunes sont un peu plus âgés que Catherine. Sa tante, Anne, comtesse d’Auvergne et duchesse d’Albany, va venir à Rome, sans doute un peu plus tard, quand son époux, John Stuart, régent d’Ecosse, en exil, entrera au service de François 1er en 1524.
A Rome, Catherine voit fréquemment ses cousins, les bâtards Médicis, le bel Ippolito, de huit ans plus âgé qu’elle, et celui qui a été déclaré son demi-frère, Alexandre de Médicis, en réalité un fils bâtard du cardinal Jules de Médicis, un mulâtre, que ce dernier a eu d’une esclave africaine, en 1510. Les deux princes nés à un an d’intervalle, sont destinés à gouverner Florence mais Alexandre, d’une intelligence à peine moyenne, sera légitimé par Clément VII, ce qui n’est pas le cas du beau et spirituel Ippolito, qui allie à la noblesse de son apparence, une intelligence aigüe.
En 1521, Adrien VI d’Utrecht est élu pape. Le cardinal Jules de Médicis rentre à Florence. Il va gouverner la ville comme aux plus beaux jours de Cosme. Quelques citoyens parlent hardiment de réformes. On discute des divers moyens d’assurer un gouvernement libre à Florence. Plusieurs citoyens proposent des plans de gouvernement. Le plus ouvert à ces discussions est Jules de Médicis, qui lit tous les rapports, formule des avis, des critiques, toujours bienvenus.
Mais bientôt, Jules de Médicis est dépassé par le mouvement qu’il ne sait plus comment arrêter. Il en a l’occasion avec la conspiration des Buondelmonte. Des lettres sont surprises faisant état d’une conjuration, destinée à éliminer le cardinal de Médicis pour rétablir la liberté à Florence. Zanobi Buondemonte et Luigi Alamanni sont les chefs du complot. Avertis à temps, ils s’échappent. Mais la conjuration découverte, ceux qui n’ont pas eu le temps de s’enfuir sont arrêtés et exécutés. Cet épisode permet à Jules de Médicis de rétablir son autorité jusqu’à 1523.
Pendant quatre ans, Florence va être gérée, de 1523 à 1527, par le cardinal Silvio Passerini de Cortona, un homme à la vue courte, peu imaginatif, ambitieux, entêté et d’une raideur pointilleuse. Aux dires de François Vettori, l’ambassadeur de Florence à Rome, l’un des fidèles parmi les fidèles des Médicis, avec Guichardin, c’était un homme incapable de gouverner. Ce mauvais choix du pontife va exercer les conséquences les plus funestes.
Catherine confiée au cardinal de Cortona
En 1525, Catherine a six ans. Le pape expédie alors à Florence ses deux petits-cousins, Alexandre et Ippolito, accompagnés de Catherine. Clément VII a toujours eu beaucoup d’affection pour sa petite cousine dont il s’occupe régulièrement des intérêts. Il utilise pour ce faire, les services des ambassadeurs de Florence, en France, qui sont chargés de réclamer les arrérages des versements des revenus de son douaire.
La grogne monte à Florence contre les Médicis, rendus responsables du mauvais gouvernement du cardinal de Cortona. Quand le pape fait alliance avec la France dans le cadre de la ligue de Cognac (voir les articles de ce Blog sur Philibert de Chalon, prince d’Orange – Contre François 1er et Ce jour-là, le 6 mai 1527, le sac de Rome), l’empereur Charles Quint envoie une armée, conduite par Charles III de Bourbon, l’ex connétable, laquelle s’approche de Florence. Mais Bourbon ne veut pas faire le siège de Florence : il n’a pas le temps et ne dispose pas de l’artillerie nécessaire. Il choisit donc de foncer sur Rome.
Histoire d’une révolution républicaine
A Florence, le parti des Médicis est affaibli depuis le départ du cardinal à Rome. Les Strozzi, les Capponi, les Salviati, de même que les Vettori appellent de leurs vœux le retour à la république. Au moment où Bourbon est entré en Toscane, les troupes de la ligue de Cognac, sous le commandement du duc d’Urbin, Francesco-Maria della Rovere, sont près de Florence.
Alexandre de Medicis et les deux cardinaux sont montés, à cheval, le 26 avril 1527, pour rencontrer le duc d’Urbin, qui est entré à Florence avec 1 500 hommes. Au palais de la Seigneurie, tous les partisans de la république se sont réunis pour débattre. Tout-à-coup, le bruit court que les Médicis, Ippolito et Alexandre, ont quitté Florence. Aussitôt, c’est l’ébullition : la foule force la Seigneurie à déclarer les Médicis rebelles. Mais le duc d’Urbin et les Médicis arrivent.
Est-ce l’affrontement ? Guichardin parvient à l’éviter par la négociation. Le duc d’Urbin, avec ses 1 500 hommes n’est pas certain de l’emporter. Un accord est donc trouvé pour laisser sortir les Florentins du palais, sans être punis.
Pendant ce temps, Rome s’est enfermée dans ses remparts du haut desquels on scrute anxieusement le lointain dans l’attente de l’arrivée de l’armée impériale de Bourbon. Philippe Strozzi, le banquier du pape, a été désigné otage, dans le cadre d’un accord conclu avec le vice-roi de Naples Charles de Lannoy. Mais Clarice, son épouse, s’est tellement fait entendre auprès du Saint-Père, que ce dernier a fourni les pécunes nécessaires à son retour à Rome à la fin avril 1527. Ce n’est pas sans crainte que les époux Strozzi attendent, impuissants, l’arrivée des troupes impériales. Ils ont un pressant besoin de revoir Florence. Ils décident de s’échapper de Rome, dont le pontife leur a fermé les portes, sous prétexte d’une partie de campagne. Avec le secours du condottiere Orsini, Renzo da Ceri, ils partent de Rome avec deux de leurs fils et parviennent à Ostie, d’où un brigantin les amène à Pise. Ils apprennent dans cette ville, le sac épouvantable de Rome. De tous côtés, on les appelle, notamment de Florence d’où l’on veut chasser les Médicis.
Philippe Strozzi est dans l’indécision, ne sachant quel parti prendre. Sa femme Clarice, prend les décisions pour deux. Elle arrive le 15 mai dans sa magnifique villa « delle Selve » près de Signa et, le soir même, elle est à Florence.
Le lendemain, elle se fait porter en litière à la maison des Médicis, à Florence, construite par Michelozzo Michelozzi à l’entrée de la via Larga, la plus grande avenue de Florence (voir l’article de ce Blog sur l’architecte de la première renaissance florentine) où elle retrouve plusieurs Médicis, parents et amis, et notamment Ottaviano, qui va assurer pendant tout le siège de Florence, la garde vigilante des biens des Médicis et qui en sera si vilainement remercié, vingt ans plus tard[iv].
L’archevêque Ridolfi, Alexandre et Ippolito ont accouru, à l’annonce de l’arrivée de Clarice, la terrible virago, fille de Pierre II de Médicis et petite-fille de Laurent le Magnifique. Ils la conduisent dans un appartement voisin de la chapelle.
Le cardinal Passerini l’attend. Il se lève à son arrivée et elle l’admoneste durement en lui attribuant directement la responsabilité de l’état d’insurrection qu’elle a remarqué en arrivant à Florence. Elle lui rappelle que les premiers Médicis n’ont gouverné qu’avec l’accord des Institutions républicaines, alors que lui, par ses actions, à éludé ces mêmes libertés jusqu’à provoquer directement la révolte populaire. Il n’est plus temps de tergiverser : pour la sauvegarde des deux princes Médicis, Ippolito et Alexandre doivent partir s’ils ne veulent pas être arrêtés.
On dîne alors au palais Médicis et, dans l’après-midi, elle réitère ses recommandations aux deux princes âgés respectivement de seize et dix-sept ans. Mais ses paroles ne doivent pas être du goût des cardinaux du pape, qui lui font clairement sentir qu’elle n’est plus la bienvenue dans ce palais. C’est également le sentiment d’Ippolito qui accuse Clarice d’avoir pris le parti de ses ennemis. Se plaignant d’être chassée de sa propre maison, Clarice sort par une porte dérobée du palais, pour se rendre à la maison de Jean Ginori, où plus de soixante citoyens sont venus l’attendre. Mais à peine arrivée, voici Ottaviano qui arrive pour supplier Clarice de revenir au palais Médicis où sa présence seule, est en mesure de calmer la foule qui veut forcer les portes.
Le matin suivant, Philippe Strozzi entre à son tour à Florence. A travers les rues remplies de citoyens en armes, où des batteries ont été dressées, il se rend chez lui où il trouve à l’attendre énormément de monde, comptant sur lui pour orienter l’émeute dans le sens de la modération. Mais Philippe Strozzi est un indécis. Il ne sait pas quel parti prendre. Il ne prend pas parti, laissant les évènements se dérouler. Justement, Niccolo Caponi vient le trouver, le lendemain, pour se rendre chez le cardinal de Cortona. Capponi démontre au cardinal qu’il ne tient déjà plus le pouvoir dans Florence : il doit remettre son autorité et livrer les forteresses dont il a la garde pour que le conflit se résolve pacifiquement.
Le 17 mai 1527, les cardinaux Cortona et Cibo, les magnifiques[v] Alexandre et Ippolito, capitulent et sortent de Florence, et prennent la route de Pise, ville vassale de Florence, accompagnés de Philippe Strozzi, chargé de se faire remettre les forteresses. Le pape Clément VII, indigné, fera au cardinal, à Rome, le plus mauvais accueil, de sorte que le cardinal de Cortona en mourra de chagrin, l’année suivante. Catherine de Médicis, âgée de neuf ans, est restée à Florence.
Un coup d’Etat aristocratique
Toutefois, le cardinal de Cortona, dès le début de l’insurrection, a fait conduire Catherine à la villa de Poggio à Caiano, à vingt km au nord-ouest de Florence.
A Florence, c’est un cri de liberté unanime[vi] : la population est d’une gaieté folle. Pour l’heure, il s’agit de réformer le gouvernement et les institutions de la ville. Le Grand Conseil, une institution supprimée par les Médicis, est rétabli : il se compose de deux mille cinq cents membres. Il nomme immédiatement « les dix de guerre », les « huit de balia » et enfin le « conseil des quatre-vingts ». Une assemblée décide d’un gonfalonier élu pour un an, reconductible deux fois[vii].
Pour conduire Florence, l’opinion désigne d’avance Capponi, qui est l’âme de l’insurrection, comme gonfalonier. C’est un homme ambitieux, mais modéré, qui a conscience que le rétablissement de la république, à Florence, modifie le rapport de forces international et va nécessiter des solutions d’ajustement par rapport aux deux grandes puissances en conflit permanent : la France et l’empire de Charles Quint. Capponi a pour lui tout le parti des Médicis et l’aristocratie de Florence : on nomme son parti, les « ostinati ». Contre lui, il a le parti populaire, conduit par le vieux Baldassare Carducci, un homme violent, inquiet de la modération de Capponi, partisan d’une rupture brutale et définitive avec les Médicis et qui excite le peuple à tous les partis extrêmes. Et puis, il y a aussi la « faction de Saint-Marc » qui ressuscite les vieilles idées de Savonarole, qui incline du côté du parti populaire. La jeunesse, elle, est partagée entre partisans et opposants à Capponi.
Capponi est élu pour treize mois par le Grand Conseil. Le gouvernement de la Seigneurie, nommé par les Médicis, donne alors sa démission. Pour l’instant, la nomination de Capponi rassure tous les modérés de la ville. Mais le peuple murmure et s’agite, ses chefs laissent échapper des paroles violentes. Il faut craindre que tôt ou tard des difficultés surviennent.
Pour sa défense, Florence décide de recruter les « bandes noires » de Jean de Médicis, mort deux ans plus tôt, au nombre de trois mille hommes, aguerris et surentraînés : une force de combat.
Hugo de Moncade, le vice-roi de Naples, demande à Florence son alliance, ou au moins sa neutralité. Capponi y incline. Mais il est mis en minorité. En masse, Florence vote pour le parti de la France. La république adhère alors à la ligue de Cognac qui lui réclame quatre mille hommes d’infanterie et quatre cents chevaux payés. Pour recruter une milice, on rétablit la conscription inaugurée par Machiavel, lors de la dictature de Soderini, une invention d’une modernité stupéfiante.
A tour de rôle de façon à ne pas interrompre les travaux des champs, dix mille agriculteurs sont entraînés au maniement des armes blanches et des arquebuses et à tenir l’ordre militaire.
Dès le début de l’insurrection, le parti aristocratique au pouvoir a compris que la petite Catherine pourrait être un otage de choix qu’il faut surveiller de près, pour éviter qu’un coup de main ne vienne l’enlever. Bernardo di Jacopo Rinuccini, un citoyen de grand renom, a donc été expédié à la tête d’une escouade solidement armée, pour se faire remettre l’enfant, qui est ramenée à Florence, où elle est confiée aux religieuses Dominicaines de Sainte-Lucie, dans la via San Gallo, au nord de la ville.
Bien que créé sous les auspices des Médicis, le couvent de Sainte-Lucie avait été très perméable aux idées de Savonarole, comme le couvent de Saint-Marc : les Médicis n’y étaient donc pas les bienvenus, raison pour laquelle, dès que la question de la garde de la princesse se pose, ce couvent est retenu. On compte sur les motivations politiques des religieuses pour assurer une garde étroite autour de la petite fille, considérée dès lors comme une prisonnière.
Mais Clarice Strozzi, profitant de son nom, se fait remettre l’enfant, avec laquelle elle vient s’installer dans le palais de son père, le palais Médicis, où continue de résider Ottaviano, pour assurer la garde du palais et de ses richesses. Ces allers retours de la princesse ne conviennent pas au peuple qui commence à estimer que les Strozzi les trompent. Aussi, lorsque l’on apprend que les princes Médicis, sont partis de Pise, pour aller à Lucques, ville indépendante de Florence, sans remettre les forteresses occupées par les garnisons Médicis, la colère populaire se tourne vers les Strozzi qui se sont laissés manœuvrer ou qui ont joué double jeu. La population en armes se rue sur le palais Médicis duquel Clarice et Catherine sont dans l’obligation de partir, de toute urgence, pour se réfugier au couvent Sainte-Lucie.
Le gouvernement de Florence commence à connaître ses premières difficultés lors de l’expédition du maréchal Lautrec, venu reconquérir Naples. Ce dernier prend garde à éviter Rome occupée depuis neuf mois par les lansquenets allemands (voir sur ce Blog les deux articles sur Philibert de Chalon – Contre François 1er et le siège de Florence), ce qui laisse le temps au prince d’Orange, nommé généralissime des armées impériales en Italie, de se replier sur Naples avec ses troupes. En passant par Florence, Lautrec réclame les hommes promis par Florence dans le cadre de la ligue de Cognac.
Les partisans de la France, plutôt du parti populaire, souhaitent l’élimination physique de tous les Médicis et la rupture totale. Le gouvernement de Capponi flotte. Pour tenter de rétablir sa majorité, lors de sa réélection, un an plus tard, il essaie de détacher du parti populaire, la « faction de Saint-Marc » en prenant des postures et des accents « savonaroliens », ce qui lui assure le soutien de ce parti. Il est réélu.
La jeunesse réclame des armes. Capponi, habilement, lui en fait distribuer, pour contrôler le mouvement. Ils sont trois mille « jeunes » de seize à trente-six ans, à s’enrôler dans ces milices urbaines, réparties dans les quatre quartiers de la ville, qui réhabilitent alors les étendards des seize gonfaloniers du peuple, qui avaient été supprimés par les Médicis.
La défaite et la mort de Lautrec par la peste, qui défait l’armée française devant Naples, le changement d’obédience de l’amiral Doria, à Gênes, qui a reconquis l’indépendance de la République sur les Français, constituent des signes avant-coureurs d’une victoire impériale, auxquels le parti populaire ne prête aucune attention. Doria propose aux Florentins de revenir dans l’alliance impériale : le moment est propice car l’empereur cherche un accommodement avec le pape. Ce serait pour Florence la meilleure façon de garantir son indépendance. Capponi est partisan de cette solution. Mais Florence s’entête à choisir le parti de la France, restant seule en Italie dans le camp de la guerre contre l’empire de Charles Quint.
La chute de Capponi : le parti populaire
Pour le malheur de Capponi, qui entretient des relations épistolaires avec le pape, via son vieil ami Jacques Salviati, à Rome, une lettre de ce dernier, tombe à terre, aussitôt ramassée par un membre du parti opposé, lequel va la faire lire dans les boutiques de l’Art de la banque. Toute la ville est indignée : Capponi est accusé de trahison, son gouvernement tombe. Il est emprisonné.
Déféré le 19 avril 1529 devant une commission d’enquête, Capponi se défend avec éloquence et un grand savoir politique : les juges le reconnaissent innocent. Il est libéré et peut revenir chez lui.
Capponi est remplacé à la tête de l’Etat par le plus intransigeant de ses opposants, François Carducci, du parti populaire.
Celui qui est le plus heureux de la chute de Capponi, c’est Clément VII : car le pape connaît bien l’habileté manœuvrière et politique de Niccolo Capponi, qui, seule, pouvait empêcher le retour des Médicis. L’arrivée au pouvoir du parti violent et la rupture définitive avec le pape, va permettre, grâce aux propositions de paix généreuses et inespérées de Charles Quint, apportées par le prince d’Orange, de rétablir à terme le pouvoir des Médicis. Le pape sait qu’il peut à nouveau rallier l’important parti des Médicis à Florence, maintenant qu’il est privé de chef. Car les aristocrates ne sont désormais plus les bienvenus à Florence, gouverné par le peuple. Effrayés par un gouvernement qui échappe de plus en plus au Gonfalonier pour tomber dans le cri de la rue, le parti des Médicis vient bientôt se jeter aux pieds du pape.
Le peuple lui, commence à s’enivrer d’héroïsme et de liberté. Il a porté au pouvoir un homme sans grande valeur personnelle, poussé par l’ambition, mais anobli par la ferveur du peuple. N’est-ce pas du pape Boniface VIII, ce mot à propos des Florentins ? «Les Florentins sont un cinquième élément. Qui veut détruire l’Univers, doit d’abord en ôter les florentins ».
Or, Charles Quint vient de signer à Barcelone, le 29 juin 1529, le traité de réconciliation avec le pape Clément VII, qui prévoit le rétablissement des Médicis à Florence et, le 7 juillet 1529, la paix des Dames, entre Marguerite d’Autriche et Louise de Savoie, a organisé la fin de l’état de guerre entre la France et l’empire, une trêve qui va durer six ans. Puis, Philibert de Chalon, prince d’Orange est venu, le 25 octobre 1529, mettre le siège devant Florence (voir l’article de ce Blog sur Philibert de Chalon, le siège de Florence). Florence, abandonnée par la France, est désormais toute seule en guerre contre Charles Quint, qui vient de faire la paix avec Milan et Venise et qui a reconnu l’indépendance de la république de Gênes et de la principauté de Monaco, à l’intérieur des frontières de l’empire.
C’est un Charles Quint victorieux de la France en Italie, car la dernière armée française, celle du comte de Saint-Pol, a été écrasée une semaine avant le traité de Barcelone, qui vient se faire couronner empereur du Saint Empire romain-germanique, à Bologne, le 24 février 1530.
Le siège de Florence va être l’occasion des heures les plus héroïques de l’histoire de Florence, qui va résister pendant près de onze mois à une armée aguerrie, deux fois plus nombreuse.
Une enfant otage de la politique
Clarice Strozzi, qui s’est occupée de Catherine avec sollicitude, à son arrivée en 1527, a bientôt été obligée de se séparer de sa protégée. Puis elle est morte le 3 mai 1528. Depuis lors, Catherine est restée seule, isolée dans un monde d’adultes, ballottée entre des intérêts contradictoires où personne ne se soucie du bien être d’une enfant de dix ans. Après la mort de Clarice, Philippe Strozzi, prévoyant le destin inéluctable de la cité, est parti pour Lyon.
A peu près à l’époque où Clarice Strozzi l’a ramenée au couvent Sainte-Lucie, elle est déplacée au couvent de Sainte Catherine de Sienne. Mais ce couvent vient à être infecté par la peste qui sévit à Florence et l’ambassadeur de France, réclame, le 7 décembre 1527, de déplacer la petite fille qui est conduite au couvent de la « Santissima Annunziata delle Murate ». Le couvent des Murate était très favorable auX Médicis et les sœurs avaient déjà, trente ans auparavant, abrité les derniers jours de la comtesse de Forli, Caterina Sforza, épouse d’un Jean de Médicis, qui était venue y mourir, en reconnaissance de leur soutien pendant son emprisonnement à Rome par Cesare Borgia (voir les deux articles de ce Blog sur Caterina Sforza, l’indomptable lionne de Forli et le dernier condottiere, Jean de Médicis, des Bandes noires).
Malgré leurs propres inquiétudes, les religieuses font le meilleur accueil à la « duchessina », qui est entourée avec amour et bienveillance et qui va rester pendant la plus grande partie du siège de Florence, sous leur affectueuse vigilance. Mais le couvent des Murate, dans sa grande majorité, est favorable aux Médicis. Les religieuses vaient ainsi pour habitude d’expédier aux prisonniers politiques des paniers de fruits ou de pâtisseries au nom de l’abbesse ou de celui de la petite Catherine, avec les armes des Médicis représentées soit avec des fleurs, soit d’une autre manière. Le geôlier, en examinant ces colis, reconnaît les écussons et il porte plainte contre le couvent des Murate auprès des Seigneurs des Dix de la Liberté.
De vives discussions animent alors le Conseil. Les plus modérés déclarent que ce ne sont que des enfantillages, les plus ardents réclament des mesures sévères. Contre toute attente, la clémence prévaut à l’égard des prisonniers politiques Médicis, qui sont relâchés. Le Conseil ne devait pas être au courant des arrestations de ces prisonniers politiques et l’évocation de leur sort a probablement conduit au réexamen des raisons de leur détention. En revanche, le couvent des Murate n’est plus perçu comme sûr pour la garde de la princesse. En effet, le conseil des Dix de la liberté a été informé de tentatives du pape pour la faire évader.
Or, juste à ce moment, les « arrabiati », partisans du parti populaire déchaînent leur haine contre les Médicis en raillant le pape par des propos infâmes et en incendiant la magnifique Villa de Careggi, qui avait abrité pendant plus de quarante ans l’école néoplatonicienne de Marsile Ficin et l’Université de Florence.
Dès le début des troubles, la petite Catherine de Médicis a été l’objet de leur aversion, comme unique héritière du nom des Médicis de la branche aînée.
Un homme dépravé du parti populaire, Leonardo Bartolini, n’a-t-il pas proposé alors de placer Catherine dans une maison close, pour dégoûter le pape de la marier à des princes ou des seigneurs? D’autres ne sont-ils pas aventurés à proposer que Catherine soit exposée au feu des boulets sur les remparts ? Ces propositions ont été fort heureusement, pour l’honneur du Conseil, rejetées avec mépris et dégoût.
On décide toutefois de retirer Catherine des Murate. Un jurisconsulte habile et de noble famille, Salvestro Aldobrandini, chancelier de la Seigneurie, est chargé, avec trois commissaires de retiner Catherine des Murates pour la replacer au couvent Sainte Lucie.
Accompagné de la milice, le chancelier se présente à la porte du couvent des Murate et demande à rencontrer l’abbesse. Aussitôt, c’est la panique dans le couvent et ce n’est qu’après un certain temps que les religieuses se présentent au parloir, accompagnées de Catherine de Médicis, habillée en nonne, les cheveux coupés ras. A la demande du chancelier, Catherine répond d’une voix ferme, qu’elle entend devenir nonne et qu’elle a décidé de passer sa vie entre ces murs.
Aux protestations de Catherine, s’ajoutent celles des religieuses qui supplient l’envoyé de la république de ne pas exposer la petite à une mort certaine, puis qui se mettent à genoux, en priant Dieu de protéger la petite princesse. Cette prière est-elle entendue ? Aldobrandini n’a pas l’intention de faire violence au respectable couvent des Murate. Il préfère se retirer pour aller rendre compte de son échec à la Seigneurie.
Celle-ci adresse alors à l’abbesse l’ordre de se soumettre. Et quelques jours plus tard, le 20 juillet 1530, Aldobrandini se présente à nouveau au couvent. Catherine se laisse convaincre de partir suivie de ses gens, à dos de mules, au couvent de Sainte-Lucie, où des ordres ont été donnés pour qu’elle y soit traitée honorablement. Aldobrandini a réussi à la convaincre en lui promettant qu’avant un mois, elle reviendrait aux Murate. A l’évidence, le chancelier est informé des tractations en cours pour la reddition de la ville. Peut-être le conseil des dix ne veut-il pas prendre le risque de perdre un otage de cette importance, au moment de la négociation d’un accord de reddition ? Il est probable que si Catherine s’est laissée convaincre, c’est que l’émissaire de la Seigneurie a dû trouver les mots pour la rassurer en lui montrant que l’objectif de la république n’était pas de lui nuire personnellement, contrairement à la première idée qu’elle en avait, une idée qui n’était pas sans fondement.
La petite fille qui avait été si bien défendue par les religieuses des Murate, donnera, devenue adulte et toute puissante reine du royaume le plus riche de la Chrétienté, de nombreux signes de sa reconnaissance, près de trente ans plus tard, pour obtenir des ducs Cosme 1er et François de Toscane, la reconnaissance de privilèges pour les actes de courage des religieuses des Murate.
Par-delà les orages d’une vie lourde en évènements, la reine noire de France est toujours restée fidèle aux courageuses religieuses qui se sont pressées autour d’elle pour la défendre.
Le calvaire de la petite princesse ne devait pas durer beaucoup plus longtemps car le 12 août 1530, à peine trois semaines plus tard, est signé le traité de reddition sans condition de Florence.
Aldobrandini, qui va être condamné à mort au retour des Médicis, se verra secourir par Catherine, qui va intervenir en sa faveur, sa peine étant alors commuée en exil. Lorsqu’il part définitivement de Florence en 1530, l’éminent juriste peut-il s’imaginer que son propre fils, deviendra, en 1592, le pape Clément VIII ?
La petite princesse de onze ans, durement frappée par la vie dans un âge tendre, a su pardonner à l’émissaire, la violence faite à son encontre, par la république, soit une marque de jugement, très au-dessus de son âge. Les trois ans de détention de la petite captive ont forgé à jamais le caractère trempé de la future reine de France.
_________________________________
[i] Cet article est rédigé à partir de plusieurs sources complémentaires : « La jeunesse de Catherine de Médicis » par A. de Reumont, PLON Paris 1866. « Florence et ses vicissitudes 1215-1790 » par M.Delecluze Paris, Charles Gosselin, 1837 Vol 1 et Vol 2. « Histoire de la république de Florence » par Hortense Allart, Paris Garnier 1843 . Ivan Cloulas « Catherine de Medicis » Fayard 1979 et « Catherine de Médicis ou la reine noire« , par Jean Orieux Flammarion 1986.
[ii] Surnom qu’il ne prendra qu’à la mort de Leon X. Jean de Médicis, issu de la branche cadette des Médicis, épousera Maria Salviati, la nièce de Léon X. Après la mort de sa mère, Caterina Sforza, Jean de Medicis a été élevé par Jacques Salviati. La spoliation du duché d’Urbin va déboucher l’année suivante sur la guerre d’Urbin qui va s’achever provisoirement par un traité entre François Marie della Rovere et le pape, et l’exil du duc chez son beau-frère à Mantoue, avant la reconquête, définitive, du duché, en 1522, avec l’aide de Malatesta Baglioni (voir sur ce Blog l’article Philibert de Chalon le siège de Florence). Le pape Adrien VI lui reconnaît alors, formellement, l’investiture du duché d’Urbin, réparant la faute de son prédécesseur. C’est la raison pour laquelle, bien que titrée officiellement duchesse d’Urbin, Catherine de Medicis n’en possèdera jamais que le titre, et ce, jusqu’en 1522, seulement.
[iii] Ivan Cloulas « Catherine de Medicis » Fayard 1979.
[iv] Le duc de Toscane, Cosme 1er, sous prétexte qu’Ottaviano avait été infidèle, obligera son fils, Bernadetto, en 1546, à rembourser des sommes importantes. Ce dernier en conçoit un tel chagrin qu’il s’exile définitivement de Florence pour aller à Naples, où il va fonder la lignée des princes d’Ottaviano.
[v] Titre honorifique porté à Florence, par tous les Médicis et qui a pour équivalent la notion de « puissant ».
[vi] Les détails sur le gouvernement de Florence, qui suivent, sont tirés de l’ouvrage « Histoire de la république de Florence » par Hortense Allart, Paris Garnier 1843, un ouvrage très moderne, érudit et précis.
[vii] Pendant plusieurs siècles, le gouvernement de Florence a donné lieu à des élections tous les deux mois, renouvelant à chaque fois, tout le gouvernement et leurs titulaires. Les dirigeants avaient à peine le temps de s’informer qu’on devait les remplacer. Du coup, lorsque la « république de Savonarole » est réformée en 1498, Florence choisit de se donner un gonfalonier à vie : ce sera Soderini qui gouverne Florence jusqu’en 1513. Le rétablissement de la « quatrième république », la dernière, en 1527 donne lieu au choix d’institutions plus stables, même si la période retenue peut sembler courte pour nos critères contemporains.




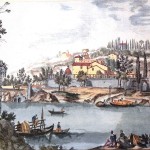






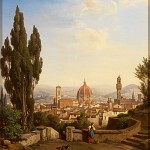

Laisser un commentaire