Le rêve de monarchie universelle de Gattinara est né de la rencontre d’une formation juridique basée sur les pouvoirs universels des empereurs romains et du constat de l’ampleur des territoires possédés par Charles Quint. Dès l’élection impériale de 1519, Gattinara établit l’empereur du Saint Empire comme roi des Romains et successeur d’Auguste. La monarchie universelle est destinée à positionner l’Empereur comme le Primus inter Pares de la Chrétienté.
Mercurino de Gattinara[1] naît en 1465 au château d’Arborio, non loin de Verceil, dans le Piémont, principauté rattachée à la Savoie. Sa famille est noble et illustrée en Lombardie, par des prélats, des ministres et des ambassadeurs. Sa mère est la sœur du comte Mercurino Ranzo, grand chancelier de Savoie. A la mort de son père, Mercurino est élevé par sa mère, lettrée, qui lui apprend à lire et à écrire et lui fait découvrir les lectures humanistes. Très jeune, il a été placé auprès de ses oncles pour travailler dans la branche de la jurisprudence. A treize ans, il s’inscrit à l’Université de Turin (fondée en 1404) où il obtient le diplôme de docteur en droit.
Pour apprendre le droit à l’époque, il faut commencer par apprendre les « Institutes » de Justinien qui en sont le rudiment. Puis, viennent les « Pandectes »[2], qui sont un recueil des discussions et des décisions de droit civil que l’empereur Byzantin a fait extraire des ouvrages des anciens jurisconsultes. Le mot Pandectes est composé de deux mots grecs qui signifient « contenir tout », la discussion et la décision de toutes les questions de droit. Cette formation initiale a la pensée juridique classique qui attribuait à l’empereur romain des pouvoirs universels, va structurer pour la vie la formation de Gattinara, qui obtient grâce à son oncle, une charge de conseiller du duc de Savoie, Philibert le Beau.

Philibert II de Savoie Jan Mostaert MET Museum New York
Ce dernier, qui est l’époux de Marguerite d’Autriche, décède en 1504 et son demi-frère, Charles III le Bon (voir l’article de ce Blog sur la généalogie de Savoie), lui succède.
Gattinara reçoit alors une mission de confiance de la duchesse Marguerite d’Autriche, de défendre ses intérêts patrimoniaux en Savoie. Cette dernière avait engagé un procès contre son beau-frère, René, le grand bâtard de Savoie, légitimé par Philibert, au terme duquel elle était parvenue à obtenir de son père, Maximilien d’Autriche, suzerain de la Savoie, que ce dernier soit déligitimé ce qui lui interdisait de prétendre succéder à Philibert au trône de Savoie. Avec cette condamnation, René de Savoie avait perdu tous droits patrimoniaux en Savoie, de sorte que Marguerite d’Autriche s’était emparée de ses domaines et notamment de son comté de Villars, qui, depuis lors, lui était âprement disputé par René de Savoie.

Jan Hey 1490 Marguerite d’Autriche MET Museum de New York
Or, la princesse avait formé le grand projet d’élever à la gloire de son mari, puissamment aimé, un monument à nul autre pareil, les tombeaux de Brou, pour la réalisation desquels elle avait absolument besoin des ressources de son riche comté de Villars. C’est dire si la mission de Gattinara était importante aux yeux de la princesse. Elle ne fut pas déçue et elle s’attacha pour la vie, les compétences de ce grand juriste.
Le frère de Marguerite d’Autriche, Philippe Le Beau, avait épousé la fille des rois catholiques, Jeanne d’Aragon, tandis que Marguerite, elle, avait épousé, avant Philibert, l’héritier des couronnes de Castille et d’Aragon, le prince Juan de Trastamare, fin 1496. Le prince, de santé fragile, était mort quelques mois après en 1497, de sorte que les droits sur les couronnes de Castille et d’Aragon étaient passés à sa sœur, Jeanne, dont l’époux, Philippe était donc devenu l’héritier des trônes espagnols, par mariage. A la mort d’Isabelle de Castille, Philippe le Beau hérite de la Castille dont il est couronné roi.

Philippe le Beau et Jeanne la Folle Maitre d’Affligem Musées Royaux des Beaux arts de Belgique
Philippe Le Beau et Marguerite d’Autriche étaient les deux enfants de Maximilien d’Autriche, Empereur du Saint Empire Romain Germanique, à partir de 1508 et de Marie de Bourgogne, fille unique de Charles le Téméraire et donc l’héritière de toutes les possessions de Bourgogne qui représentaient un Etat allant de Macon en France jusqu’à Utrecht, soit un territoire de près de 800 kms de long comprenant tous les Pays Bas et la Belgique actuels, le Luxembourg, une fraction de l’Allemagne, hors les duchés de Bar et de Lorraine.
A la mort de Charles le Téméraire, le roi Louis XI avait récupéré par un coup de force, les territoires de la couronne de France, apanagés ou réputés l’être de sorte que le duché de Bourgogne avait été rattaché à la couronne. Profitant de l’état de faiblesse momentanée de Maximilien, archiduc d’Autriche et époux de Marie de Bourgogne, affaibli politiquement et psychologiquement par la contestation en Flandre suite à la mort de la duchesse Marie, il avait imposé au Traité d’Arras en 1482, que la Bourgogne, terre apanagée, ne fasse pas partie des négociations. Les comtés d’Artois, d’Auxerre, de Bourgogne, de Charolais, de Mâcon et de nombreuses châtellenies (Bar sur Seine, Château-Chinon, Chaussin, Laperrière et surtout Salins), occupées militairement, sont attribués à Marguerite d’Autriche comme dot ce qui permet à Louis XI de poursuivre légalement son occupation militaire.
Louis XI avait organisé le mariage de son fils, le futur Charles VIII, avec Marguerite d’Autriche qui était venue vivre à la cour de France, à l’âge de deux ans. Néanmoins, lorsque le mariage est rompu pour permettre à Charles VIII d’épouser Anne de Bretagne, les clauses de nullité du traité d’Arras s’appliquent et la négociation subséquente intervenue entre la France et l’Autriche, aboutit, au traité de Senlis, en 1493, qui renvoie Marguerite à son père, avec une dot réduite aux seuls comtés d’Artois, de Bourgogne et de Charolais ainsi que les seigneuries annexes. Cette négociation qui n’est que l’application des clauses de nullité du traité d’Arras, génère chez Marguerite d’Autriche une profonde humiliation, d’autant plus forte que cette décision unilatérale de la France a pour effet de la priver, par l’application d’un traité international signé onze ans plus tôt, de la plus grande moitié de ses propres domaines. Désormais, Marguerite d’Autriche devient l’ennemie irréductible de la France et elle transmettra cette haine à Charles Quint, qu’elle va élever depuis l’âge de 4 ans jusqu’à 15 ans.
Le mariage de Philippe Le Beau avec Jeanne d’Aragon est une réussite. Entre les deux futurs époux, c’est le coup de foudre, définitif, tout au moins de la part de Jeanne.
La relation entre Philippe et Jeanne d’Aragon est torride mais très vite, les nombreuses infidélités du prince, aigrissent le caractère de son épouse qui lui fait des crises de jalousie épouvantables. A la mort de son époux, qu’elle aime passionnément, elle sombre peu à peu dans des crises de folie telles qu’il devient évident qu’elle ne pourra pas exercer de fonctions politiques. Il faut dire que sa mère, Isabelle la Catholique, et son père, Ferdinand d’Aragon, étaient cousins germains !
Quand Philippe le Beau meurt, en 1506, le problème est donc posé du gouvernement des provinces du nord, pendant la minorité du prince-héritier, Charles de Luxembourg, fils de Philippe et de Jeanne et futur Charles Quint, alors âgé de six ans.
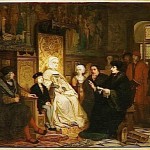
Enfance de Charles Quint avec Marguerite d’Autriche Lecture d’Erasme Edouard Jean HAMMAN Musee d Orsay
Maximilien d’Autriche est peu aimé des provinces belges et des Pays Bas. Et il est mal placé pour s’occuper du jeune duc de Luxembourg pendant sa minorité. Il faut une femme pour le jeune prince. Mais une femme de tête, pour tenir en respect les grands féodaux et notamment le duc de Gueldre, Charles d’Egmont. C’est donc à Marguerite qu’échoit la responsabilité de la Régence.
Mais confier l’éducation d’un jeune prince à une femme ? Il faut pouvoir y mettre un terme. Marguerite ne veut pas d’un rôle potiche. Il n’est pas dans sa nature d’obéir éternellement à son père. Elle exige des marges de manœuvre et un fief. Mercurino va être placé au cœur de la négociation avec l’archiduc d’Autriche, qui aboutit à un compromis en 1507: Marguerite conservera à titre viager ses comtés de Bourgogne (aujourd’hui la Franche Comté, rattachée à la France en 1685), d’Artois et de Charolais et elle sera investie de la régence des provinces du nord, « les pays de par-delà », tandis que Maximilien conservera la tutelle nominale des enfants de Philippe placés sous la responsabilité de Marguerite.

Maarten van Heemskerck Gattinara Musées Royaux des Beaux Arts de Belgique Bruxelles
Pendant cette négociation, l’habile juriste et diplomate a su se faire apprécier de Maximilien. Il a évoqué à mots couverts son désir d’occuper la place de premier Président du Parlement de la Comté à Dôle et il s’est fait recommander par la Régente. La rapidité de la réaction de Maximilien (11 jours entre l’expédition de la lettre de Marguerite et la réponse de son père), d’habitude particulièrement lent, montre que le principe en avait été préalablement approuvé et décidé.
Mais Maximilien a trouvé pour l’heure des occupations pour le protégé de sa fille : Gattinara, est expédié auprès du pape Jules II à Rome et auprès du cardinal d’Amboise dans le cadre des négociations préalables au traité de Cambrai du 10 décembre 1508. Les compétences diplomatiques du piémontais ont été, semble-t-il, appréciées, car il fait partie, en mars 1509, de l’ambassade expédiée par Maximilien, auprès de Louis XII. Il doit également prêter serment d’hommage par Marguerite auprès de Louis XII, pour la Comté de Bourgogne. Le roi, galant, lui répond « qu’il aimerait mieux baiser la vassale, que celui qui répond d’elle ».
Il reste à la cour de France jusqu’en décembre 1509, ce qui lui permet d’assister au mariage de Marguerite d’Angoulême, la fille de Louise de Savoie, avec Charles, duc d’Alençon. A cette occasion, il gère habilement des conflits de préséance avec les ambassadeurs d’Aragon.

Marguerite de Navarre Jean Clouet Walker Art Museum
En 1510, Gattinara est envoyé en Ambassade auprès du roi d’Aragon, pour obtenir une assistance financière dans la lutte contre Venise. Il vient également demander au roi d’Aragon, pour son petit-fils, Charles de Luxembourg, la grand – maîtrise de l’Ordre des Chevaliers de Saint Jacques d’Alcantara, qu’il n’obtiendra pas encore car il faudra pour Charles de Luxembourg, attendre de devenir roi des Espagnes (de Castille et d’Aragon), à la mort de Ferdinand, en 1516.

Ferdinand d’Aragon Kunsthistorisches Museum Vienne
Depuis le 19 avril 1509, Gattinara, lorsqu’il n’est pas en mission diplomatique, exerce son métier avec rigueur au Parlement de Dôle. Plusieurs condamnations ont été portées à son actif, et il a pris dans une affaire d’infidélité grave, d’un ancien trésorier de l’Empereur et de la comtesse, une position intransigeante, ce qui lui attire l’inimitié du Maréchal de Bourgogne, Guillaume de Vergy. Ce dernier le dénonce en août 1514, à l’Empereur Maximilien (élu empereur en 1508), comme indigne d’exercer la charge de Président du Parlement, car il n’est pas Bourguignon. Puis, en décembre 1514, une femme, détenue à la prison de Salins, par ordre du maréchal, dénonce Gattinara comme recevant une pension du roi de France pour desservir et trahir Marguerite d’Autriche.
La cour du Parlement se saisit de cette question, en l’absence de son Président et parvient à l’aveu de la dénonciatrice, selon laquelle cette version lui aurait été suggérée par M de Vergy, lui-même. Ce dernier adresse alors à la Comtesse une plainte en prévarication contre le parlement tout entier. Cette fois, l’affaire est sérieuse car elle menace de saper, en la personne de l’un de ses plus fidèles Conseillers, l’autorité de la comtesse et de la Régente. Marguerite fait remettre les pièces du procès à son conseil privé, qui conclut que la plainte du maréchal est sans fondement. Mais la princesse a besoin d’une caution morale plus importante. Le grand conseil de Malines est saisi : ce dernier se prononce sur l’innocence de Gattinara et attire l’attention sur la malignité des intentions du maréchal de Bourgogne.
Depuis Dôle, Gattinara se tient à l’écoute des grandes affaires européennes. Il n’hésite pas à apostropher la régente en 1514 sur le risque, pour la maison d’Autriche, du mariage entre Marie Tudor, sœur d’Henry VIII et Louis XII. Puis, Louis XII étant mort, trois mois à peine, après son remariage, François 1er lui succède au trône de France. Gattinara est expédié avec le comte Philippe de Nassau pour rendre hommage de ses comtés d’Artois, de Bourgogne et de Charolais à François 1er et proposer le mariage entre Charles de Luxembourg et Renée de France, belle-sœur de François 1er. Il rencontre à cette occasion Louise de Savoie qu’il sonde de la part de sa maîtresse Marguerite afin d’évaluer son pouvoir sur le roi de France son fils.
En 1516, l’inimitié du maréchal de bourgogne lui a attiré celles des nobles, qui lui créent des problèmes : il est obligé de justifier de sa qualité de Bourguignon, soit un exercice scabreux. Dégoûté, il jette l’éponge et quitte Dôle pour se retirer à la chartreuse de Bruxelles. Marguerite, cédant à la pression de son comté, qui commence à lui créer des difficultés politiques par suite de l’intransigeance de Gattinara, le relève de sa charge et lui réclame son désistement, qu’il refusera toujours de donner.

Marguerite d’Autriche Barend Van Orley Musee de Brou
Depuis 1515, Charles de Luxembourg, s’est affranchi de la tutelle de Marguerite d’Autriche qui s’est retirée à Malines.

Charles Quint à 15 ans par Barend Van Orley huile sur toile 0,360×0,26 Musée de Brou – Inventaire du Louvre
Son principal conseiller, pour réussir ce coup d’Etat, est Guillaume de Croÿ, seigneur de Chievres. Profitant de la jeunesse du grand-duc, il truste les dignités et les cadeaux. Il accompagne Charles de Luxembourg en Espagne, à la mort de Ferdinand le catholique, pour prendre possession de ses royaumes : à cette occasion il se signale par une extrême rapacité sur les charges et offices espagnols ce qui lui attire l’inimitié des grands seigneurs espagnols. A partir de 1516, il devient pratiquement, le premier Ministre du roi Charles.

Atelier de Quentin Massijs Portrait de Guillaume de Croÿ Seigneur de Chievres Premier ministre de Charles Quint 1458 1521
Marguerite, qui continue d’exercer un grand ascendant sur le neveu qu’elle a élevé, lui adresse, à sa demande, en octobre 1518, son conseiller Gattinara, qui est nommé chancelier du roi de Castille et d’Aragon. Marguerite attend implicitement de Gattinara qu’il saura se souvenir par le soin de qui il a reçu cette nomination prestigieuse. Elle termine en effet sa lettre de félicitation par ces mots : « espérant que par votre prudence et dextérité, vous acquitterez tellement en l’exercice d’icelui estat que nous et autres qui ont procuré vous y pourvoir, y aurons honneur et vous le semblable avec le profit, et n’avons nul doute que, comme vous avons été bonne dame et maîtresse, vous serez bon et loyal serviteur ». A l’évidence Marguerite attend de Gattinara qu’il n’oublie pas qui il est, ni d’où il vient.
Cette nomination va s’avérer capitale pour le jeune roi d’Espagne. Gattinara conseille très habilement le jeune roi de dix-neuf ans, lors des élections impériales et lui suggère de se rapprocher de sa tante, Marguerite, dont les recommandations vont s’avérer déterminantes, au moment où Charles commençait à croire la partie perdue.
Dans son discours prononcé devant la légation des princes électeurs du Saint Empire Romain Germanique, reçue par Charles Quint à Molins del Rey, près de Barcelone, le 30 novembre 1519, pour lui présenter officiellement le décret confirmant son élection, le chevalier de Gattinara « rappelle l’origine divine du Saint Empire et fait référence à Charles Quint, comme successeur d’Auguste. En se référant à Justinien, la même année, Gattinara en appelle à l’utilisation de la force quand la loi impériale n’est pas respectée. Le projet de Gattinara doit parler au cœur des hommes, pour les convaincre de la nécessité de faire triompher le bien. La défense des valeurs éthiques universelles, confondues avec la morale chrétienne, légitimait l’utilisation de la force, mais il fallait convaincre les plus réticents que cette force n’était mise qu’au service du droit et de la justice. Selon Gattinara, la paix de la Chrétienté n’était possible qu’à la condition que tous les souverains d’Europe s’accordent à considérer Charles Quint comme Primus inter pares »[3]. Il s’agissait d’un discours formel qui n’aura aucun impact sur la politique de l’Empereur, mais qui suscitera pendant les cinq siècles suivants, polémiques et controverses.
Ce discours sur la monarchie universelle de l’Empereur du Saint Empire Romain Germanique a été inspiré au juriste Gattinara par sa formation aux « Pandectes » et la continuité introduite entre les empereurs romains puis Byzantins et les Empereurs du Saint Empire via les Rois des Romains. Mais ce discours est également en correspondance avec des contemporains comme l’évêque de Badajoz, Pedro Ruiz de la Mota, président des « Cortès » de Saint-Jacques de Compostelle, qui « proposait un empire chrétien dont la finalité n’était pas de soumettre les autres souverains, mais de coordonner et diriger les efforts de tous ces rois pour l’universalité de la culture européenne »[4].
Dès l’arrivée de Gattinara au pouvoir, son influence commence à grignoter celle de Chievres et Gattinara s’impose vraiment comme l’un des conseillers les plus écoutés de Charles Quint, qui ne lâche cependant pas encore son ministre Chièvres. Il va laisser ce dernier conduire avec l’ancien gouverneur de François 1er, Artus Gouffier de Boisy, les négociations de paix de 1519 à Montpellier, qui avortent brutalement par la mort du Grand Maître de France, sur fond de rivalité entre les deux monarques pour l’élection impériale.
La rupture avec François 1er est consommée lorsque ce dernier expédie à Burgos le 20 février 1520 « une note arrogante sur l’exécution défaillante du traité de Noyon »[5] par Charles Quint. Ce traité signé sous les auspices de Guillaume de Croÿ, favorable à l’alliance avec la France, obligeait Charles Quint à satisfaire le roi de Navarre, Henri d’Albret. Mais le jeune empereur, excité par Gattinara, n’a pas la moindre envie de restituer la Navarre espagnole.
Marguerite, pousse alors son neveu, à l’occasion du voyage de l’Empereur, dans les provinces du nord, organisé par les services du premier ministre, , d’aller saluer le roi d’Angleterre chez lui. Cette rencontre qui précède de peu, le « camp du drap d’or » entre François 1er et Henry VIII, va flatter extraordinairement le jeune roi d’Angleterre. Marguerite qui connaît bien la psychologie anglaise a recommandé à son neveu de faire preuve d’autant plus de modestie que sont importants les territoires qu’il contrôle. La diplomatie espagnole, s’appuyant sur les relais de Marguerite en Angleterre, a bien compris le rôle central du cardinal Wolsey auprès du souverain anglais : elle est venue apporter au cardinal un riche évêché espagnol comme première manifestation de son ouverture.
Dans les jours qui suivent le camp du drap d’or, Charles Quint rencontre à nouveau son homologue anglais, entre Calais et Gravelines et il promet à demi-mot à Wolsey, de l’aider à devenir Pape si celui-ci réussit à convaincre son maître de choisir l’alliance Espagnole. L’Angleterre ne se découvre pas immédiatement car Charles Quint n’a pas encore rompu officiellement avec la France. La mort de Guillaume de Croÿ, dont la francophilie est sévèrement condamnée par les Anglais, qui survient opportunément en mai 1521, va radicaliser les comportements, comme si Charles Quint et François 1er n’attendaient que cette nouvelle pour entrer en conflit.
Charles Quint a désormais vingt-et-un ans : il entend désormais gouverner seul.

Charles Quint Le Titien Musée du Prado
Pendant que la guerre s’engage en France, sur tous les fronts (en Champagne, en Navarre, en Picardie et en Italie),, les griefs reprochés par la France à l’Empire liés au non respect du traité de Noyon, suscitent des plaintes Aurès d’Henri VIII, lequel flatté, propose d’organiser des conférences de paix à Calais pour rapprocher les points de vue Français et Impériaux, sous la médiation et la présidence du cardinal Wolsey. Sont venus, en août 1521, du côté Français, le Chancelier Duprat, et du côté Espagnol, présidant une nombreuse délégation, Gattinara. Mais les discussions s’enlisent car le médiateur, Wolsey semble souligner davantage les points qui divisent que ceux qui rassemblent en cherchant à mettre en exergue que la rupture de la paix est à mettre à la responsabilité de la France, laquelle souligne que cette réaction est consécutive au non respect de ses obligations par l’empire.
La position de Gattinara n’est pas facile à défendre mais le parti de la guerre est déjà décidé. Il prétend s’être déplacé sans pouvoir de décision et souligne quant à lui le rôle de la France dans l’insurrection de Robert de la Marck. Quand les discussions s’achèvent, dans l’impasse, et le congrès dissous, le 22 novembre 1521, Wolsey va, à Calais même, conclure, au nom d’Henry VIII, une alliance offensive contre la France : ce traité est la preuve qu’alors que le cardinal faisait semblant d’arbitrer la conférence de paix, il était déjà d’accord avec Charles Quint pour engager la guerre à ses côtés.
Gattinara, va exercer, de 1522 à 1526, une faible influence sur les décisions de Charles Quint, qui va surtout écouter ses conseillers castillans et Flamands. Ceci en raison d’abord de difficultés de santé et ensuite parce qu’il ne parvient pas à imposer son point de vue lors des décisions importantes du Conseil du roi.
Là où sa contribution va être la plus déterminante, c’est lors de la captivité de François 1er en Espagne. Gattinara, qui n’a jamais eu l’entière direction des affaires impériales, estime que « François 1er est prêt à signer n’importe quel traité à condition de sortir de prison, suivant en cela la stratégie utilisée par Louis XI avec Charles le Téméraire. Il faut donc contraindre le roi à accomplir ses promesses avant sa libération »[6]. Gattinara était moins acharné à la destruction de la monarchie française qu’à sa gouvernance par un allié politique de l’empereur comme le connétable de Bourbon. En l’occurrence, Gattinara va moins chercher à instaurer une paix générale en Europe, en négociant un traité permettant de ne pas abaisser la France, qu’à se faire le procureur intransigeant de Charles Quint, jusqu’à la signature du Traité.

Jan Cornelisz Vermeyen Gattinara Musées Royaux des Beaux Arts de Belgique Bruxelles
Ce portrait de Gattinara âgé présente une parenté, à mon avis incontestable avec le premier tableau de Maarten van Heemskerck, tous deux au Musée Royal des Beaux Arts à Bruxelles, Même menton volontaire, même nez droit, structure massive et déterminée. Et pourtant ce sont deux peintres différents. Des portraits qui ressemblent davantage à l’idée que l’on se fait de l’intransigeance de Gattinara. Et pourtant! Le portrait de Vermeyen ci-dessus est également attribué à Jean Carondelet, chancelier de Charles le Téméraire. Mais je ne pense pas que ce soit le cas car les tableaux des années 1450 présentent généralement les personnages de profil. Or la posture du sujet ci-dessus est très moderne et de face. Le mystère reste donc entier. Si ce n’est ni Carondelet ni Gattinara, qui est-ce ?
Le traité aussitôt signé, le 14 janvier 1526, le point de vue qui prévaut n’est pas celui de Gattinara mais celui de Charles de Lannoy, le vice roi de Naples, qui avait capturé François 1er à la bataille de Pavie. L’Empereur décide de libérer François 1er avant qu’il n’ait accompli ses promesses du Traité de Madrid.

Portrait de Mercurino Gattinara Gallica BNF
Le portrait ci dessus doit sans doute être considéré comme le véritable portrait de Mercurino Gattinara. La courbure si particulière du nez du sujet montre que les deux tableaux ci-dessus au Musée Royal des Beaux Arts de Belgique, attribués à Gattinara, ne représentent pas le Piémontais.
La ligne politique préconisée par Gattinara ayant été rejetée par l’Empereur, Gattinara tire les conséquences de la ligue de Cognac aussitôt engagée par la France et la faillite subséquente de la doctrine de Lannoy : il quitte la cour. Aussitôt après le sac de Rome, le 6 mai 1527, il va être rappelé par Charles Quint qui va lui confier, par la suite, une responsabilité prépondérante dans la conduite des affaires d’Italie.
Gattinara va hardiment s’appuyer sur le sac de Rome pour contraindre le pape Clément VII à renoncer, en faveur de l’Empire de Charles Quint, à se constituer l’arbitre de la puissance politique en Italie. Au pape, le pouvoir spirituel et à l’Empire le pouvoir temporel. Gattinara va appuyer de tout son poids la réactivation des liens féodaux entre les principautés italiennes et le Saint Empire : les Gonzague à Mantoue, élevé au rang de duché en 1530, la République de Florence, transformée en duché en 1530, au profit d’Alexandre de Médicis, gendre de Charles Quint en 1537.
Par le traité de Barcelone, signé le 20 juin 1529, Clement VII sortait officiellement de la Ligue de Cognac et promettait à Charles Quint la couronne de Roi des Romains et l’investiture sur le royaume de Naples.
Et le 24 février 1530, Charles Quint était couronné Roi des Romains à Bologne après avoir été sacré roi des Lombards. Car pour Gattinara le titre porté était plus important que les territoires contrôlés pour asseoir l’idée de la domination de l’empereur sur le monde.

Couronnement de Charles Quint Anonyme d’après Gaspard de Crayer Base Joconde Musée Ingres Montauban
___________________________________
[1] La base de cet article est rédigée à partir des « Etudes biographiques sur Mercurino Arborio de Gattinara » par M.Le Glay Correspondant de l’Institut. Il a été complété par des éléments empruntés à la Bibliographie sur ce Blog , par des emprunts à « Charles Quint » de Pierre Chaunu chez Fayard 2000, à l’article accessible en ligne sur le site Asterion.revues.org « Gattinara et la monarchie impériale de Charles Quint. Entre millénarisme, translatio imperii et droits du Saint-Empire» par Juan Carlos d’Amico, à l’article « Les raisons de l’empire et la diversité des temps Présentation, traduction et commentaire de la responsiva oratio de Mercurino Gattinara prononcée devant la légation des princes- électeurs le 30 novembre 1519 » par Laurent GERBIER CESR Université de Tours.
[2] Voir à ce sujet l’article « Le Digeste de Justinien ».
[3] Article de Juan Carlos d’Amico, déjà cité.
[4] Dans « Charles Quint et la monarchie universelle » par Annie Molinié-Bertrand.
[5] Pierre Chaunu, opus déjà cité p 152
[6] Gattinara et la monarchie impériale de Charles Quint. Entre millénarisme, translatio imperii et droits du Saint-Empire» par Juan Carlos d’Amico, article déjà cité.



Laisser un commentaire