La vie d’Andrea Doria est un exemple unique de reconversion réussie d’un militaire dans la marine, qu’il rejoint à l’âge de quarante-sept ans. Stratège hors pair, doté d’un immense génie tactique, Doria va s’affirmer comme le plus grand marin de la Méditerranée au XVIème siècle, si l’on excepte le grand Barberousse, son rival ottoman. François 1er ne saura pas exécuter ses engagements à l’égard du condottiere, qui va se jeter dans les bras de Charles quint, pour la gloire de ce dernier.
Au service du pape et de Naples
Andréa Doria est né le 30 novembre 1466, dans la nuit de la Saint-André à Oneglia, à mi-chemin de Savone et de Monaco.
Le père et la mère d’Andrea[i], appartiennent tous les deux à la grande famille Doria, propriétaire de la principauté d’Oneglia (Imperia).
A la mort de sa mère, en 1483, Andrea vient d’avoir dix-sept ans. C’est un homme. Il doit choisir sa carrière. Sa mère lui laisse une somme importante en liquide, à la condition qu’il ne choisisse pas la carrière des armes. Mais il n’est pas possible à un Doria de réfréner son talent et son instinct.
Confronté à l’anarchie politique qui domine à Gênes, ballottée entre les influences contraires des familles plébéiennes des Adorno et des Fregoso, qui offre peu de perspectives d’avancement, il choisit, deux ans plus tard, à l’âge de dix-neuf ans, en 1485, de rejoindre son oncle, Nicholas Doria, à Rome où ce dernier est capitaine des gardes du pape génois, Innocent VIII.
A la mort d’Innocent VIII, en 1492, suivie par l’élection du pape espagnol Alexandre VI Borgia (voir l’article sur ce Blog sur l’Ascension des Borgia de Calixte III à Alexandre VI), Andrea comprend qu’il a peu d’espoir d’être favorisé par le nouveau pape espagnol, qui songe d’abord à ses compatriotes : il choisit donc de quitter le service du Pape et il s’enrôle sous la bannière napolitaine du roi de Naples, Ferrante d’Aragon, qui cède bientôt son trône à son fils, Alphonse II Trastamare. Ce dernier est renversé par Charles VIII (voir l’article sur ce Blog sur la première guerre d’Italie). Andrea Doria, capitaine d’une compagnie de cavalerie lourde, défend le père puis le fils et, après de la conquête de Naples par les Français, il choisit de partir faire un périple en Terre sainte.
La forteresse de Guglielma pour la ligue de Sora
A son retour, il balance un moment entre le service du roi de Naples, soutenu par le grand capitaine, Gonzalve de Cordoue, et celui du préfet de Rome, Giovanni della Rovere, duc de Sora, qui a organisé la ligue de Sora, qui vise à défendre les possessions françaises en Napolitain. Cette ligue comprend entre autres, Gratien de Guerres, capitaine de Charles VIII pourles Abruzzes, Giovanni Paolo Cantelmi, Giovanni della Rovere, Frédéric de Monfort et Giovanbattista Caracciolo[ii].
Pourquoi choisit-il de combattre contre la royauté de Naples, qu’il a fidèlement servie précédemment ? Pourquoi embrasser la cause perdue des Français car tout porte à croire qu’ils vont être complètement éliminés du sud de l’Italie ?
En fait, il choisit d’apporter son aide à Giovanni della Rovere, le préfet de Rome, duc de Sora, frère du cardinal della Rovere, ennemi du pape Alexandre VI. A-t-il à cette époque un litige avec le pape Alexandre VI, né lors des premiers jours du pontificat de ce dernier ?
Giovanni della Rovere, seigneur de Sinigaglia, a épousé Jeanne de Montefeltro, la fille du duc d’Urbin, Frédéric de Montefeltro (voir les trois articles sur le duc d’Urbin sur ce Blog: l’apprentissage du condottiere, le grand condottiere invaincu et la cour fastueuse du duc d’Urbin), dont il a eu un fils, François Marie, qui sera adopté par le duc d’Urbin, Guidobaldo de Montefeltro, sans enfant, pour devenir son successeur. Ce fils va jouer un certain rôle sur ce Blog (voir notamment l’article sur le Sac de Rome en 1527).

Rafaello Santi Portrait de Francesco Maria della Rovere Seigneur de Sinigaglia puis duc d’Urbin Musee des Offices Florence
Pourquoi choisit-il le parti du préfet de Rome ? Est-ce par ce que ce dernier à plaidé sa cause auprès du pape pour faire libérer son frère David des prisons du pape ? Est-ce à cause de la réception amicale qu’il a reçue de ce dernier lors de son passage à Urbin ? Ou est-ce tout simplement par un transport de sympathie naturelle et réciproque ?
Toujours est-il qu’il recrute à ses frais un petit parti de vingt-cinq archers à cheval qu’il vient jeter dans l’une des forteresses tenues par Giovanni dans le royaume napolitain, La Rocca Guglielma. Il exerce tant de brigandages dans la région que le Grand capitaine, Gonzalve de Cordoue, finit par s’intéresser à lui et vient faire le siège de la forteresse. Les Espagnols sont près d’emporter la ville lorsqu’une trêve est signée. « El gran capitan » reçoit alors Andrea Doria sous sa tente où les deux hommes font assaut de courtoisie et se livrent à des échanges de politesse, qui les quittent très contents l’un de l’autre.
A Sinigaglia contre Cesare Borgia
Après cette défense héroïque, Andrea est reçu avec reconnaissance par Giovanni della Rovere et son épouse, à Sinigaglia. Il assiste aux derniers moments de son ami, qui le charge de défendre les droits de son fils, François Marie, en nommant Andrea son co-tuteur légal avec sa mère, le Sénat vénitien et le cardinal della Rovere (futur pape Jules II, en 1503).
Andrea est un homme dans la force de l’âge, à trente-sept ans, lorsqu’il est confronté aux entreprises du conquérant de la Romagne, Cesare Borgia (voir les deux articles sur ce Blog sur les meurtres du Cardinal de Valence et sur le duc de Valentinois) pour s’emparer de Sinegaglia.

copie tableau Bartolomeo Veneto Cesare Borgia Duc de Valentinois Musee National du Palais de Venise
Andrea, pendant qu’il feint de négocier sa reddition avec Cesare, parvient à faire fuir le jeune François Marie sur Venise, puis sa mère, déguisée en page, vers Florence où il parvient lui-même après avoir traversé les lignes ennemies. Il lui conseille de se rendre à Gênes où réside alors, son beau-frère, le redoutable cardinal della Rovere. A peine arrivée, la préfétesse de Sinigaglia fait l’objet des assiduités cauteleuses du cardinal pour se faire remettre les places fortes de son neveu.
Conseillée par Andrea Doria, elle dissimule et prend la fuite à bord d’un vaisseau qui la débarque à Gaëte au nord du territoire napolitain. Bien lui en a pris car elle arrive juste avant l’envoyé du cardinal, venu se faire remettre les places du neveu quand le cardinal croyait la mère, occupée à négocier à Gênes.
Au service de la Banque de Saint-Georges en Corse
La réputation d’Andrea Doria est désormais établie à Gênes et dans toute l’Italie car le coup joué à Sinegaglia par Andrea, au maître des maîtres en fourberie, Cesare Borgia, n’est pas passé inaperçu. En 1503, certains barons corses s’étant révoltés contre la Banque de Saint Georges, qui administre l’île depuis 1453 (sur la Banque de Saint-Georges voir l’article sur ce Blog sur Gênes entre insurrection et soumission), Andrea est envoyé en Corse, sur demande de son oncle, Nicholas, qui souhaite partir de Corse pour revenir au service des Della Rovere à Rome, où le cardinal génois vient d’être élu pape, à la mort d’Alexandre VI.

Portrait du pape Jules II Raphael National Gallery Londres
Vers la fin septembre 1507, Andrea Doria parvient enfin à mettre la main sur le principal révolté, qui est expédié à Gênes sous bonne garde. La Corse est pacifiée. Il peut rentrer à Gênes où la république vient de faire construire une flotte de galères pour faire la guerre aux pirates barbaresques, devenus très entreprenants, sous la conduite notamment d’un pirate nommé Baba Arudj (voir sur ce Blog l’article sur Barberousse – Le pirate sanguinaire d’Alger).
Reconversion d’un condottiere
Mais il lui faudra attendre encore cinq ans avant d’en prendre le commandement, en 1513, année où l’éviction des Français de Gênes, rétablit l’indépendance, pour peu de temps, de la République.
A l’âge de quarante-sept ans, ce condottiere qui n’a jamais fait la guerre que sur terre, se reconvertit dans la marine. Il dispose des qualités requises pour ce poste. Il allie la ruse à la fourberie. Il possède tous les rudiments de la stratégie et de la tactique. Il sait se concilier les hommes et choisir des talents. Il décide promptement et sait quand il faut plier et rompre. Jamais peut-être, dans l’histoire navale, pareille reconversion de l’armée de terre à la marine, ne fut si rapidement et si brillamment réussie.
Mais les plus féroces ennemis d’Andrea Doria ne sont pas les Barbaresques, ce sont ses détracteurs, qui, à Gênes, cherchent à le priver de son commandement. Il réunit alors des armateurs privés auxquels il propose d’acheter quatre galères qui sont immédiatement équipées avec des esclaves barbaresques, auxquelles il adjoint deux galères de la république avec des équipages de rameurs volontaires. Apprenant qu’un pirate nommé Godoli (ou Cadolin), croise dans les eaux corses, à la tête de huit fustes et cinq galères, il se rue, de toute la vitesse de ses rames, pour intercepter les pirates vers l’île de Pianosa au sud-ouest de l’île d’Elbe.
Doria attaque la flotte ennemie avec deux galères seulement, fixant toute la flotte, tandis que son neveu, Filippino Doria, à la tête de quatre galères fonce pour le libérer. Il n’est que temps, car une de ses galères amirales, menace de sombrer. Cette première grande opération est un succès total : deux vaisseaux pirates sont pris et Godoli lui-même, tombe entre les mains de Doria.
Désormais, sa réputation est faite, sur toutes les côtes du bassin méditerranéen, où Chrétiens et Maures l’adulent ou le craignent. Il dispose d’une flotte de huit galères avec lesquelles il se livre à la guerre de course, de 1513 à 1522, d’un bout à l’autre de la Méditerranée.
La guerre entre la France et l’empire
Au lendemain des élections impériales, en 1521, la grande rivalité entre François 1er et Charles Quint, déclenche une guerre meurtrière qui va durer dix longues années. L’empereur Charles Quint a surclassé François 1er dans toutes ses manœuvres diplomatiques : après avoir gagné les élections impériales, il a réussi à détacher le pape de l’alliance avec la France et il s’est mis d’accord avec l’Angleterre en captant astucieusement l’attention d’Henry VIII[iii].
Doria continue de faire la guerre de course, un peu pour la République et beaucoup pour lui. Il est à la tête d’une flotte de douze galères. Gênes est redevenue française depuis 1515, avec la bataille de Marignan qui a ramené le duché de Milan, et par conséquent, la ville de Gênes, sous le contrôle de la France. Les Espagnols vont s’attacher à faire sauter, un par an, les verrous qui permettent à la France de se maintenir en Italie : leur premier objectif est la ville de Milan. Dans un premier temps,
Le 19 novembre 1521, la coalition formée des troupes espagnoles, napolitaines et pontificales, expulse les Franco-Vénitiens de Milan, presque sans effort, la population étant en état d’insurrection. Depuis lors, une nouvelle armée a été réunie à la hâte, en 1522, par François 1er, qui a expédié seize mille Suisses en Italie sous le commandement de Lautrec avec, pour l’assister, le nouveau maréchal de Montmorency, le grand bâtard René de Savoie, et Galéas de Sanseverino, le grand écuyer. Lautrec a raflé les trois mille hommes de Jean des Bandes Noires et il a fait sa jonction avec les Vénitiens, de sorte qu’il est à la tête de vingt-cinq mille hommes lorsqu’il arrive en vue de Milan.

Odet de Foix Vicomte de Lautrec Jean Clouet Inventaire n°MN136;B8 Musée Condé
Prospero Colonna a renforcé les défenses de la ville derrière lesquelles il s’est retranché avec douze mille hommes. Lautrec se casse les dents sur l’attaque de Milan, dont il constate bientôt que la ville n’est pas prenable, bien qu’il puisse s’appuyer sur la citadelle de Milan, toujours tenue par les Français. Apprenant que Francesco Sforza, le duc de Milan arrive avec six mille lansquenets allemands, pour renforcer Colonna, il se porte à sa rencontre. Ce dernier se retranche à Pavie, et Lautrec passe plusieurs longues semaines inutiles, dans l’attente de son frère, le maréchal Lescun, qui amène six mille hommes de renforts. Puis s’étant concerté avec Colonna, Francesco Sforza, par des chemins détournés, parvient à rejoindre Milan, échappant à la vigilance des Français.
Que va faire Colonna ? C’est un excellent tacticien et manœuvrier. Il sait très bien que la faiblesse des Français, comme la sienne du reste, vient de la paie des troupes. Que la campagne dure suffisamment longtemps sans rencontre notable ou pillage de ville et les Suisses repartiront chez eux. Il décide de s’enfuir de Milan, en se tenant à distance de Lautrec, poursuivi par l’armée royale. Il trouve finalement un point favorable, à la Bicoque, où il se retranche et fortifie ses positions.
L’armée française arrive enfin sur le terrain choisi par l’adversaire. Les reconnaissances des officiers généraux montrent que l’ennemi est en position de force. Les plus braves commandants de l’armée recommandent la prudence et sont partisans d’un report de la rencontre . Mais les Suisses exigent de combattre ou de repartir. Lautrec cède. Le lendemain, les Suisses vont charger comme à leur habitude. Mais ils se heurtent dans leur progression, à un chemin inondé surmonté d’un talus protégé par des fascines, selon une tactique copiée de la victoire de Cerignoles gagnée par Gonzalve de Cordoue le 28 avril 1503 sur le duc de Nemours, Louis d’Armagnac, qui est la première bataille de l’histoire, gagnée par les arquebuses. Derrière les fascines, les arquebusiers impériaux font pleuvoir un déluge de plomb, qui décime les Suisses, pendant que toutes les offensives de cavalerie sont contenues. L’armée française est contrainte à faire retraite, tandis que les Suisses se débandent et fuient vers la Suisse et que les Vénitiens retournent chez eux. Ce qui reste des forces françaises fait retraite en direction de Gênes puis de la France. Le duché de Milan est perdu pour François 1er.
Le sac de Gênes par les Impériaux
Les impériaux, désormais maîtres de l’Italie centrale, se tournent alors vers Gênes où ils arrivent un mois plus tard. Ils sont attendus par une fraction importante de la population qui souhaite remplacer le gouverneur de Gênes Fregoso, par un doge Adorno, favorable aux Impériaux. Le marquis de Pescara (voir sur ce Blog l’article sur la divine marquise Vittoria Colonna) est arrivé par la route des montagnes, la plus escarpée, celle du passage de Polcevera. Il a envoyé des lettres recommandant aux Génois de se rendre pour éviter un sac, tout en souhaitant ne pas être entendu car la guerre n’a pas été très rémunératrice pour ses troupes, jusqu’à présent. Quant à Prospero Colonna, il a pris la route du val Bisagno.
Contre toute attente, Gênes, pour son malheur, choisit de résister. Mais Pescara a fait monter une batterie de canons, aidé par des montagnards, sur une colline très escarpée qui domine la ville. Et il commence à bombarder les portes avec succès car des failles commencent rapidement à s’ouvrir. Du coup, le parti de la paix se montre beaucoup plus pressant et l’on décide d’adresser une députation à Pescara pour organiser la reddition.
Mais les soldats de Pescara se sont déjà jetés à l’assaut des remparts du côté de la porte Saint Thomas interdisant l’accès des députés au quartier général. Les négociateurs sont donc dans l’obligation de faire le tour de la ville pour aller en direction du val Bisagno pour rencontrer Colonna. Ce dernier décide d’une trêve pour organiser la capitulation. Mais Pescara affecte de n’avoir reçu aucun ordre et il redouble d’efforts pour élargir les brèches. Finalement un mur s’écroule par lequel les troupes en furie s’engouffrent en hurlant dans la ville terrorisée. Adorno n’a que le temps de demander à Pescara de placer un cordon de sécurité autour de la Banque de Saint-Georges, les bâtiments de la douane et du port franc et le pillage de la ville peut commencer. Il va durer cinq longues heures seulement mais il va coûter à la ville des richesses inouïes, qui vont disparaître à jamais.
Une troupe française étant annoncée, les commandants sonnent le rappel, et l’armée impériale sort de Gênes.
Andrea Doria a réussi à sortir du port avec quatre galères, avec lesquelles il s’approche aussi près du rivage que possible pour ramasser le plus grand nombre possible de parents et de Génois puis il part se réfugier avec ses quatre galères, à Monaco.
Le condottiere génois n’a alors pour unique solution que de s’adosser à une puissance territoriale en mesure de lui proposer des ports et des approvisionnements. Il se tourne vers François 1er auquel il propose un contrat de condotta de trois ans, s’achevant en 1526. Le roi de France n’est que trop heureux de profiter du renfort de ce tacticien hors pair et de ses galères, qui viennent s’ajouter aux siennes de Marseille.

François 1er Jean Clouet Musée du Louvre
Première condotta avec François 1er
Doria est venu à Lyon rencontrer le roi pendant l’été 1523, pour se concerter avec lui sur les opérations en Italie.
Car une nouvelle armée française, forte de quarante mille hommes, conduite cette fois-ci par l’amiral Bonnivet est descendue en Italie pendant l’été 1523, pour reconquérir le Milanais. Le roi devait en prendre la tête mais l’affaire de la trahison du connétable de bourbon l’a retenu à Lyon. D’orient sont arrivées des nouvelles fracassantes : les chevaliers Hospitaliers ont été délogés de Rhodes par le sultan Soliman, à la tête d’une armée de deux cent mille hommes. Désormais, rien ne retient plus la puissance turque, qui peut conquérir le bassin méditerranéen.
La diplomatie impériale est parvenue à créer l’union de toutes les principautés italiennes, y compris le pape et Venise, qui se sont retournés contre la France. Gênes est chargée de fournir une flotte qui appuiera les opérations terrestres confiées aux généraux Pescara et Leyva après la mort de Colonna. A Rome, le pape Adrien VI vient de mourir, remplacé par Clément VII. En fin d’année 1523, Bourbon, qui a trahi François 1er, rejoint le camp impérial. Il est nommé lieutenant général de l’Empire en Italie.
Les forces coalisées l’emportent par l’astuce de leurs généraux par rapport à Bonnivet qui ne peut obtenir de rencontre décisive où son armée aurait pu l’emporter, mais qui est au contraire confronté à une guérilla incessante qui le contraint bientôt à faire retraite vers la France. Au cours de l’un de ces engagements d’arrière-garde, le chevalier Bayard est tué.

Guillaume Gouffier de Bonnivet 1488-1525 Jean Clouet Inventaire n° MN153;B14 Dessin Musée Condé
Dans leur poussée irrésistible, les impériaux commandés par Bourbon ont culbuté Bonnivet hors d’Italie. Bourbon, animé par une soif inextinguible de vengeance contre François 1er veut absolument envahir la France pour créer un front qui attirera François 1er dans le sud, laissant les mains libres à Henry VIII et à Charles Quint dans le nord.
L’armée impériale, qui est entrée en Provence en 1524, ne voit pas poindre les renforts promis par Charles Quint. Elle se cherche un objectif et croit le trouver en programmant le siège de Marseille. Car Bourbon voulait immédiatement remonter ver Lyon mais Pescara a eu les plus grandes difficultés à l’en dissuader. Bourbon, qui a pensé pouvoir traiter avec Charles Quint et Henry VIII comme de puissance à puissance, est tout seul à faire l’attaque de la France. Il va être le seul à en supporter les conséquences. Mais pour l’heure, il attend à Saint-Laurent-du-Var son artillerie, que doit lui amener une flotte génoise, commandée par Hugo de Moncade, un ancien officier de Cesare Borgia, passé au service de Charles Quint.
Andrea Doria auquel François 1er a remis ses galères de Marseille, est maintenant à la tête d’une flotte de dix galères qu’il a positionnée au large du littoral provençal pour intercepter les secours sur Marseille. A cette occasion, il capture un brigantin qui vient se jeter étourdiment dans son dispositif avec le général des troupes de renfort promises par Charles Quint à Bourbon, Philibert de Chalon, prince d’Orange (voir sur ce Blog l’article sur Philibert de Chalon : contre François 1er). Andrea Doria a expédié le prisonnier au roi en réclamant une rançon de vingt-cinq mille écus que François 1er lui a promise mais qu’il ne paiera jamais.

Philibert de Chalon Ecole française AA35 F9 Chantilly Musée Condé Photo RMN René Gabriel Ojéda
Bourbon a obtenu d’Augustin Grimaldi, évêque de Grasse, oncle et tuteur du jeune Honoré Grimaldi, l’appui de la forteresse et de la seigneurie de Monaco. Le seigneur de Monaco, Lucien Grimaldi vient d’être assassiné par Barthelemy Doria, peut-être de connivence avec Andrea Doria, car l’entrée des galères de Doria dans le port et le meurtre, ont eu lieu en même temps. Difficile de ne voir dans cette juxtaposition d’évènements qu’une coïncidence.
Lorsque la flotte de transports espagnols et de galères génoises commandée par Hugo de Moncade arrive au lieu de rendez-vous fixé avec Bourbon, à Saint-Laurent, la flotte commandée par Andrea Doria lui tombe dessus à l’improviste, désorganisant et bousculant tous les navires.

Gudin Jean Antoine Théodore de, Baron (1802-1880) Doria disperse la flotte de Moncade à St Laurent du var MV1372 Photo (C) RMN-Grand Palais / Daniel Arnaudet / Gérard Blot Dépôt du musée de Versailles, 1984 Paris, ministère des Affaires étrangères
Trois galères sont jetées à la côte, et leurs équipages se sont débandés, sous le nez même des troupes espagnoles. Doria a commandé à ses marins d’en prendre le contrôle. Mais Bourbon se jette alors avec ses arquebusiers dans la galère la plus exposée, en criant à Pescara et Lannoy d’en faire de même avec les deux autres galères en s’écriant « Sauvons l’honneur du camp et de l’empereur » ![iv] Le combat est acharné. Mais les galères et leur précieux chargement de canons de siège et de munitions vont rester en possession des Impériaux.
Pendant ce temps, la quasi-totalité des autres navires ont rejoint le port de Monaco où les chargements d’artillerie, de munitions et de vivres ont été débarqués.
Le secours expédié sur ordre de Charles Quint permet à Bourbon de faire le siège de Marseille. La ville est défendue par un autre condottiere italien, un membre de l’illustre famille des Orsini, Renzo da Ceri (voir l’article sur ce Blog sur le Sac de Rome). Avec sa flotte, Doria contrôle la mer. Il ravitaille Marseille à plusieurs reprises en remontant le cours du Rhône jusqu’à Arles et en redescendant sous le feu de l’ennemi, « un secours de mille cinq cents hommes avec toute une flottille de bateaux chargés de vin, de farine et de bestiaux »[v].
Lorsque les Impériaux lèvent le camp de Marseille sous la menace de l’armée royale qui se concentre à Lyon, Andrea Doria ne cesse de harceler la retraite des troupes vers l’Italie, poursuivies par la cavalerie de Montmorency, en réalisant des raids commandos avec ses équipages.

Andrea Doria Sebastiano del Piombo Villa del Principe Palais d’Andrea Doria Gênes
A la fin de l’année 1524, il s’empare de Savone, au nom de François 1er par un hardi coup de main. Puis il s’empare, par un autre raid, de Varazze, située à mi-chemin entre Savone et Gênes, sur la côte ligure. C’en est trop. Hugo de Moncade se trouve justement à Gênes avec les galères de la république dont il prend aussitôt le commandement. Il arrive à Varazze à l’aube. Doria qui attend son ennemi au large, se lance à l’assaut de la flotte impériale, poussé par un vent favorable. Certains navires impériaux parviennent à rejoindre Gênes mais d’autres, sont chassés jusqu’à Nice où ils sont capturés par la flotte de Doria. Parmi les prisonniers, l’amiral Hugo de Moncade lui-même et tout son état-major, qu’Andrea Doria adresse immédiatement à François 1er sous bonne escorte.
Le transport du roi captif en Espagne
Mais pour l’instant, François 1er n’a cure de ces prisonniers car il vient d’être capturé à la bataille de Pavie, le 24 février 1525 et on parle de le transférer en Espagne. D’ailleurs, Hugo de Moncade vient d’être échangé en mars contre le maréchal de Montmorency et l’amiral espagnol, avant son départ de Lyon, a eu une longue conversation avec la régente, Louise de Savoie. Il est arrivé en avril en Italie, ce que confirme à la Régente, une lettre de Montmorency datée du 4 avril.
Que se sont dit la Régente et Hugo de Montcade ? Pourquoi la Régente tient-elle absolument à ce que le roi soit placé sous la surveillance de Lannoy, le vice-roi de Naples et non sous celle de Bourbon, dans le Milanais ? Craint-elle pour la vie de son fils que Bourbon pourrait remplacer ? Car après tout, Bourbon est devenu le premier prince du sang depuis la mort du gendre de Louise de Savoie, Charles IV, duc d’Alençon, le 11 avril 1525.
Le 12 mai, le roi apprend qu’il doit être transféré de sa prison de Pizzighettone à dix-huit lieues au sud-est de Milan, à Gênes, d’où il est prévu de le transférer au château de l’œuf à Naples. Mais Lannoy, chargé du transfert, semble avoir changé d’idée : pourquoi ne pas conduire directement le royal prisonnier en Espagne auprès de l’empereur ? Bien sûr, ce dernier n’est pas au courant, mais pourra-t-il en vouloir à son serviteur d’avoir remis entre ses mains un otage si précieux ? D’autant que le roi peut toujours faire l’objet d’une tentative de délivrance dont les conséquences, heureuses ou malheureuses, causeraient autant de désagréments au geôlier chargé de cette responsabilité ?
Lannoy a donc décidé, sans prévenir Bourbon, de prendre le risque de conduire le roi en Espagne. Il en informe le roi, qui prévient aussitôt la Régente par un message confidentiel, du 12 mai 1525[vi], que Lannoy doit le conduire en Espagne avec quatorze galères et mille cinq cents hommes d’armes, une force qui n’est pas hors de portée des galères françaises sous les ordres de l’amiral et Baron de Saint-Blancard, ajoutées à celles d’Andrea Doria.
Lannoy a dû avoir la même idée car Montmorency vient d’être envoyé par la Régente, fin mai 1525, pour négocier avec Lannoy la remise des galères françaises à Gênes, afin de transporter le roi en Espagne.

Anne de Montmorency vers 1530 Jean Clouet Musée Condé
Que s’est-il passé entre temps ? Il ne faut pas être grand clerc pour se rendre compte que le transport sur la mer, dominée par le grand amiral génois Andrea Doria, au service de la France, est plus que périlleux, que ce soit pour Naples ou pour l’Espagne. Comment se protéger des attaques de Doria, sinon en négociant avec la Régente que le transport se fasse sur des galères françaises ? Lannoy qui n’est pas un grand homme de guerre, est par contre un habile diplomate, proche des cours européennes et de Louise de Savoie, avec laquelle il est en correspondance suivie. Il est très probable que Lannoy ait pu se rendre compte du problème soit en interceptant le courrier adressé par François à la Régente, soit en arrivant par la réflexion aux mêmes conclusions.
Toujours est-il que le 31 mai[vii], la Régente reçoit, à Lyon, un courrier de Saint-Blancard, lequel l’avise avoir déposé à Gênes, suivant ses instructions, le maréchal de Montmorency. Et le 6 juin 1525, ce dernier signe avec Charles de Lannoy, un contrat de mise à disposition des galères françaises[viii], pendant que, très probablement, Louise de Savoie adresse à Andrea Doria un message lui enjoignant de ne pas bouger pour libérer le roi tout en lui assignant une autre mission, celle de rapatrier le corps de sept mille hommes, du duc d’Albany, John Stuart, au service de la France depuis 1524, et expédié par François vers le royaume de Naples, peu avant Pavie : il se trouve actuellement à San-Stephano à cent cinquante kms au nord de Naples. Une mission dont s’acquitte scrupuleusement Andrea Doria qui dépose le corps expéditionnaire en Provence.

Bronzino (dit), Allori Agnolo di Cosimo (1503-1572) Portrait de Andrea Doria en Neptune Pinacoteca di Brera Milan
Pourquoi Louise de Savoie a-t-elle cédé aux pressions de Lannoy ? Car, sans aucun doute, la fougue de Doria aurait permis de s’emparer du prisonnier. Il n’est possible de n’émettre que des hypothèses. La fortune d’un combat naval est capricieuse : le roi pourrait y perdre la vie. Or Louise de Savoie a impérativement besoin de l’autorité du roi pour stabiliser le royaume dont elle sent qu’il commence à lui échapper avec l’affaire des remontrances du Parlement de Paris. Quel argument a pu employer Lannoy pour convaincre la Régente qu’il est le plus sûr allié de l’intégrité de son fils ? A-t-il agité la menace de Bourbon ? A-t-il sous-entendu des menaces imprécises ? A ce stade, la Régente est encore confiante. Elle est convaincue de pouvoir l’emporter par une solide négociation financière avec Charles Quint. Elle ignore que ce dernier est assisté d’un redoutable bretteur, en la personne de son chancelier (Voir l’article sur ce Blog sur Mercurino Gattinara). Elle estime probablement que son fils est trop précieux pour être abandonné à la fortune de mer, après avoir été vaincu par la fortune de terre à Pavie.
Elle exécute donc le contrat signé par Montmorency en donnant instruction à Saint Blancard de conduire les galères françaises à Gênes. Et le 22 juin 1525, la Régente est informée de l’arrivée en Espagne du roi son fils.
Condotta avec le pape Clement VII
Puis, Louise de Savoie autorise Doria, dont elle n’a plus directement l’utilité, à se mettre au service du Pape pour un an moyennant une pension de trente mille écus.
Le roi est à peine libéré, le 13 mars 1526, que la guerre se rallume avec la France qui n’entend pas respecter le Traité de Madrid, imposé par la force. Se forme alors la ligue de Cognac qui regroupe toutes les principautés d’Italie (à l’exception de Naples) et la France, contre les Impériaux. Doria qui est aux côtés du pape Clément VII, a été chargé de circonscrire la ville de Gênes et, si possible, de s’en emparer.
Il effectue un blocus le plus serré possible de la cité, mais il ne peut empêcher l’entrée de quelques navires de ravitaillement, de sorte qu’il échoue dans sa tentative de prendre Gênes par la famine. D’ailleurs, il est rappelé par Clément VII qui, maintenant, ne souhaite plus qu’il s’empare de Gênes, car le pape, toujours indécis, a pris quelques distances avec la ligue de Cognac.
Mais ses doutes par rapport à cette ligue paraissent levés quand Clément VII ordonne à Doria de prendre le commandement des galères pontificales qu’il doit joindre aux forces vénitiennes et françaises pour intercepter la flotte impériale qui se rassemble à Carthagène. Quand la flotte coalisée se regroupe, elle est forte de dix-sept galères. Un conseil de guerre se tient pour déterminer la conduite à tenir. Français et Vénitiens sont d’avis de partir sur Carthagène pour empêcher la flotte de sortir. Doria est d’un avis inverse : l’essentiel n’est-il pas d’empêcher la flotte ennemie de s’approcher de Gênes ? Il faut donc l’attendre sur place. Du reste, la saison, déjà avancée n’est pas favorable aux longues distances maritimes et des espions signalent le départ de la flotte de Carthagène. Elle est forte de trente-six vaisseaux, placés sous le commandement du vice-roi de Naples, Charles de Lannoy.
Pendant que la flotte vénitienne s’attarde à Porto-Venere, les flottes franco-pontificales ont intercepté la flotte espagnole entre la Corse et Gênes. Un coup de canon bien placé, un coup de chance, fait s’effondrer le mat de la galère capitane impériale. Doria se jette entre deux navires de la flotte adverse dont il coule l’un et ravage l’autre. Mais la nuit tombe et avec elle, un vent se lève qui permet la fuite des galères impériales. Lannoy mourra peu de temps après, vers la fin septembre 1527, à Gaëte, remplacé par Hugo de Moncade au poste de vice-roi de Naples.
Lorsque Doria ramène ses galères à Civitavecchia, il apprend avec stupéfaction la mort de Bourbon et le sac de Rome (voir sur ce Blog l’article sur le sac de Rome). Le pape est maintenant au château Saint-Ange, assiégé par les impériaux, lansquenets et Espagnols. Doria hésite sur la conduite à tenir car sa condotta vient de s’achever. Il sollicite l’avis du pape qui, épouvanté de la conduite des impériaux au sac de Rome, le presse de choisir le camp français.
Deuxième condotta avec le roi de France
Doria va alors signer pour un an, une condotta de 36 000 écus avec le roi de France. Il est convenu avec François 1er que Doria appuiera par mer la descente d’une nouvelle armée, conduite par Lautrec, qui doit s’emparer de Gênes.
Doria est alors à la tête de huit galères trirèmes, personnelles. Il commence le blocus de la ville et détruit deux navires qui essayaient de se glisser dans le port. Il est bientôt informé du rassemblement, dans le port de Portofino, d’un convoi de dix gros vaisseaux de grains, escortés de sept galères. Résolu de terminer la guerre par un coup décisif, il se rend à Portofino où il dépose son neveu, Filippino, avec mille-deux-cents fantassins. Le doge Adorno a expédié à sa rencontre Augustin Spinola avec huit cents hommes.

Carte La république de Gênes en 1500 Carte créée avec Euratlas Periodis Expert © Euratlas-Nüssli 2010, tous droits réservés
Bien que les forces adverses soient moins nombreuses, Filippino se fait battre et capturer. Mais le doge a rappelé de toute urgence Spinola à Gênes car des troupes françaises, commandées par un génois, Cesar Fregoso, se sont approchées de la cité. Du coup, Portofino n’est plus défendu et Doria entre dans le port et capture l’intégralité de la flotte, que lui livre la chiourme révoltée. Il revient alors avec ses galères à Gênes où il les fait entrer pendant que Fregoso pénètre par une porte haute, dans la ville. La ville est prise. Adorno, réfugié dans la citadelle, obtient grâce à Filippino Doria, une capitulation honorable.
Le nouveau gouverneur de Gênes est Teodoro Trivulzio, le neveu du condottière milanais, passé au service des rois Louis XII et François 1er, et qui avait conquis Milan pour Louis XII. Il saura se montrer respectueux et adroit et conquérir l’affection des Génois.
Andra Doria profite de son retour à Gênes pour se marier. Il a soixante-deux ans : un âge respectable. Il épouse officiellement Peretta Uzo di Mare qu’il a épousée en secret depuis plusieurs années : il s’agit d’une nièce du pape Innocent VIII, veuve d’Alphonso del Caretto, marquis de Fenaro, Andrea est à table et préside toute l’assemblée lorsque l’on annonce le sire de Langey, Martin du Bellay, qui vient apporter au grand condottiere, sa nomination d’amiral et de chevalier de l’Ordre de Saint-Michel.
Refroidissement entre François 1er et le condottiere
Lautrec informe rapidement Doria que le but de son expédition est la conquête du royaume de Naples. Doria doit prendre la tête des forces coalisées franco-vénitiennes, de douze galères françaises, seize galères vénitiennes et ses huit personnelles soit un total de trente-six galères. La flotte doit s’assembler à Livourne et charger les troupes de Renzo da Ceri, qu’elle doit débarquer en Sicile, pendant que Lautrec part assiéger Naples. Le condottiere émet des doutes quant à la faisabilité de l’opération : l’année est déjà avancée : ne vaut-il pas mieux conquérir la Sardaigne qui dispose de nombreux ports bien abrités où il sera facile de retrancher la flotte en cas de vents défavorables et hiverner ?
Mais Renzo da Ceri est d’un avis bien tranché, opposé à celui de Doria. Finalement la flotte part pour la Corse et de là, gagne la Sardaigne où les vents contraires, la contraignent de rester au port. Il faut radouber. Renzo da Ceri insiste pour que l’on aille à Tunis, qui est proche de la Sicile. Mais Doria ne veut pas remettre sa flotte entre les mains d’un sultan qui pourrait ne pas lui restituer ses navires quand il le demandera. Il choisit de revenir hiverner sur les côtes italiennes, où la flotte se disperse, les Vénitiens rentrant chez eux et les galères royales étant renvoyées à Marseille.

ANDREA DORIA, PRINCE DE MELFI, AMIRAL DES MERS DU LEVANT (1466-1560) par Eugene Goyet Copie d’après un original du chateau de Beauregard Crédit Photo © Réunion des musées nationaux Versailles, Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon
L’amiral est revenu à Gênes avec une galère. Entre temps, il a expédié son neveu, Filippino Doria à Naples, avec sept galères, pour assister par voie maritime, les opérations de Lautrec.
L’amiral génois adresse alors un compte rendu de campagne à François 1er. Mais Renzo da Ceri a également adressé le sien. Il a chargé au maximum Andrea Doria prétendant que ce dernier a refusé catégoriquement d’exécuter les ordres du roi. Le roi va croire Renzo da Ceri ce qui va créer un premier malaise avec le grand condottiere. Ce n’est pas le seul. Il y a l’affaire des vingt-six mille écus du premier engagement de Doria que François, vaincu à Pavie, n’a jamais eu le temps de solder. Et puis, il y a l’affaire de la rançon de vingt-cinq mille écus, du prince d’Orange, Philibert de Chalon, qui n’a jamais été payée, de même que celle d’Hugo de Moncade que la Régente a échangé contre Montmorency sans que le condottiere ne soit indemnisé. Surtout, Doria est convaincu que le chancelier Duprat et le maréchal de Montmorency s’évertuent à travestir auprès du souverain les rapports qu’il lui adresse.
Ses rapports avec François 1er sont une source permanente d’incompréhension mutuelle. Ainsi, le roi équipe une flotte pour venir appuyer les opérations de Lautrec à Naples et en confie logiquement le commandement à son amiral. Ce dernier s’en montre froissé ! Pourquoi ? Nul ne le sait. Il se retranche derrière son âge, lui qui va commander des galères jusqu’à quatre-vingt-huit ans, pour refuser le commandement et il propose au roi de désigner à sa place, son neveu Filippino Doria. Le roi, froissé et qui ne doit pas les mêmes égards au neveu qu’à son amiral, refuse logiquement et nomme Antoine de la Rochefoucauld, sire de Barbezieux, ce qui crée une nouvelle frustration chez Doria qui estime que le roi aurait dû lui proposer à nouveau le commandement.

Antoine de Larochefoucauld Sire de Barbezieux Ecole française Musee du Louvre
En fait Doria en veut terriblement à François 1er de l’amuser avec des hochets (une nomination d’amiral, le collier de l’ordre de Saint-Michel) mais sans exécuter ses promesses financières. A-t-il refusé le commandement que lui propose le roi pour cette raison ? S’est-il vexé qu’au lieu de comprendre à demi-mot ses motifs légitimes, le roi ait décidé de le priver d’un commandement qui lui revenait de droit ?
Le fossé se creuse un peu plus entre le roi et son amiral lorsqu’un espagnol à bord d’un navire arraisonné par la marine française est trouvé porteur d’une lettre de créance d’Andrea Doria auprès de l’empereur. L’espagnol allègue qu’il part à Madrid pour discuter de l’échange de prisonniers. Mais sa présence suspecte, dans ce climat délétère, alimente les soupçons. Le roi, pressé par ses conseillers, au nombre desquels se trouve probablement Montmorency, décide de passer le prisonnier à la question. C’est alors que Doria intervient et parvient à faire fléchir François 1er qui rend un arrêt de grâce. Que le roi ait pu penser à une trahison de son amiral blesse profondément le Génois ou peut-être, celui-ci paraît-il s’en affecter particulièrement. Toujours est-il que cette affaire dresse une barrière supplémentaire dans les relations entre les deux hommes.
Mais le conflit avec François 1er n’a pas qu’une dimension personnelle.
La République et la question de Savone
Pourquoi Doria a-t-il refusé le commandement de la flotte ? Peut-être parce que la cité de Gênes est en ébullition pour se chercher un nouveau modèle d’organisation politique ? Doria, devenu par sa victoire un des hommes qui comptent dans la ville, est en mesure de peser sur les décisions, même s’il se refuse à exercer le pouvoir lui-même. Car, depuis qu’elle est débarrassée des factions des Adorno et des Fregoso, sous la sage administration de Teodoro Trivulzio, nommé maréchal de France en 1526, Gênes respire et recherche désormais la stabilité.
Une liste d’Union de toutes les factions se forme bientôt, appuyée par Trivulzio, persuadé que la fin des factions génoises sera le plus sûr garant du respect de la suzeraineté française. Le 5 septembre 1527, en présence du gouverneur, une commission comprenant huit magistrats et quatre citoyens est constituée pour réformer les lois constitutionnelles de la république. Le gouvernement du peuple a montré pendant plus de cent ans son incapacité à assurer la stabilité de la république. La commission cherche à inverser le rapport de forces en faveur des nobles. Et puis, il y a la question de Savone, dont les Français se sont emparée, qui est administrée séparément par ces derniers et dont les profits ont été accaparés par Montmorency et Duprat.
La Commission fait du retour de Savone dans la république une condition essentielle, et ce, d’autant plus que les Français y ont introduit un port franc, qui commence à concurrencer sérieusement celui de Gênes mais surtout qui constitue un pôle d’attraction pour tout le trafic de la « riviera du ponent »[ix], susceptible de couper la république en deux. C’est un sujet très important pour la survie économique de la république. La commission expédie donc une ambassade à François 1er avec pour mission d’entretenir le roi de la question du retour de Savone à la république. Mais le roi, conseillé par Duprat et Montmorency, qui ont reçu de François 1er l’exploitation des greniers à sel de Savone, apporte une réponse négative.
Diminuée dans son commerce par l’influence montante de Savone, Gênes est atteinte par la peste, en 1527, une épidémie qui va aller croissant et culminer en 1528 avec des ravages qui dépeuplent la cité. Une circonstance qui va avoir d’immenses conséquences imprévues.
Pour restaurer le moral de la cité, il faut recevoir la nouvelle, en avril 1528, d’une grande victoire navale remportée par un autre Doria, Filippino, le neveu du grand condottiere, sur la flotte napolitaine de l’empereur, conduite par le vice-roi, Hugo de Moncade (voir sur ce Blog l’article sur Philibert de Chalon – Le siège de Florence).
Victoire de Filippino Doria à Salerne
On se rappelle que Filippino a été envoyé par Doria à Naples, avec sept galères, qui assurent le blocus de Naples et qui interdisent l’entrée des ravitaillements dans la cité, assiégée par les forces françaises de Lautrec et défendue par Philibert de Chalon, le prince d’Orange.
Hugo de Moncade décide de surprendre les sept galères de Doria avec la flotte napolitaine. Il assemble dans le port de Naples six galères, quatre fustes, six brigantins et un nombre important de petites barques, destinés à donner l’illusion d’une force considérable. Le commandement de la flotte est placé sous les ordres d’un capitaine génois expérimenté, Fabrice Giustiniani. Hugo de Moncade, le vice-roi de Naples, est monté à bord de la galère capitane avec deux cents arquebusiers espagnols.
Le plan de Giustiniani est de reprendre le stratagème d’un Doria déjà, Lucien, à la victoire de Pula contre les Vénitiens (voir l’article sur ce Blog sur Gênes entre insurrection et soumission). Il compte envoyer deux galères en avant-garde, qui vont faire mine de s’enfuir à la vue de la flotte ennemie pour l’attirer vers le gros de la flotte.
Mais Filippino Doria a été prévenu de l’appareillage de la flotte ennemie. Il n’a eu que le temps de mouiller près de l’armée française pour embarquer trois cents arquebusiers, lorsque toute la flotte ennemie se présente, de façon impromptue. Filippino reprend la vieille tactique qui avait si bien réussi à la bataille de la Meloria contre Pise, en 1284 (voir l’article sur ce Blog sur Gênes, l’émergence d’une grande puissance maritime). Il détache trois navires qui ont ordre de cingler rapidement vers la haute mer. Lorsque le combat sera vigoureusement engagé par l’ensemble de la flotte ennemie, ils ont ordre de revenir pour prendre d’assaut les galères napolitaines par derrière.
La bataille est acharnée, sévèrement disputée de part et d’autre. Au moment où deux galères génoises assaillies par six navires napolitains, sont proches de la reddition, Filippino fait donner la réserve qui se rue sur la galère amirale qu’elle pilonne de tous ses canons, jetant à bas son grand mât et blessant Moncade au bras. Ce dernier est bientôt tué par les gabiers situés dans les hauteurs de la voilure, tandis que la galère capitane est coulée. Pour l’emporter définitivement sur les Impériaux, supérieurs en nombre et particulièrement déterminés, Doria est obligé de donner l’ordre de libérer les esclaves barbaresques des équipages ennemis, auxquels on a promis la liberté. Cet appoint va s’avérer décisif. Sur les deux navires génois en péril, la situation est bientôt redressée puis l’assaut est lancé contre les fustes impériales qui sont prises. La bataille de Salerne du 20 mai 1528 a duré quatre heures.
Tous les commandants ennemis sont pris. Font partie des prisonniers expédiés par Filippino à son oncle à Gênes, le commandant de la flotte ennemie, Giustiniani, Ascanio Colonna, le marquis del Vasto (qui connaîtra ultérieurement une brillante carrière de généralissime des armées impériales – voir sur ce Blog l’article sur Vittoria Colonna, sa tante), les princes de Salerne et de Santa Croce, tous les capitaines des galères, une vingtaine de condottieres et plus de trois cents vétérans espagnols.
La rupture avec François 1er
Lorsqu’Andrea Doria reçoit à Gênes les prisonniers de la bataille de Salerne, sa rupture avec François 1er est pratiquement consommée. Aussi ne se presse-t-il pas de procéder à l’échange des prisonniers. Il indique à son neveu, chargé des discussions sur le paiement des rançons avec le nouveau vice-roi de Naples, Philibert de Chalon, qu’il pourrait changer d’allégeance et choisir Charles Quint, si ce dernier lui fait des propositions satisfaisantes. Une information que le vice-roi relaie immédiatement auprès de l’empereur.
Avant de rompre définitivement avec François 1er et preuve sans doute que les véritables motifs de la rupture d’Andrea Doria sont d’ordre politique (ou peut-être veut-il prétendre habiller de motifs politiques une décision d’opportunité personnelle), il adresse un courrier au roi qui n’a pas répondu favorablement à une nouvelle ambassade génoise au sujet de Savone, plaidant la réintégration de Savone à la République. Ce courrier reste une nouvelle fois sans réponse. Il profite du passage par Gênes d’un envoyé pontifical qui va rencontrer le roi pour le féliciter de sa victoire de Salerne, pour le sensibiliser à la question de Savone. Mais il n’obtient pour toute réponse du roi que l’ordre de lui remettre ses prisonniers Ascanio Colonna et le marquis del Vasto.
Mais Lautrec, qui participe avec Filippino aux négociations avec le prince d’Orange pour le paiement des rançons, est rapidement informé de la possible défection du grand condottiere. Il envoie aussitôt le sire de Langey, Martin du Bellay auprès du roi avec mission de s’arrêter à Gênes pour convaincre Andrea Doria de ne pas quitter le service de la France. Ce dernier, secrètement ravi de trouver un tel ambassadeur, lui déclare que si François 1er lui règle les sommes qu’il lui doit et restitue Savone à la république de Gênes, il restera au service de François 1er.
Du Bellay part alors sur Paris où réside le roi à ce moment. Les propositions de Doria sont discutées au Conseil du roi qui ne les trouve ni raisonnables, ni acceptables. La sentence tombe, racontée par Martin du Bellay, qui participe au conseil : « Toutes choses débattues, fut conclu de depescher le seigneur de Barbezieux pour aller à Gennes, se saisir tant des galères du roi que de celles d’André Dorie, le faisant Amiral sur la mer du Levant et destituant André Dorie, et, s’il voyoit l’occasion, qu’il se saisist de la personne du dit Dorie »[x].
Il est certain que le roi n’a d’abord pas envisagé que la revendication du condottiere ne puisse être, autre chose qu’une négociation privée. Aussi, les interventions d’Andrea Doria sur des sujets qui ne le concernent pas, comme la façon d’administrer par la couronne, des territoires sous son contrôle, sont-elles, au début, très mal reçues à la Cour.
Toutefois, le 1er juillet 1528, François 1er signe un décret par lequel Savone est restituée à la ville de Gênes ? Le roi s’est-il rendu compte de son aveuglement sur Savone ? Ou au contraire, cherche-t-il à éviter le pire avec Doria ? Car les ambassadeurs génois à Paris ont adressé un courrier le 26 juin à la Commission des douze à Gênes, par lequel ils font savoir que « la sérenissime Régente » (Louise de Savoie en reconnaissance de son rôle pendant la captivité du roi a été autorisée à conserver son titre), était favorable à la restitution de Savone pour contenter Doria.
D’un autre côté, si Doria revendique haut et fort Savone alors que la ville est déjà rendue à Gênes, n’est-ce pas pour se grandir aux yeux de ses concitoyens d’une aura qu’il ne mérite pas ? Ce qui est certain, c’est qu’au moment où le roi prend sa décision, le 1er juillet, il est trop tard pour rattraper Doria, qui a déjà décidé d’offrir ses services à Charles Quint. Le récit de Martin du Bellay est-il orienté ? Car finalement, la restitution de Savone montre que les ambassadeurs génois ont été entendus. Alors, pourquoi prétendre que le roi a donné l’ordre d’arrêter Doria si ce n’est pour justifier une décision de rupture du grand condottiere ? Quelles sont les relations entre Du Bellay et Doria ?
Car la décision de François 1er est irrévocable et non sujette à caution. Il écrit en effet le 11 juillet à sa bonne ville de « Gennes »: « en suivant les supplications et requestes que vous avez par ci-devant, fait faire tant par vos députés que autres et aussi à la très instante prière et requeste de notre très chere et très sainte dame et mere, Nous vous avons accordé la restitucion entre vos mains de notre ville de Savone, ensemble les commerces (sel) et tout le reste du revenu d’icelle. Dont nous avons fait expédier nos lettres patentes en forme et pareillement vous avons confirmé vos privilèges ansi que vous pourrez voir, (…) Françoys » (lettre inédite retrouvée aux Archives d’Etat à Gênes).
Pourquoi Doria confond il ainsi dans sa revendication, deux sujets, a priori très éloignés l’un de l’autre : le rétablissement de Savone dans la république et ses intérêts personnels ? Il est probable qu’il en veut personnellement à François 1er de n’avoir pas respecté ses promesses de rançon sur les captures du prince d’Orange et d’Hugo de Moncade qui ne semblent cependant pas avoir reçu de traduction écrite. Mais en droit féodal, nul besoin d’un écrit pour certifier le droit d’une rançon: là se situe sans doute la faille initiale entre les deux hommes. C’est sans doute ce qui explique qu’il se sente froissé par les décisions de François 1er sur le commandement de la flotte: il espère que le roi se rendra compte que c’est un refus diplomatique pour lui rappeler ses obligations. Mais le roi, loin de réagir par rapport à ce que cherche à lui rappeler son condottiere, se montre froissé: le roi-chevalier sait-il d’ailleurs réellement ce que lui réclame Doria ? Car ses conceptions toutes chevaleresques, le portent naturellement à reconnaître une dette d’honneur: les échanges de prisonniers sont en effet très fréquents entre vassaux et suzerains.
Personnage privé soucieux uniquement de ses intérêts, Andrea Doria est devenu malgré lui, un personnage public. Il ne peut prendre une décision d’opportunité personnelle sans que celle-ci ne paraisse dictée par l’intérêt général.
Lorsque Barbezieux arrive à Gênes infestée par la peste, avec la flotte de secours pour Naples, il ne trouve pas Andrea Doria qui s’est retiré avec ses galères. Comment Andrea Doria est-il au courant de la décision du conseil ? A-t-il été informé par Martin du Bellay ? Toujours est-il qu’il fait répondre à Barbezieux qu’il n’est pas disposé à le rencontrer car il sait bien qu’il a reçu l’ordre de l’arrêter mais il lui remettra sans difficulté, les galères françaises. Parti de Gênes après avoir exécuté partiellement sa mission, Barbezieux amène à Lautrec à la fois les renforts promis et la peste, emportée de Gênes par l’un ou l’autre de ses marins, qui va décimer, en trois mois, les trente mille hommes de l’armée française qui fait le siège de Naples.
Andrea Doria au service de Charles Quint
C’est alors que le marquis del Vasto propose à Doria de s’entremettre auprès de l’empereur pour négocier un contrat satisfaisant pour Doria et pour la république de Gênes. L’astucieux général a en effet bien compris qu’il est possible de transformer la défaite de Salerne en une grande victoire, par la perte de la souveraineté française sur Gênes.

Marquis del Vasto par Le Titien Galerie des Offices
Doria donne alors à son neveu, Filippino, l’instruction de quitter le service de la France et de prendre le large avec sa flotte, après avoir approvisionné la ville de Naples. Ces dispositions ont pour but de faciliter la transaction en cours entre Doria et l’empereur à Madrid.
Del Vasto a en effet adressé à Charles-Quint, le 19 juillet 1528, des lettres relatives à cette importante négociation. Doria expédie alors son neveu, l’abbé de Néro, pour négocier avec l’empereur les termes de l’accord, qui est signé dès le 10 août 1528. Il est essentiel d’aller rapidement pour détacher définitivement Doria du roi de France, car on a eu connaissance à Madrid de la restitution par François 1er de Savone à Gênes.
Il est convenu que si Doria réussit à arracher Gênes à la France, l’empire garantisse à la ville son indépendance et ses anciens territoires, notamment la ville de Savone. Alors que Savone est déjà restituée à la république, depuis le 1er juillet, cette question est traitée dans l’accord particulier avec Doria, preuve, sans doute que ce dernier cherche à habiller une décision personnelle de motifs généraux et d’intérêt général.
Cette défection du grand amiral génois intervient au plus mauvais moment pour la France car elle va apporter un soutien décisif à la victoire de Charles Quint en Italie, sur son rival français. François 1er a une incroyable propension à se fâcher, au plus mauvais moment possible, avec les grands stratèges qui auraient été utiles à sa grandeur : le connétable de Bourbon, le prince d’Orange, Philibert de Chalon et maintenant Andréa Doria, le plus grand amiral du seizième siècle.
Pendant qu’à Naples, l’armée française rapidement décimée par la peste, est culbutée par les forces impériales (voir sur ce Blog l’article Philibert de Chalon le siège de Florence), à Gênes, Doria conduit l’insurrection contre la France.
Le 9 septembre 1528, Andrea Doria arrive en vue de Gênes avec treize galères. Il accorde la liberté à trois cents vétérans espagnols capturés à Salerne et les organise en vue de leur débarquement. Teodoro Trivulzio, à la vue de ces préparatifs menaçants, a demandé de l’aide au capitaine des troupes générales françaises en Lombardie, le comte de Saint Pol. Mais ce dernier ne peut distraire aucun contingent de ses maigres effectifs.
Dans la nuit du 10 septembre, Doria débarque ses troupes, l’une sous le commandement de Filippino Doria, près de la villa Santi, dans le quartier de Carignano, et l’autre, sous celui de Lazare Doria, par la porte de Giaretta, près du môle. Les deux troupes convergent dans Gênes, vers le palais de la seigneurie. Toutes les portes sont rapidement contrôlées. Le succès est complet.
Doria n’a plus qu’à réclamer la constitution d’un gouvernement d’union susceptible d’organiser la pacification définitive de la république, tourmentée depuis trois siècles, par ses divisions internes.
Le 12 septembre 1528, au lendemain de la prise de Gênes aux Français, par ses marins, Andrea Doria, âgé de soixante-quatre ans, aurait parfaitement pu s’emparer à son nom de la seigneurie de Gênes. Nul ne s’y serait opposé. Mais l’ambition de Doria n’est pas celle d’un administrateur. Ce qu’il aime, avant tout, c’est la vie d’aventurier, le pont de ses navires, l’air du grand large. Il aspire à la gloire. Pour peu que le gouvernement en place à Gênes ne se mette pas en travers de ses intérêts il est indifférent à celui qui en exercera la charge.
La réforme constitutionnelle de la République
Du reste, il va s’arranger pour détenir les leviers du pouvoir effectif sans exercer lui-même la plus haute fonction, suivant ainsi l’exemple de Cosme de Médicis à Florence (voir l’article sur ce Blog sur les Médicis de 1400 à 1600). La convention signée avec Charles Quint, qui reconnaît l’indépendance de Gênes dans le saint Empire, n’est-elle pas passée entre Andrea Doria et l’empereur ? Ce dernier considèrera toujours le fidèle serviteur qui lui gagne des batailles navales comme le véritable représentant de Gênes.
D’ailleurs, peu après la réforme constitutionnelle, Doria va acquérir le titre de « censeur perpétuel » de la république, qui lui donnera autorité en fait, sinon en droit, sur tous ses concitoyens.
Car ce qui préoccupe notre condottiere et la ville de Gênes c’est la mise en application de la grande réforme constitutionnelle de la république voulue par les douze sages de la commission pour l’Unité. Le 13 septembre 1528, après avoir voté dans l’allégresse l’indépendance de Gênes par rapport à la France et le gouvernement républicain proposé par le capitaine Doria, l’administration de la cité et le soin de ses intérêts sont confiés à la Commission des Douze Réformateurs, dont les pouvoirs sont prorogés de six mois, pour mener à bien leur réforme.
Ces lois constitutionnelles de 1528, sont visiblement inspirées des opinions aristocratiques et autoritaires, développées par Andrea Doria. La première démarche est de recenser les plus importantes familles nobles ou plébéiennes ayant plus de six maisons dans Gênes (les « alberghis » ou « hôtels »), en veillant à écarter de cette liste, les familles Fregoso et Adorno, dont les disputes ont provoqué l’instabilité institutionnelle de la cité pendant si longtemps. Puis, on loge, pêle-mêle, dans l’un des vingt-huit hôtels, tous les citoyens d’une quelconque importance d’origine plébéienne, qu’ils soient guelfes ou gibelins, partisans des Adorno ou des Fregoso. Enfin, l’on déclare « nobles » tous les membres de toutes les Alberghis, y compris l’hôtel formé de citoyens plébéiens importants.
On déclare alors que le doge et les magistrats de la ville seraient issus de ces vingt-huit hôtels exclusivement et que les plébéiens seraient définitivement exclus du gouvernement de la ville.
Le doge, au lieu d’être désigné à vie, sera désormais élu tous les deux ans et il sera assisté par un gouvernement de huit Gouverneurs et un conseil de quatre cents membres. Ce dernier est choisi chaque année parmi les vingt-huit familles nobles. Il élit chaque année, parmi ses membres, les cent personnes du « Petit Conseil ». Le doge et les Gouverneurs forment ce qui est dorénavant désigné comme « la Seigneurie ».
Les élections dogales sont réalisées dorénavant par des grands électeurs. Le Petit Conseil choisit tous les deux ans, un citoyen parmi chacune des vingt-huit familles nobles. Ce comité des vingt-huit en élit à son tour dix-huit autres et les quarante-six ainsi constitués, proposent quatre candidats à l’élection du Doge, suivant les votes du Grand Conseil, en choisissant celui des quatre candidats ayant obtenu le plus de suffrages.
Un Tribunal de cinq Censeurs est nommé pour juger, à l’issue de leur mandat, des actes commis par les magistrats pendant l’exercice de leurs fonctions, et pour les punir en cas de faute. Parmi les cinq censeurs, l’un est nommé à vie, Andrea Doria, désigné « censeur perpétuel ». Andrea Doria et ses parents et neveux sont exemptés à vie de l’impôt, se voient attribués une maison dans le centre de la cité et une statue est votée dans l’allégresse pour le grand libérateur, statue qui sera exécutée par Fra Angelo da Montorsoli (qui sera également le sculpteur de la tombe du condottiere à l’église San Matteo à Gênes).
Une fête nationale en faveur de l’Union sera désormais organisée pour le 12 septembre de chaque année pour commémorer la libération de la ville par Andrea Doria et l’union des citoyens. Cette fête va perdurer jusqu’en 1796.
Andrea Doria grand libérateur ? Voire ! La réforme de 1528 est tout sauf une réforme démocratique. Elle a pour objectif d’imposer la domination d’une classe sur une autre, des nobles sur les plébéiens. Mais le condottiere, très habilement, en ne prenant pas le pouvoir, a réussi à gagner la bataille de la communication.
L’éviction finale des troupes françaises de Gênes
Car la ville, bien qu’elle se considère indépendante de la France, conserve toujours une garnison de trois mille Français, retranchés, sous le commandement du maréchal Teodoro Trivulzio, dans la citadelle. On se rappelle que Trivulzio avait demandé de l’aide au comte de Saint-Pol, capitaine des armées royales en Milanais, qui faisait alors le siège de Pavie. Ce général voulait d’abord conquérir la cité avant de se rendre à Gênes. Lorsque Saint-Pol se présente par le défilé de la Polcevera, Doria a eu le temps de renforcer les défenses de la ville en faisant revenir de Corse, sept-cents fantassins. Compte tenu des nobles qu’il a mobilisés, il affiche une force de huit-mille combattants.
Il expédie son neveu, Filippino, à la tête d’un important détachement, pour harceler Saint-Pol dans les montagnes, lequel parvient cependant à passer. Arrivé sur la plage de San-Pier-d’Arena, Saint-Pol expédie un héraut pour procéder aux sommations d’usage. Doria procède alors à une antique ruse de guerre : on fait passer le héraut par des rues où se sont massés les défenseurs de sorte que Saint-Pol est trompé sur l’état réel des forces des Génois. Il plie bagages. Trivulzio, abandonné par Saint-Pol est dans l’obligation de capituler. Il obtient de Doria des conditions très favorables : il peut se retirer avec armes et bagages, l’étendard royal en tête.
Reste à reconquérir les cités et places fortes entre les mains des Français dont Savone, que la révolte de Gênes n’a pas permis de mettre en position d’une récupération pacifique. Il faudra une armée commandée par Sinibaldo Fiesco avec l’appui de la flotte de Doria, pour en venir à bout, en 1529. Après sept jours de siège et une réponse négative de Saint-Pol à ses appels à l’aide, le défenseur français de la place, le sire de la Morette, obtient des conditions de capitulation aussi généreuses de la part de Doria que celles obtenues par Trivulzio.
Puis un conseil de guerre se tient pour déterminer comment punir la révolte de Savone. Il y a les partisans de la méthode dure qui veulent un sac de la ville. Il y en a d’autres, dont l’avis finit par prévaloir, qui réclament d’abattre la puissance de Savone en détruisant son port et en rasant ses murailles. Savone ne se relèvera que trois siècles plus tard de ce coup porté à sa prospérité.
Andrea Doria a juste le temps de faire reconstruire son palais de Fassuolo[xi] qu’il est appelé par l’empereur qui doit se rendre à Bologne pour se faire couronner par le pape Clement VII, selon l’antique procédure de Charlemagne. Charles Quint est devenu en effet le maître incontesté de l’Italie par l’anéantissement des Français de Lautrec par le prince d’Orange et la capture de la dernière armée française en Italie, du comte de Saint-Pol, par le général navarrais don Antonio de Leyva.

Villa del Principe – Salon des Géants
Par la paix des Dames, signée le 5 août 1529, négociée à Cambrai entre Marguerite d’Autriche et Louise de Savoie, qui se substitue au Traité de Madrid, la France a abandonné à l’empire tous ses droits en Italie.
Doria doit se rendre à Barcelone avec treize galères, magnifiquement armées et décorées, pour embarquer l’empereur à destination de l’Italie.
A son arrivée à Barcelone, pour sa première rencontre avec l’empereur, le condottiere s’est habillé sobrement. Il s’agenouille devant Charles Quint et lui adresse quelques mots : « Très puissant prince, comme je préfère, de loin, les actes aux paroles, je parlerai peu et j’agirai beaucoup. Je puis assurer à votre majesté qu’en dévoué serviteur, je me disposerai avec diligence et fidélité à exécuter tout ce qui me paraîtra utile à votre service, tout ce qui pourra contribuer à votre grandeur, que je désire voir s’établir »[xii].
Le 12 août 1529, toute la flotte impériale arrive à Gênes qui fait à l’empereur un accueil enthousiaste. Charles Quint va séjourner à Gênes, d’où il va gouverner l’Europe, pendant quarante-quatre jours, qui coûteront à la cité 1 000 écus par jour. Doria va bénéficier de cet effort financier de la cité, en recevant de l’empereur, le collier de la Toison d’or, une prime de vingt-cinq mille écus et la nomination de prince de Melfi, un titre du royaume napolitain récupéré sur Jean Caraccioli, grand sénéchal du royaume de Naples, passé au service du roi François 1er, qui va être déchu de tous ses titres et biens en Italie et qui va poursuivre une brillante carrière de maréchal de France.
Pour l’empereur Charles Quint qui voit loin, le retournement d’Andrea Doria constitue un atout maître dans le cadre de son affrontement de géants avec l’empire ottoman. Il faut donner au génie des batailles maritimes un statut tel que l’on puisse tenir pour assurée, sa fidélité dans les prochaines opérations contre les Turcs. Raison pour laquelle l’empereur va abreuver d’honneurs son terrible capitaine en le désignant tour à tour, grand amiral de Castille, grand chancelier du royaume, marquis de Tursi et prince de Melfi.
_______________________________________
[i] Cet article est rédigé à partir des sources suivantes : « l’Histoire de la république de Gênes », Volume 1 et Volume 2 par Emile Vincens. Un autre ouvrage a été consulté, « l’Histoire De La République De Gênes » Volume 1 et Volume 2, par Louis de Mailly. Concernant plus précisément Andrea Doria, l’article s’est appuyé sur : « Andrea Doria, un amiral condottiere au XVIème siècle » par Edouard Petit, Compagnie générale d’impression et d’édition Paris 1887 et sur « Vie d’Andre Doria, prince de Melfi » par M.Richer à Paris chez Belin 1789. Les questions historiques ont été contrôlées avec l’ouvrage du grand spécialiste de François 1er, François Auguste Mignet dans « Rivalité de François 1er et de Charles Quint ». Les lettres relatives à la captivité de François 1er et à son transfert en Italie ont été extraites de l’ouvrage d’Aimé Champollion Figeac « Captivité du roi François 1er »
[ii] Voir l’article Wipedia sur Jean della Rovere.
[iii] Il a proposé d’aider le cardinal Wolsey à obtenir la tiare aux prochaines élections pontificales. Voici ce qu’en rapporte le grand historien Mignet dans son ouvrage « Rivalité de François 1er et de Charles Quint » T1 : « Le roi très chrétien m’a chargé de vous écrire, mandait au cardinal d’York, Sir Thomas Boleyn, que si vous aspirez au Saint-Siège, il peut vous assurer quatorze cardinaux. Des deux partis en présence, les Colonna et les Orsini, il vous donnera les Orsini… Il est convaincu que le roi d’Angleterre et vous ne font qu’un et que nul ne peut être empereur ni pape, si cela ne plaît à tous deux ».
[iv] Mignet page 518.
[v] « Andrea Doria, un amiral condottiere au XVIème siècle » par Edouard Petit, Compagnie générale d’impression et d’édition Paris 1887 page 76, citant un article de Mignet dans la Revue des deux Mondes.
[vi] Lettre du 12 mai 1525, page 180, «Captivité du roi François 1er »par Aimé Louis Champollion-Figeac.
[vii] « Captivité de François 1er » page 181. Lettre de Saint-Blancard à la Régente.
[viii] « Captivité de François 1er » page 212. Contrat de prêt des galères françaises.
[ix] La « riviera du ponent » est la région à l’ouest de Gênes qui va jusqu’à Monaco.
[x] Mémoires de Martin du Bellay, rapportés par Edouard Petit page 89.
[xi] Son palais de Fassuolo se trouve en effet à l’extérieur des remparts de Gênes et le comte de Saint-Pol a formé le projet de s’emparer de Doria par un raid surprise, de deux milles fantassins et cinq cents cavaliers. Mais les soldats qui veillent de nuit à la villa, ont entendu des bruits de troupe. Ils avertissent Doria qui peut s’enfuir. Les Français vont se venger sur le palais qui est détruit de fond en comble.
[xii] « Andrea Doria, un amiral condottiere au XVIème siècle » par Edouard Petit, Compagnie générale d’impression et d’édition Paris 1887, page 129.

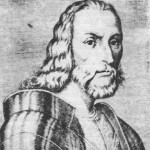







[…] d’une grande puissance maritime, Gênes, entre insurrection et soumission, Andrea Doria, amiral de François 1er, les tarides), nous poursuivons avec cet article, le survol des activités génoises à travers un […]