Lorsque les Génois viennent s’implanter en 1275 sur le site de l’ancienne Theodosia grecque, en Tauride (Crimée) sur la mer noire, la ville dont il ne reste que des ruines, ne porte plus ce nom depuis déjà plus de trois cents ans, mais celui de Caffa, dont tous ignorent l’origine. L’empire Byzantin s’est maintenu dans la partie occidentale de la Chersonèse Taurique (péninsule de Crimée) jusqu’au milieu du onzième siècle. La région passe brièvement sous le contrôle des Coumans avant de céder aux Tatars du Khanat de la Horde d’Or, qui s’y installent en 1249, à peine vingt-six ans avant les Génois.

Carte Pourtour de la mer noire et mer d’Azov Cosmographie universelle Folio 36 Service historique de la Défense, D.1.Z14 BNF
L’implantation des Génois à Caffa en 1275
Les commerçants génois qui se sont installés à Pera (Constantinople) à partir de 1267, ont com mencé à fréquenter Soldaïa (Soudak), vieille cité byzantine en Crimée occidentale. Mais, entrés en concurrence avec les Vénitiens, ils obtiennent du Khan mongol vers 1270-1275, le droit de s’établir dans la baie de Théodosia, à côté d’une petite bourgade indigène. Quelques marchands s’y fixent, bientôt rejoints par des compatriotes. Très vite, il faut donner à la jeune colonie une organisation administrative : dès juillet 1281, est mentionné un consul génois de Caffa.
A peine quinze ans après leur installation, les Génois sont déjà plusieurs milliers à Caffa, qui s’affirme immédiatement commer une mosaïque poly-ethnique où se côtoient des Turco-Tatars, des Syriens, des Juifs, des Russes, Géorgiens et Alains, des esclaves circassiens, lazes, abkhazes et coumans.
Tout paraît indiquer que la cité est alors entourée d’un fossé et d’un remblai de terre garni d’une palissade, interrompue à l’emplacement de l’unique porte de la ville. Il n’y a donc pas lieu de s’étonner que les Génois, mal protégés par cette enceinte de terre et de bois, n’aient pu résister longtemps aux armées tatares et aient été obligés d’abandonner leur comptoir en 1307.
En 1307, en effet, les Génois, assiégés par les armées tatares de Toqtaï, khan de la Horde d’Or (1290-1312), abandonnent Caffa, non sans l’incendier avant leur départ. Lorsqu’ils obtiennent du Khan Öz Beg Khan (1313-1341) (installé dans la ville de Qirim, que les Italiens nomment Solcata, et qui a fini par donner son nom « Crimée » à toute la région), l’autorisation de revenir, une commission appelée « l’Officium Gazarie » prend le 18 mars 1316 toute une série de mesures pour favoriser la reconstruction du comptoir.
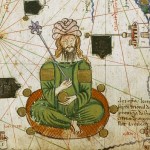
Le Khan de la Horde d’Or Atlas catalan (détail de l’Asie occidentale : mer Caspienne et golfe Persique) Attribué à Abraham Cresques, 1375.
Manuscrit enluminé sur parchemin, 12 demi-feuilles de 64 x 25 cm chacune
BnF, département des Manuscrits, Espagnol 30, tableau IV
La reconstruction : L’ordo de Caffa
Cet « ordo de Caffa« , véritable plan d’occupation des sols médiéval, qui pose les bases du développement urbanistique de la ville, mentionne les églises des Grecs, des Arméniens et des Russes, qui seront préservées ; les autorités génoises reconnaissent donc que des éléments d’origines diverses se sont maintenus après 1308, et qu’il importe de reconstruire la ville et de mener la colonisation en évitant de heurter les populations locales et avant tout leurs chefs spirituels.
Aussi lorsque, quelques années plus tard, « l’Officium Gazarie » organise le relèvement de Caffa, il distingue deux zones : l’espace entouré de murs et l’ensemble du territoire se trouvant hors des murs, mais à l’intérieur des limites de Caffa, ce qui laisse entendre que le Khan Ozbek avait fixé une borne précise à l’extension du comptoir génois. La première zone correspond à la superficie de l’ancienne colonie, avant la destruction de 1308, et elle enferme la citadelle, ou castrum, qui comprend encore des terrains non bâtis en 1344.

Cosmographie universelle, selon les navigateurs tant anciens que modernes / par Guillaume Le Testu, pillotte en la mer du Ponent, de la ville francoyse de Grâce Service historique de la Défense, D.1.Z14
La ville génoise déborde très vite cette première enceinte et Caffa voit se développer dans la première moitié du XlVe siècle une « civitas« , quartier peuplé, regroupant la plupart des bâtiments publics. Entouré de levées de terre et de palissades en bois dans les premières années suivant la reconstruction de Caffa, ce quartier est relié à la citadelle par une enceinte de pierre, à partir des années 1340. Cette ligne de murailles est progressivement fortifiée de tours, à l’érection desquelles contribue le pape Clément VI, et est achevée par le consul Gotifredo di Zoagli en 1352. Elle constitue donc l’enceinte intérieure, longue de 718 mètres et qui devait permettre aux Génois de résister par deux fois aux assauts des Tatars (quatre hectares).
D’après un article de Michel Balard sur le site Persee, Ibn Battuta, de passage à Caffa en 1340 parle « d’une grande cité qui s’étend sur les bords de la mer et qui est habitée par des Chrétiens, la plupart, Génois« . Il mentionne « de beaux marchés, un port admirable où il voit plus de deux cents vaisseaux tant bâtiments de guerre que de transport, petits ou grands« . Selon le même article, le voyageur allemand Johann Schiltberger dénombre six mille maisons dans la première enceinte et onze mille hors les murs. Selon les données fiscales de la ville, le nombre d’esclaves serait à l’époque de cinq cent-trente, soit une population globale de vingt mille habitants si le taux d’esclave par famille (3%) est le même qu’à Gênes à la même époque.
L’enceinte de 1352 se révéla vite insuffisante. Au-delà s’étaient formés des bourgs où quelques Occidentaux côtoyaient une majorité d’Orientaux attirés par l’essor de la ville. Entre 1383 et 1385, c’est-à-dire au moment où se détérioraient les relations de Caffa avec le seigneur de Solgat, les trois consuls successifs, Pietro Cazano, Jacopo Spinola et Benedetto Grimald, font construire l’enceinte extérieure pour protéger les bourgs. Précédée de fossés et pourvue de barbacanes, la longue ligne de muraille se développe sur près de cinq kilomètres et demi, dessinant un arc de cercle autour de l’enceinte intérieure à laquelle la relient les fortifications littorales englobant une surface de 240 hectares environ. Dans l’angle nord, à l’endroit où l’enceinte se détache de la côte, une tour massive, celle de Saint-Constantin semble avoir été achevée au début du XVe siècle.

Caraque Plutarchi apophthegmata : interprete Francisco Philelpho Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Latin 6142 Folio 13v
La ville de Caffa est en expansion constante dans tout le XIVème siècle car elle draine les produits vivriers de la mer noire qui sont ensuite exportés vers Pera à Constantinople et les produits de la route de la soie, qui sont exportés vers Gênes et l’Italie. Il faut six mois pour un navire au départ de Gênes, pour arriver à Caffa et revenir à Gênes, y compris deux semaines à Caffa.

Asie occidentale : mer Caspienne et golfe Persique Atlas catalan Attribué à Abraham Cresques, 1375. Folio 18 Manuscrit enluminé sur parchemin, 12 demi-feuilles de 64 x 25 cm chacune BnF, département des Manuscrits, Espagnol 30, tableau IV
Comme le remarque Chardin, cité par l’article de Keram Kevonian, à la fin du XVIIe siècle, «la rade de Caffa est à l’abri de tous les vents, excepté du nord et du sud-ouest. Les vaisseaux y sont à l’ancre assez proche du rivage, à dix ou douze brasses, sur un fond limoneux qui est bon et bien assuré». L’article poursuit ainsi la description du port, qui « s’étendait en avant de la civitas. A partir de la place du palais communal, l’on y accédait par deux portes, « l’hosteum marine magnum » et « l’hosteum parvum » , cette dernière s’ouvrant près du portique de la cour du consul. En avant des portes, était installés, sur des pontons, la douane et le pesage, qui donnent leur nom à l’une des taxes perçues à Caffa, l' »introytus pontis et ponderis ». En bordure de mer, comme à Gênes, une « rippa » voûtée, bordée de portiques, où se rencontrait une foule bigarrée. Galères, galiottes et brigantins étaient mis en chantier non loin, soit près de la loge de l’octroi, soit dans des docks où l’on tirait les navires à sec, pour les abriter pendant la mauvaise saison. Un phare dédié à saint Antoine dominait le port« .
Organisation de Caffa génoise
Les règles d’urbanisme contenues dans « l’ordo de Caffa » laissent entendre que la population d’origine occidentale serait incitée à s’établir plutôt dans la ville haute, dans le castrum ou la civitas, tandis que les communautés orientales trouveraient asile surtout dans les bourgs. Y aurait-il coexistence et opposition de deux villes, à l’intérieur du comptoir ? En fait, ces règles ont été bien vite oubliées et la cohabitation des diverses ethnies s’est réalisée sans grande difficulté. L’on voit dès 1290 un Grec habiter la même demeure qu’un Syrien, l’évêque de Soldaïa et le Génois Luchino dell’Orto.
Caffa est divisée en « contrade« , qui rappellent les « conestagie » génoises : cellules urbaines d’un groupe ou d’un clan, petits mondes clos isolés du reste de la cité avec leurs maisons tournant le dos aux autres quartiers pour s’ouvrir sur la rue principale de la « contrada » ou sur une petite place, centre de la vie commune.
A Caffa, soixante « contrade » ont pu être dénombrées, soit autant qu’à Gènes : neuf dans les bourgs, une hors des bourgs, le reste dans la civitas et le castrum, une institution typiquement génoise, adoptée de préférence, mais non exclusivement, dans les quartiers où les Occidentaux dominent. La moitié de ces contrade porte le nom de l’église érigée en leur centre.
La « civitas« , elle, abrite les principaux bâtiments publics. Un grand palais est tantôt qualifié de «palais des consuls génois de Caffa», tantôt de «palais de la Commune de Caffa», comprend une salle d’audience où le consul rend ses sentences. Le palais s’ouvre sur une place par une loggia, où les autorités de Caffa rendent aussi la justice et par une terrasse où viennent instrumenter les notaires au coucher du soleil. A l’intérieur de l’édifice, se trouve une cour bordée d’un autre portique où siège parfois le consul.
A la fin du XlVe siècle, les Latins disposent au moins de vingt-deux églises, les Grecs de treize églises et les Arméniens, de trois églises. Du côté des non-chrétiens, les lieux de culte sont beaucoup moins connus. Au témoignage de Iohan Schiltberger, la communauté juive aurait possédé dans la ville même, deux synagogues au début du XVe siècle et les Tatars auraient disposé de deux mosquées, ainsi que d’un cimetière musulman, attesté dès la fin du XlIIe siècle.

Caffa et la Gazarie génoise en 1400 Carte créée avec Euratlas Periodis Expert © Euratlas-Nüssli 2010, tous droits réservés
En 1475, Caffa devient Kefe
A à partir de la chute de Constantinople en 1453, le port de Caffa sera administré par la Banque de Saint-Georges, et la ville est conquise par les Ottomans en 1475. Entre 1453 et 1475, une longue décadence se poursuit dont la conquête par les Ottomans, en 1475, ne sera que le point d’aboutissement.
Les assiégeants firent usage de l’artillerie contre la place génoise, mais le siège n’excéda pas cinq jours au bout desquels, pour reprendre l’expression des chroniques ottomanes, les habitants demandèrent « l’aman » , c’est-à-dire qu’ils se rendirent et que la ville ne fut donc pas occupée par la force. Les Grecs et Arméniens qui s’y trouvaient, soucieux d’éviter les représailles des Turcs dont la victoire finale ne leur semblait pas douteuse, et de ménager leur avenir dans le nouvel ordre établi par les vainqueurs, jouèrent un rôle décisif dans cette capitulation : ils y contraignirent leurs maîtres génois sous peine de les massacrer.
L’article extrêmement documenté de Kéram Kévonian et Matei Cazacu souligne enfin que les Ottomans ont conservé à l’ancienne capitale de la « Gazarie génoise« , son caractère de chef-lieu politique et administratif : Kefe, qui se substitue à Caffa, donne son nom à une province de l’Empire Ottoman, le « livâ’ de Kefe » qui comprend le sud-ouest de la Crimée, les anciens «casaux de Gothie», ainsi que la ci-devant seigneurie de Theodoro-Mangoup et, à l’est de Kefe, les enclaves de Kers et Taman commandant le Bosphore cimmérien (ou détroit de Kertch) ; il s’y ajoutait deux places sur la mer d’Azov : Azaq (l’ancienne Tana des Génois et Vénitiens) au débouché du Don et Temruq sur le Kouban.
_____________________________
[i] Cet article est issu principalement d’un article de Michel Balard « Continuité ou changement d’un paysage urbain: Caffa génoise et ottomane » In: Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public. 11e congrès, Lyon, 1980, Le paysage urbain au Moyen- Age. pp. 79-131, sur le site Persee. Voir également l’article de Kéram Kévonian et Matei Cazacu « La chute de Caffa en 1475 à la lumière de nouveaux documents » In: Cahiers du monde russe et soviétique. Vol. 17 N°4. Octobre-Décembre 1976. pp. 495-538. Voir enfin l’article « Caffa, port d’extrême Europe » par Vincent Capdepuy du site Histoire Globale.
Laisser un commentaire