Jean de Médicis fut le dernier des Condottiere. L’arrivée de l’artillerie et des nouvelles armes à feu changea radicalement l’art de la guerre. Jean des Bandes Noires incarne encore l’art de combattre des chevaliers où la force individuelle et le charisme personnel suffisent à inverser le sort des batailles. Il est né trop tard dans un monde en mutation où les Etats modernes commencent à se dessiner. Personnage décalé par rapport à son temps, il ne sut pas inspirer à ses protecteurs l’envie d’utiliser ses capacités qui, en d’autres temps, auraient pu changer la face du monde.
Ludovic-Jean de Médicis (1498-1526), naquit le 30 avril 1498 à Forli. Son père est Jean de Médicis, cadet de la branche cadette des Médicis, frère de Laurent de Médicis (1463-1503), l’ami de Politien. Lui-même a été marié mais il est resté sans postérité jusqu’à cette ambassade à Forli en 1497, l’année suivant l’assassinat de Jacques Féo, le second époux de Caterina Sforza. Il mène un train de vie fastueux et il séduit la comtesse de Forli qu’il épouse secrètement.

Jean de Medicis Il Popolano Musée des Offices ?
Caterina Sforza ne pouvait pas officialiser son mariage au risque de perdre la tutelle sur ses enfants et, par conséquent, le gouvernement des principautés indépendantes de Forli et Imola. Caterina Sforza était la fille du duc de Milan, Galeazzo Sforza (1444-1476), assassiné en 1476. Elle avait épousé l’année suivante, en 1477, Girolamo Riario, neveu chéri du pape Sixte IV, qui fut le capitaine général des troupes pontificales, comme devait l’être près de vingt ans plus tard, Cesare Borgia, le fils du pape Alexandre VI (tous les évènements de la vie de Caterina Sforza sont contés dans l’article éponyme sur ce Blog ).

Caterina Sforza Portrait Lorenzo di Credi, Museo Civico de Forlì
De cette union était né Ludovic de Médicis, prénom donné en l’honneur de l’oncle de Caterina Sforza, Ludovic le More, frère de Galéazzo, qui avait succédé sur le trône de Milan au demi-frère de Caterina, Gian Galeazzo (1476-1494), dont la rumeur accusait Ludovic de l’avoir fait empoisonner pour prendre sa place.
Mais lorsque Jean de Médicis, le père, mourut, en septembre 1498, Caterina Sforza choisit d’attribuer à son fils le prénom de Giovanni, devenu quasiment mythique chez les Médicis. Elle n’eut pas à se repentir de cette initiative car le prénom de son oncle, qui perdit son trône de Milan et la liberté l’année suivante (il termina sa vie de prisonnier à Loches huit ans plus tard) était devenu un synonyme de malchance.
La vie de Caterina SFORZA est racontée sur ce Blog dans l’article: Caterina SFORZA : l’indomptable lionne de Forli
La jeunesse de Giovanni de Médicis à Florence
Caterina Sforza qui avait tout organisé pour préserver l’avenir de ses enfants, avait tout à craindre de Laurent de Médicis (1463-1503). Elle s’organisa, à l’arrivée des troupes de Cesare Borgia, pour dissimuler son fils Giovanni[i] (alors âgé de 18 mois), déguisé en fille, au sein du couvent des religieuses dominicaines de Saint-Vincent d’Annalena[ii] à Florence. Il y resta plus de huit mois entre novembre 1499 et juin 1500. En reconnaissance de ce service, le couvent d’Annalena fut toujours favorisé par les grands-ducs de Toscane jusqu’à la fin de la monarchie à Florence.
On connaît la fin malheureuse de Caterina Sforza, la lionne de Forli, capturée par l’armée française d’Yves d’Alègre pour le compte de Cesare Borgia. Ce dernier la craignait tant qu’il la fit mettre au secret dans un appartement prison du Vatican puis dans une cellule du Château Saint-Ange. Un malheur ne venant jamais seul, son beau-frère, Laurent de Médicis, profita qu’elle fût serrée en prison pour exciper de son incapacité à se déplacer une incapacité de tutelle lui permettant de lui ôter celle de son fils.
Quand Caterina fut libérée de prison le 30 juin 1501, elle dut résigner formellement en son nom et en celui de ses enfants, tout droit sur les comtés de Forli et d’Imola. De sorte qu’elle ne put rejoindre Florence que dépouillée de tous ses biens à l’exception de quelques bijoux que ses enfants avaient pu sauver de la débâcle de Forli.
La mort de Laurent de Médicis, deux ans plus tard, en 1503 lui apporta le soulagement que son fils n’ait pas été empoisonné par son oncle. Il fut placé dès son départ du Couvent Annalena en juin 1500, sous l’autorité de sa fille, la demi-sœur de Giovanni, Bianca Riario, née en mars 1478, l’aînée des six enfants, que Caterina avait eue de Girolamo Riario : elle était âgée de vingt-trois ans en 1501.
A la mort de Laurent de Médicis, Caterina put quitter le couvent de Murate et rejoindre la villa de Castello où elle reprit tout l’ascendant sur son fils Giovanni dont elle entreprit l’éducation. Elle pensa initialement lui faire donner une éducation classique et humaniste de la Renaissance. Mais Giovanni était désespérément rétif à tout ce qui ressemblait, de près ou de loin aux lettres. Il prenait au contraire un goût féroce à tous les jeux sanglants, les bagarres, le domptage des chevaux. Il ne pliait devant qu’une seule personne : sa mère.
Caterina Sforza retrouvait dans la férocité de son fils, le caractère trempé des Sforza mais elle ne parvint pas plus que les maîtres qui s’usaient prématurément au contact de la nature rebelle du jeune Médicis, à éduquer son fils. Elle rassembla à la villa du Castello la « meute » de ses petits-enfants, les enfants de ses enfants, mais elle se sentait davantage de points communs avec ce fils qui lui ressemblait tant.
Malgré tous les secrets qu’elle avait accumulés toute sa vie, pour se maintenir en forme, pour se soigner, voire pour résister aux empoisonnements, les traumatismes et les tortures qu’elle avait subis au château Saint-Ange avaient brisé sa résistance physique. Le 28 mai 1509, elle mourut dans d’atroces souffrances après avoir exprimé le désir d’être enterrée au couvent des Murate qui lui avait expédié, alors qu’elle était prisonnière au château Saint-Ange, un panier de fruits et de grenades de leur jardin.
A l’âge de onze ans, Giovanni se trouvait placé sous la tutelle paternelle du père Fortunati, qui l’avait accompagné depuis toujours et de Jacques Salviati. Ce dernier appartenait à cette grande famille Florentine : c’était un ambassadeur de métier, rompu à toutes les ficelles de la diplomatie, qui allait tempérer le caractère indompté de son protégé. Il prit Giovanni dans sa famille et le mêla à ses enfants. C’est là que Giovanni fit la connaissance de celle qui devait devenir son épouse, Maria Salviati.
Lorsqu’il ne vivait pas en famille chez les Salviati, Giovanni se retirait pour chasser la grive de Toscane ou le gibier à courre, dans sa forteresse du Trebbio : l’atmosphère toute militaire du château convenait à cette âme romantique et guerrière.
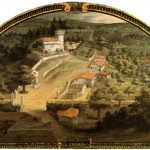
Donjon Le trebbio Giusto Utens Museo Firenze com’era
Quand il revenait à Florence, c’était pour s’engager dans des rixes à coups de poings ou à coup de pierres. Lors d’une de ces rixes, il frappa un garçon à mort. Soderini, le gonfalonier à vie, voulut l’exiler de Florence : mais Salviati réussit à réduire l’exil au Trebbio à une dizaine de milles de Florence.
Premiers faits d’armes
En 1512, Salviati qui préparait en secret le retour des Médicis à Florence, emmena à Rome, où il était nommé ambassadeur, le jeune Giovanni pour le dégrossir et le tempérer. A Rome Giovanni s’équipe sur un grand pied avec une luxueuse escorte, il passe son temps avec les courtisanes. Lucrèce de Médicis, la fille aînée de Laurent le Magnifique et l’épouse de Jacques Salviati, le considère comme son fils.
L’élection de Jean de Médicis, second fils de Laurent le Magnifique, sous le nom de Léon X fut le signal d’un retour en force des Médicis au premier plan. Julien fut nommé Capitaine Général des troupes pontificales. Jules, le bâtard légitimé de Julien de Médicis avec Fioretta Gorini, attendit d’être nommé cardinal. Laurent de Médicis, le petit-fils de Laurent le Magnifique, de retour à Florence, rétablit bien vite le système de Gouvernement qui avait si bien réussi à Cosme et à Laurent.

Léon X Rafaello Santi Galerie des Offices
A Rome, Julien de Médicis, le frère cadet du Pape, prit bientôt Giovanni comme capitaine de ses milices et le fit instruire au métier des armes.

Julien II de Medicis Duc de Nemours Copie anonyme du tableau perdu de Rafael Metropolitan Museum of Art de New York
Léon X, désespérant de la santé de son frère, Julien, le duc de Nemours (voir l’article sur les Médicis de 1400 à 1600 sur ce Blog), décida de confier quelques petites opérations à Jean pour le tester.
Il lui demande d’abord de libérer le territoire de l’un de ses alliés, sur les marais pontins. Jean recrute par priorité des Corses, soldats courageux et infatigables et règle l’affaire en peu de temps. Bientôt une entreprise plus importante lui est confiée : il s’agit de reprendre Urbin : le pape cède aux revendications d’Alphonsina Orsini sa belle-sœur et à celles de son neveu, Laurent de Médicis : le 18 août 1516, une bulle d’investiture crée Laurent duc d’Urbin. Il appartiendra à Jean de Médicis d’être l’entrepreneur de guerre de son cousin. L’affaire est réglée en vingt-deux jours.
De retour d’Urbin, Jean de Médicis épouse en novembre 1516 son amie d’enfance, Maria Salviati et devient le neveu par alliance du Pape. Ils vont occuper, brièvement, le palais de la famille Salviati dans Florence, libéré par Jacques qui s’en était fait construire un autre.
Mais les affaires d’Urbin reprennent. Le duc déchu, François Marie della Rovere passe pour un bon capitaine : il appelle des Aragonais fort opportunément démobilisés par la paix de Noyon[iii]. Jean de Médicis, à la tête de 800 cavaliers légers, se porte dans les marches en mars 1517, à la rencontre des Aragonais, avec l’armée pontificale.
Jean de Médicis reçoit moins de subsides que ses besoins de la part du duc d’Urbin. Il compense en vendant ses propres biens pour contribuer à la campagne. Cette fois la guerre n’est pas une promenade de santé : elle va durer vingt-deux mois. Le duc d’Urbin, Laurent de Médicis, est légèrement blessé devant le château de Mondolfo (entre Rimini et Ancône dans les Marches) mais il garde le lit trois mois. Il souffre déjà du « mal français », comme il est appelé par les Italiens, ou syphilis, maladie qui va l’emporter deux ans plus tard.

Laurent II de Medicis Duc d-Urbin (Raffaello Sanzio ou Santi) Lorenzo de’ Medici, 1518 Huile sur toile (97 x 79 cm) Crédit Photo © Christie’s Images Ltd. 2007 Coll Privée
L’armée papale n’est ni faite ni à faire. Les capitaines des mercenaires se détestent à un tel point qu’il a fallu séparer, avant la bataille, l’armée en trois corps : les Italiens à Pesaro, les Gascons dans la plaine, et le reste de l’armée sur le mont dell’ Impériale, séparé en trois avec les Espagnols sur le sommet, les allemands sur les pentes et les Corses de Jean de Médicis au bas de la pente. François Marie della Rovere engage les hostilités : il bouscule les italiens et les allemands dans la plaine. Les Gascons tournent casaque, de même que les Espagnols.
Pendant ce temps, Jean de Médicis a été expédié par le Cardinal Bibbiena, légat du Pape, dans des marches et contre marches, à l’assaut de forteresses dans les collines, au milieu des embuscades, autant de missions inutiles dans la campagne de Pesaro : il est attaqué lors d’une halte et ne réussit que péniblement à s’en sortir mais il y perd tout son bagage et son demi-frère, Charles Féo[iv] qui est fait prisonnier.
Pour remplacer ses chevaux, il doit vendre des propriétés. Son agent Fortunati, qui veille sur lui et sur ses affaires depuis son enfance lui déclare qu’il n’aura bientôt plus de crédit.
Cette guerre est la plus mal conduite qui fût jamais : pas de chef de guerre unique, un commandement incapable, des corps d’armée non coordonnés : au bout de dix-huit mois de guerre stérile, qui avait coûté 800 000 ducats au Pape, un traité tout aussi stérile est signé, aucun des belligérants n’ayant plus les ressources de continuer les opérations. L’addition est payée presque intégralement par la république de Florence.
Dans cette guerre mesquine, Jean de Médicis a été moins bien traité que beaucoup d’autres, plus en faveur que lui. Il ne mâche pas ses mots aux courtisans de Laurent qu’il accuse de négligence voire de couardise. Ce qui ne lui facilite guère les relations.
Mais il a pris conscience de sa force et il a surtout mis au point son art de la guerre : aux hauts destriers de guerre au harnachement lourd, il a substitué les chevaux barbes maniables et fringants, aux équipements sommaires, un essaim de genêts et de demi-sang très robustes, avec leurs cavaliers coiffés de simples bourguignotes[v], soit une troupe agile, très mobile, aux mouvements rapides et qui coûte peu. Il rénove les anspessades, formés par des hommes d’élite, à haute paye, qui composent, à peu de frais, un état-major dévoué jusqu’à la mort à son capitaine. Il complète son recrutement et l’organisation de ses bandes[vi]. La signature de la paix est ruineuse pour lui car elle le contraint à maintenir l’essentiel de sa bande en armes.

Jean de Medicis des Bandes Noires Le Titien Galerie des Offices
Mariage avec Maria Salviati
Il rejoint son épouse à Florence, Maria Salviati. Mais il alterne les (brefs) séjours auprès de sa femme par de longs épisodes avec des courtisanes florentines, nourrissant en permanence sa bande auprès de lui de sorte que la Seigneurie de Florence, alarmée de le voir dépenser tout son bien et de peur qu’il ne s’en prenne aux citoyens de Florence, demande au Pape de lui offrir une place bien rémunérée. Mais le caractère de Jean de Médicis faisait peur au Pape lui-même qui ne souhaitait à aucun prix l’avoir comme capitaine des forces pontificales.
La bastonnade de l’un de ses lieutenants, un corse, par le seigneur d’Appiano, de Piombino, va mettre le feu aux poudres. Jean de Médicis le provoque en duel dans toutes les formes de la chevalerie. Mais il a oublié d’en parler sur le plan formel avec le Duc d’Urbin, Laurent, qui avait remplacé son oncle Julien de Médicis à la tête de Florence. Ce dernier, au moment de partir en France épouser, en 1518, sa promise, Madeleine de la Tour d’Auvergne, décide, le 15 mars 1518, de le faire exiler de Florence où il ne pourra revenir sous peine d’être condamné à mort et de confiscation de ses biens.
Le 12 juin 1519, Maria Salviati mettait au monde celui qui serait leur fils unique, Cosme de Médicis, qui devait connaître plus tard un avenir si brillant.

Maria Salviati avec sa petite fille Bia Baltimore Walters Art Museum
Bientôt, le Pape Léon X, décide de donner à Jean de Médicis une compagnie dans les Marches, pour lutter contre les bandits qui pullulaient, car il fallait d’urgence lui trouver un emploi hors de Florence et il voyait poindre des difficultés pour lesquelles il fallait prioritairement s’attacher ce fier-à-bras.
Fin mars 1520, Maria Salviati fit une fausse couche dont elle faillit mourir et après laquelle, elle ne put plus jamais avoir d’enfant.
Reprise de la guerre entre le pape et la France
Le 6 juillet 1520, Jean de Médicis recevait « royalement » six mille ducats du Pape Léon X pour l’entretien de ses troupes, alors qu’il en avait dépensé le triple. Et encore cette réception consistait-elle en l’autorisation de saisir des biens immeubles du seigneur Louis Eufreducci, déclaré rebelle par le Saint-Père.
En 1521, la guerre reprend entre le Pape et la France. Le Pape souhaitait reprendre les villes de Parme et de Plaisance, occupées par la France depuis Marignan. Le duché de Milan était défendu par le Maréchal Lautrec, vice-roi de Milan pour le compte de François 1er. Une armée coalisée commandée par le Général en chef Prospero Colonna, s’était mise en place, forte de 20.000 combattants placés sous les ordres de Frédéric II de Gonzague, Marquis de Mantoue, de Don Antonio de Leyva, une famille aragonaise de Naples et de don Ferdinand d’Avalos, Marquis de Pescara, d’une autre famille aragonaise de Naples.
Début août 1521, Colonna assiége Parme qui ouvre ses portes à l’armée pontificale à la fin du mois d’août.

Jacopo Tintoretto Conquête de Parme par Frederic II Gonzague de Mantoue Credit photo The Yorck Project Alte Pinakothek Munich
Giovanni est expédié tout d’abord pendant six semaines à Reggio (Emiliae) pour pacifier la région puis il vient avec l’armée faire le siège de Milan. Giovanni se bat comme les chevaliers de l’armée française, comme Bayard, à l’épée, la masse ou la lance : il méprise les arquebuses et autres arbalètes.
Une série d’engagements contre les forces françaises, permet à Giovanni d’acquérir en Italie un renom incomparable : tel chevalier qu’il a désarmé à la lance, tel autre qu’il a assommé de sa masse, telle action contre les forces de Lautrec : il est partout, irrésistible, insaisissable. Comme Bayard pour l’armée française, il devient une icône de l’armée pontificale.
Prospero Colonna n’aime pas Jean de Médicis : trop bouillant soldat, trop forte personnalité méprisant les ordres reçus, n’agissant qu’à sa guise en fonction d’une analyse personnelle de la situation, magnanime avec les vaincus qu’il remettait en liberté sans leur soutirer de rançon, au rebours de toutes les lois de la guerre des généraux plus anciens.
L’armée de Prospero Colonna réussit à chasser Lautrec de la ville de Milan vers la fin novembre 1521.
Jean de Médicis devient Jean des Bandes noires
La mort de Léon X survient le 1er décembre 1521, juste après la victoire de Milan par les troupes pontificales. L’interrègne à Rome est plutôt calme : pas de chasses aux bénéficiaires antérieurs des largesses papales.
Jean de Médicis change alors ses couleurs : les bandes blanches et pourpres des Médicis deviennent blanches et noires. Jean de Médicis fait son deuil de Léon X et conquiert son surnom qu’il conservera pour l’éternité : Jean des Bandes noires.
L’armée pontificale est alors licenciée tandis que Jean des Bandes noires essaie quelques mois encore de conserver ses hommes.
Le 9 janvier 1522, un nouveau Pape est élu en la personne d’Adrien Florensz, Archevêque de Tortosa en Espagne et ancien précepteur de Charles Quint. Le cardinal Jules de Médicis, fils bâtard légitimé par Léon X, de Julien de Médicis et de Fioretta Gorini (Voir les tableaux généalogiques des Médicis sur ce Blog), avait été désigné par Léon X pour gouverner Florence à la mort de Laurent, duc d’Urbin, en 1519.
Les seigneurs qui avaient été dépossédés par les Médicis reprenaient courage à Urbin (François Marie della Rovere) ou à Sienne (Baglioni). Jean des Bandes Noires est chargé par la République de Florence de tenir la campagne afin de permettre aux garnisons acquises aux Médicis, de tenir leurs villes. Il se porte d’abord sur la province de Pérouse où il emporte rapidement la forteresse de Passignano sur le lac Trasimène. A peine Pérouse pacifié, on lui demande d’aller au secours d’Urbin où une famine menace, après avoir installé une garnison à Cortone, pour éviter le retour des Baglioni.
Mais dans le même temps, Florence traverse une grave crise financière et se trouve dans l’obligation de pratiquer des coupes claires dans ses budgets. On parle de licencier certaines troupes. Bientôt Florence préfère négocier directement avec François Marie della Rovere plutôt que d’entretenir une guerre ruineuse pour le budget de la République. Jean des Bandes Noires est alors une nouvelle fois démobilisé. Et les ennemis de la veille sont pris au service de Florence.
Jean des Bandes noires est dégoûté par ces retournements de veste, par les promesses non tenues, par les récompenses qui pleuvent sur les pleutres et les courtisans. La coupe déborde quand le cardinal Jules de Médicis, qui n’aime pas Jean de Médicis dont il craint la concurrence qu’il pourrait exercer sur Alexandre de Médicis, le fils bâtard légitimé, de feu le duc Laurent d’Urbin (voir ci dessous les tableaux généalogiques sur les Médicis), décide de confier le capitanat des troupes de Florence au comte Guido Rangone.
Au service de la France et du maréchal de Lautrec
Jean des Bandes noires se trouve alors, vers le 15 mars 1522, à la tête de cinq cents lances (environ 3000 cavaliers) et cinq mille fantassins. Il décide de passer au service du roi de France. Il offre à tous ceux qui veulent le suivre de venir avec lui et il arrive le 30 mars au camp français avec 200 chevaux et 3000 fantassins.
Le passage de Jean des Bandes Noires au service de Lautrec est assez généralement condamné. Des bruits divers sous entendent qu’il a forfait à l’honneur ce qui l’oblige à envoyer des cartels pour défier quiconque se prêtera à de tels discours. Certains de ses plus fidèles lieutenants deviennent ses plus farouches ennemis et s’évertueront à le battre en employant ses propres tactiques.

Odet de Foix Vicomte de Lautrec Jean Clouet Inventaire n°MN136;B8 Musée Condé
Jean des Bandes Noires a bien choisi son moment pour se rallier à Lautrec. La bataille de la Bicoque, le 27 avril 1522, décide de la perte du Milanais par la France. Lautrec qui a poursuivi pendant plusieurs jours Prospero Colonna, vient buter sur les forces retranchées de ce dernier dans le Parc de la Bicoque au nord de Milan. Les Suisses veulent absolument engager le combat et ils menacent de déserter si Lautrec ne décide pas de lancer l’attaque. Lautrec cède au chantage malgré les avis négatifs de tous ses capitaines qui jugent que la position de Colonna est trop bien défendue.
Les Suisses se lancent à l’attaque avec leur tactique coutumière de gros carrés de piquiers mais ils sont bloqués sur un glacis pratiqué en contrebas des défenses de Colonna qui fait un carnage dans les rangs par l’utilisation de l’arquebuse. Jean des Bandes Noires et les forces françaises chargent à plusieurs reprises les positions défendues par Colonna : il a plusieurs chevaux tués sous lui mais il est obligé de faire retraite.
Après cette bataille, les débris de l’armée française se retirent à Crémone. Jean des Bandes Noires les y rejoint. Le 14 Mai, le Maréchal Lescun, frère du Maréchal Lautrec, investi du commandement des troupes après le départ pour Lyon de ce dernier, signe une capitulation avec Colonna, ce qui suscite la révolte de Jean des Bandes noires qui se rend compte que la paix négociée derrière son dos, se fera aux dépens de la paye de ses hommes. Ses troupes furieuses courent alors aux canons qu’elles retournent contre la ville, menaçant d’y faire un carnage. Lescun s’empresse alors de réunir toute la vaisselle d’or et d’argent qu’il peut trouver dans Crémone pour indemniser Jean des Bandes noires qui retourne d’abord à Florence, au Trebbio, laissant ses troupes dans la région de Reggio.
En 1523, Jean des Bandes Noires revient à Reggio d’Emilie, territoire épuisé par le cantonnement des troupes que les habitants ne parvenaient pas à faire partir. A Réggio, Jean peut revoir son ami Pierre l’Aretin, joyeux et libertin qui entre temps était passé au service du Marquis de Mantoue. Pierre est également son compagnon de lit, ainsi que le pratiquent de nombreux soldats.
Au service de son cousin le duc de Milan Francesco II Sforza
En octobre 1523, une armée française sous le commandement de Guillaume Gouffier de Bonnivet, le favori de François 1er, repasse les Alpes. Le roi François 1er était resté à Lyon pour s’occuper de réduire les conséquences de la trahison du Connétable de Bourbon. Avec Bonnivet, revenait en Italie une armée de 24 000 homme, augmentée de la redoutable gendarmerie lourde française forte de 1500 chevaux et tous les grands capitaines que Jean des Bandes Noires avait connus à la Bicoque l’année précédente.

Guillaume Gouffier de Bonnivet 1488-1525 Jean Clouet Inventaire n° MN153;B14 Dessin Musée Condé
Mais Jean s’était péniblement mis d’accord le 26 août 1523 avec Francesco II Sforza, le duc de Milan, son cousin au second degré (Caterina Sforza sa mère était la cousine germaine du duc Francesco II), pour un engagement de ses troupes à son service.

Francesco II Sforza
Tiziano Vercellio Palais du Prince Doria Genes
Le 14 septembre 1523, le pape Adrien VI mourait : l’élection du nouveau pape commençait et aboutirait deux mois plus tard au choix du Cardinal Jules de Médicis, sous le nom de Clément VII.
Jean de Médicis des Bandes noires défendait Milan, sous l’autorité théorique d’un Prospero Colonna agonisant, contre l’armée française, avec courage et brio. Une trahison de l’un de ses chefs d’escadron, circonvenu par Bonnivet, fut découverte à temps. Les traitres furent passés devant les piques de leurs camarades puis pendus.
Dès que l’élection du nouveau pape Médicis fut annoncée, Maria Salviati décida de prendre en main les affaires de la famille : tous les quémandeurs, les courtisans les moins recommandables avaient eu leur lot de récompenses avec Léon X, sauf elle. Désormais, elle se battrait pour son fils. Elle réclame, elle exige même du Pontife qu’il fasse quelque chose pour elle. Elle obtient une première faveur, celle de pouvoir venir à Rome faire élever Cosme avec les autres enfants Médicis : Alexandre, le fils bâtard légitimé et Ippolito l’autre fils bâtard mais non légitimé du feu duc d’Urbin. Maria Salviati arrive à Rome le 27 février 1524 avec le petit Cosme, âgé de cinq ans et elle est reçue par sa mère, Lucrèce, la fille aînée de Laurent le Magnifique et par son père, Jacques Salviati, en grande faveur auprès du Pape, qui les reçoit dès le lendemain pour se faire présenter le jeune prince.
Maria Salviati a décidé de se lancer dans l’intrigue pour obtenir du Pape une principauté permettant à son époux de vivre dans l’honneur. Mais ce dernier n’a pas les qualités requises pour obtenir ces prébendes. Il ne sait pas quémander, s’incliner, se prosterner pour obtenir des faveurs. Plus grave, il n’a pas de génie politique comme sa mère, ni de capacité à faire plier ses pulsions pour obtenir de grands avantages. C’est ainsi qu’au beau milieu d’une négociation engagée pour ses propres intérêts, il se lasse et s’enfuit. Jean des Bandes Noires est un combattant dur, loyal, intransigeant mais incapable de composer : il ne sait pas se faire aimer.
Ses exploits sont pourtant connus du Saint-Père et il n’a pas son pareil en Italie. Le roi de France parle de lui avec respect. L’Empereur Charles Quint prend de ses nouvelles régulièrement. Il est reconnu comme l’un des grands hommes de guerre de ce temps. Chacun des joueurs de ce tableau de jeu qu’est l’Italie pense à s’approprier ce pion qui peut être utile à celui qui le manoeuvrera mais personne ne lui offre la situation à laquelle il aspire car tous hésitent devant le caractère incontrôlable du condottiere.
Le vice-roi de Naples, Charles de Lannoy, avait bien reconnu la valeur de Jean de Médicis, lorsque les troupes impériales, avaient repris l’initiative, sous le commandement du Duc de Bourbon, l’ex-connétable de France, passé au service de Charles Quint en fin d’année précédente, et nommé Lieutenant général de l’Empereur en Italie (ayant donc autorité sur toutes les terres d’Empire y compris Naples). Le duc de Bourbon, s’appuyant sur des généraux habiles dont le Marquis de Pescara et Jean des Bandes Noires réussit par un harcèlement constant de multiples petits engagements à faire reculer l’armée royale dont les décisions du chef, Bonnivet, n’étaient pas à la hauteur des espérances du roi François 1er.
Puis Jean des Bandes Noires commençe à se lasser de risquer sa vie pour des seigneurs qui oublient de le payer. La guerre avait ruiné ce pays autrefois prospère et l’argent manquait. Il menaçe à plusieurs reprises de quitter le service du duc de Milan. Le chancelier du duc à Milan, Morone, lui indique un objectif qui lui permettra de se refaire : les villes tenues par les Français, de Garlasco et Abbiategrasso au sud-ouest de Milan.
Les Bandes noire se tracent alors un sillon de sang, emportant à force de courage et d’héroïsme, des villes qu’ils pillent férocement et qu’ils massacrent, méthodiquement. A Abbiategrasso, ils emportent tout ce qui était transportable pour le ramener à Milan : mais la ville était pestiférée et ils en exportent la peste, qui reprend aussitôt à Milan.

Sebastiano del Piombo Portrait d’un homme en armure Peut-être Jean de Medicis des Bandes Noires Wadsworth Atheneum museum of art Connecticut
Jean de Médicis fait une guerre totale, il exerce des représailles terribles pour chaque homme qui lui est enlevé. Une patrouille des bandes noires ayant été ainsi surprise par les Suisses et aussitôt mise à mort, Jean de Médicis se venge en surprenant un corps de trois cents Suisses dans une villa près de Milan, qui sont mis à mort systématiquement sans chercher à prendre de rançon. Ses troupes inspirent une terreur absolue à ses adversaires.
Caravaggio à l’Est de Milan, est emportée le 18 avril 1524, le château pris d’assaut et saccagé. La ville est massacrée et pillée. A la fin Avril, l’armée royale perd son plus fameux capitaine, le chevalier Bayard, Lieutenant général du royaume en Dauphiné, qui est surpris au cours d’une halte, à Rebec, notamment par les Bandes Noires, alors qu’il défendait les arrières de l’armée royale en retraite. Bonnivet, sous prétexte d’une blessure légère, confie alors le commandement de l’armée au comte de Saint-Pol, futur duc d’Estouteville (voir l’article sur ce Blog sur Romorantin ).
Bientôt, l’armée royale reflue vers les Alpes qu’elle peut repasser en bon ordre.
Dans cette campagne, Jean des Bandes Nores s’ést révélé l’homme indispensable : il a dans le cœur de la bataille un incroyable sang-froid et une clairvoyance aiguë à tous les détails. Mais c’est un batailleur indiscipliné, trop bouillant, incapable de respecter un ordre de bataille. Par sa hâte de courir sus aux adversaires, il avait failli faire manquer l’assaut de Rebec ! A Abbiategrasso, il n’avait pas attendu la fin du bombardement, fou d’héroïsme, pour charger.
Le 23 mai 1524, le Duc de Milan, François II entrait dans Novare libérée, à la tête des Bandes noires tandis que Pescara se portait à Alexandria, au sud-ouest de Florence et le duc d’Urbin, à Lodi, seules villes restant aux mains des Français.
La guerre finie, c’est Jean des Bandes Noires démobilisé et ses troupes sans emploi, c’est-à-dire livrées au pillage méthodique des régions dans lesquelles elles étaient cantonnées car le duc de Milan, Francesco II n’avait pas restauré ses finances et se trouvait tout aussi incapable d’honorer l’échéancier de la paye.
Les hauts faits de Jean de Médicis étaient remontés jusqu’au Pape qui adresse quelques courriers très amicaux au célèbre condottiere, en l’invitant à Rome, tandis qu’une pluie de petites faveurs commençe à tomber tous les jours sur Maria Salviati et sur Cosme.
Clément VII craignait au plus haut point qu’un homme charismatique comme Jean de Médicis, ne prenne, appuyé sur une armée toute acquise à sa personne, le contrôle de Florence. Il préférait donc le garder sous la main, avec quelques oboles par-ci par-là mais sans rien lui donner de substantiel alors qu’une pluie de faveurs et de ducats ne cessait de tomber sur des favoris sans épaisseur mais sans danger pour le Pontife.

Clément VII (Medicis) Sebastiano del Piombo1485-1547 1526, huile sur toile 145 x 100 cm @ Museo di Capodimonte, Napoli.
A Rome, Jean de Médicis a fait appel à son ami de toujours, Pierre l’Aretin, avec lequel il partage les mêmes goûts libertins. A la fin septembre 1524, alors que l’armée espagnole du duc de Bourbon est repoussée du siège de Marseille et commence sa retraite vers l’Italie, Jean des Bandes Noires reçoit enfin sa récompense pour sa campagne Lombarde qu’il doit sans doute davantage aux nuisances du cantonnement de ses soldats qu’à sa valeur sur les champs de bataille : il s’agit du riche fief de Busto Arsizio et de terres adjacentes dans le pays de Lodi, terres confisquées à Jacques Trivulce, qui avait pris le parti des rois de France, Louis XII et François 1er.
Au service de François 1er
Puis, François 1er, à la poursuite des débris de l’armée espagnole qui avait levé le siège de Marseille, vient faire celui de Pavie. Jean remonte à Florence pour y négocier avec Francesco II Sforza le renouvellement de sa condotta. Mais il ne parvient pas à ses fins et reçoit le 15 novembre 1524, des propositions plus intéressantes du roi de France. Le pape Clément VII interrogé, accepte que Jean de Médicis se mette au service de François 1er car pour l’heure, c’est ce dernier qui paraît le plus fort. Il n’est pas mécontent par ailleurs de tenir le Médicis éloigné de Florence. Ceux qui regrettent le plus le passage de Jean des Bandes Noires aux Français sont les Impériaux qui ne comprennent pas que l’on ne soit pas parvenu à s’attacher ce soldat impitoyable.
Mais Jean des Bandes Noires est chez lui, avec des pairs au camp du roi de France. Tous les capitaines du roi reconnaissent sa valeur et partagent ses valeurs et son éthique du combat. Le roi François est entiché de lui et veut le faire duc d’Urbin. Il refuse de signer un contrat écrit avec François et retourne à ce dernier le collier de Saint-Michel[vii] qu’il lui avait offert en disant qu’il préférait être jugé sur ses actes plutôt que sur la promesse de ses actes. Réponse fière qui dut plaire au caractère chevaleresque de François 1er. Mais que le condottiere, si confiant dans la parole du roi, dut regretter plus tard !
Du reste, pour le moment, le roi répond présent à toutes les demandes financières du condottiere. François 1er envisage à ce moment-là d’utiliser sa connaissance de l’Italie en le joignant à l’expédition du duc d’Albany[viii] vers Naples.
Le projet stratégique de François 1er était d’expédier le duc d’Albany à la conquête de Naples en profitant que le royaume soit dégarni de ses troupes, à présent toutes entières dans le duché de Milan. Et si le vice-roi de Naples, Charles de Lannoy, venait à se porter au secours de son royaume, ce serait autant de troupes qui seraient ainsi soustraites de l’armée impériale ce qui placerait l’armée française en surnombre.
Ce stratagème faillit réussir car Lannoy voulut immédiatement partir avec ses huit mille napolitains à la défense de Naples. Pescara réussit à le persuader du contraire en lui faisant remarquer que le corps d’Albany serait trop faible pour s’emparer du royaume de Naples et que surtout le sort de Naples allait se jouer en Lombardie : une bataille perdue dans le nord signifierait ipso facto la perte de Naples.
Finalement, le duc d’Albany part pour Naples mais la mission de Jean des Bandes noires a changé car Pescara n’ayant pas mordu à l’hameçon, il vaut mieux conserver Jean des Bandes noires qui connaît toutes ses ruses. Jean est alors expédié en diverses missions pour l’armée royale, escarmouches, engagements contre les sorties de la garnison de Pavie, tous plus violents les uns que les autres. Il est pris d’une frénésie d’action et il est partout le premier volontaire, trompe-la-mort.
Le 17 février 1525, il attire ainsi dans un ce ces pièges auxquels il excellait, une sortie des troupes de Leyva, qui défendait Pavie. Aussitôt, il fond sur ces troupes, les crible de coups et les bouscule brutalement dans Pavie. Alors qu’il revient vers le camp français, il rencontre l’Amiral Bonnivet, le favori de François 1er, qui, le voyant couvert de sang, lui demande d’où il vient : il raconte l’affaire et Bonnivet curieux de voir le lieu précis, tous deux se rapprochent du lieu de l’algarade, aux avants postes de la défense de Pavie. A proximité, se trouvait une cabane où étaient retranchés quelques arquebusiers qui, voyait s’approcher l’ennemi détesté, lui envoient une balle qui lui traverse la jambe. On ramène le blessé au camp : la balle est extraite et la blessure, quoique douloureuse, est déclarée sans gravité. Le soir-même, Lannoy écrit à Marguerite d’Autriche, la Régente des Pays Bas, qu’une balle a blessé Jean des Bandes Noires et l’a mis hors de combat, une blessure qui s’apparente à une victoire pour les Impériaux.
Le pape, informé, lui détache Jacques de Garpi, le plus célèbre médecin de l’Université de Bologne et demande à ce que le blessé soit déplacé à Piacenza pour y être soigné. Le Lieutenant Général pour l’Empire, Bourbon, avait donné le sauf-conduit nécessaire de sorte que le blessé se retrouve le 22 février à Piacenza, malheureux de n’être pas auprès de ses hommes dont il savait que la valeur combattante, dépendait étroitement de la sienne. Et Bourbon le savait bien, raison pour laquelle il avait si volontiers donné son sauf-conduit.
François 1er avait prêté au blessé son propre chirurgien que lui avait donné Frédéric de Gonzague, Marquis de Mantoue, le médecin juif Abraham de Mantoue qui, par ses soins à la fois doux et précis devint si indispensable au malade qu’il ne voulut pas le laisser partir quelle que soit la pression qui s’exerçait pour qu’il vînt à Pavie au secours des blessés innombrables.
En effet, dans le même temps où Jean de Médicis reprenait des forces à Piacenza, le roi de France et toute la chevalerie française tombaient sous les coups des arquebusades de Pescara à Pavie, le 24 février 1525 et le roi François 1er était emmené en captivité. .
Avant de quitter Plaisance, Maître Abraham de Mantoue avait retiré du corps du blessé « plus de soixante morceaux d’os et vingt morceaux de plomb, chacun gros comme un grain de mil ». Le chirurgien fit sortir encore trois cent esquilles par sondages ce qui représentait aux dires de ce dernier, un bon tiers du péroné. Mais la blessure ne s’infectait pas et le malade guérit à vue d’œil au mois de mars.
La mort de Jean des Bandes Noires
Au mois d’août 1525, le cousin de Jean des Bandes noires mourut : Pier Francesco de Médicis, le jeune, le fils de Laurent et le cousin germain de Jean était très malade depuis l’année précédente : la maladie venait de l’abattre à la villa de Cafàggiolo. Depuis sa mort, le Pape reconnait Jean des Bandes noires comme le chef de famille de la branche cadette des Médicis.
Depuis six mois que l’on était en paix, le Pape cherchait comment occuper son terrible condottiere tout en lui permettant de trouver les ressources nécessaires à l’entretien de ses soldats. On parla alors de lui faire faire la guerre de course contre les Turcs.
Jean des Bandes noires se réfugie à Fano, à 60 kms d’Ancône dans le but d’y faire la guerre de course.
Mais la guerre de course fait long feu. Il reçoit une galère et un brigantin sur lequel il entraîne ses hommes, mais qui ne feront jamais plus de 4 ou 5 lieues en mer. La signature, le 22 mai 1526, de la Ligue de Cognac entre le Pape, Venise et la France, apporta aux Bandes Noires une lueur d’espoir.
Pour la première fois depuis qu’il faisait la guerre, ses deux employeurs, la France et le Pape, étaient dans le même camp. Le 6 juin 1526, il reçoit du Pape 2 500 ducats pour lever 2 000 hommes de pied. Le 10 juin, Jean de Médicis est nommé Capitaine Général des troupes pontificales, sous les ordres de Frédéric II de Gonzague, Marquis de Mantoue et de François Guichardin, Lieutenant général pour les Etats de l’Eglise et pour l’armée.
En septembre 1526, le roi de France écrit de Tours au duc de Milan, pour faire rendre les biens confisqués à Jacques Trivulce, biens qui étaient venus entre les mains de Jean des Bandes Noires pour sa campagne Lombarde et qu’il est obligé de rendre sans compensation. Le Pape, en contrepartie, lui donne Fano en fin d’année 1526.
Le premier souci du Pape était les lansquenets de Georg Von Frundsberg, luthériens, qui descendaient d’Allemagne, pour joindre leurs forces au duc de Bourbon qui s’apprêtait à envahir Rome. Le Pape voulait leur opposer Jean des Bandes Noires sur la route de Rome. Mais Guichardin pensait qu’une action très en amont, sur les plaines du Pô avant que les forces n’aient eu le temps de se regrouper, serait plus efficace en conjuguant les troupes de Jean de Médicis et celles du duc d’Urbin, soit neuf mille hommes de pied, six cents lances et mille chevau-légers. A ce moment-là, Frundsberg malade de la goutte est dans l’obligation d’abandonner ses troupes qui se trouvent sans général : l’occasion paraît propice.
Jean de Médicis se porte à la rencontre des quinze mille lansquenets de Frundsberg le 21 novembre 1526, au parc de Serraglio (une réserve de chasse des marquis de Mantoue) à dix kms au sud-ouest de Mantoue. Il emmène avec lui son ami Pierre l’Arétin qui espère être nommé grâce à l’intercession de Jean, gouverneur d’Arezzo. Alphonse d’Este, duc de Ferrare avait expédié aux lansquenets des fauconneaux tirant des balles de trois livres. Fidèle à sa tactique, le commandant des bandes noires se jette à l’assaut des lansquenets à l’abri d’un retranchement d’une tuilerie. Il ne voit pas le fauconneau qui se découvre au bon moment : la balle vint le frapper alors qu’il tournait bride, sur la partie non protégée de sa jambe.
On porte Jean de Médicis, blessé grièvement, au palais de Mantoue pour y être soigné par maître Abraham. Mais la blessure est déjà infectée et les médecins se résolvent à l’amputation. Le blessé, amputé à vif supporte l’horrible douleur sans broncher.
Il passe la nuit à peu près correctement mais au matin les grandes douleurs de son membre gangrené le reprennent et il souhaite faire son testament en présence du Marquis de Mantoue et du duc d’Urbin François-Marie della Rovere. Il désigne son épouse, Maria Salviati tutrice de son fils et son exécutrice testamentaire.
Jean des bandes noires meurt à vingt-huit ans, durant la nuit du vingt-neuf au trente novembre 1526.
Machiavel qui rêvait d’un héros susceptible de réveiller la grandeur passée de l’Italie avait espéré que Jean des Bandes Noires serait cet homme providentiel. Il devait attendre encore trois siècles pour que ce vœu se réalise enfin.

Nicolo Machiavel Santi di Tito Palazzo Vecchio Florence
___________________________________
[i] La matière de cet article est extraite du livre de Pierre Gauthiez L’Italie du XVème siècle : Jean des Bandes Noires 1498-1526 SOCIÉTÉ D’ÉDITIONS LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES Librairie Paul Ollendorf 5o, CHAUSSÉE d’antin, 1901 – Source Projet Gutemberg.
[ii] Couvent fondé en 1440 à Florence par Annalena Malatesta, épouse de Baldaccio d’Anghiari, condottiere naturalisé florentin en 1437. Le couvent est devenu Dominicain en 1454. Il est situé dans le quartier de l’Oltrarno sur la rive gauche de l’Arno à Florence.
[iii] La paix de Noyon du 8 mai 1516 réglait un très vieux contentieux entre l’Aragon et la France à propos du royaume de Naples qui est, par ce traité, définitivement reconnu à l’Aragon. Signée en outre par l’Empereur Maximilien du Saint-Empire et par le roi d’Angleterre, il met fin à la ligue de Cambrai qui avait réuni contre la France, la plupart des puissances d’Italie, dont Rome, Naples et Venise, le saint Empire, l’Aragon et l’Angleterre.
[iv] Le seul enfant de Caterina Sforza et de Giacopo Feo, de Savone, son deuxième époux.
[v] Bourguignote : casque léger en acier dont les Bourguignons firent surtout usage au XVème siècle et qui constitua l’ancêtre de tous les casques de cavalerie des siècles suivants.
[vi] Bande : soldats de fortune regroupés en compagnies de routiers maîtrisant particulièrement bien les nouvelles armes (arquebuses, pistolets), qui disparaîtront avec l’apparition des Etats modernes au XVIème siècle et leur armée permanente. Ces soldats agissaient dans le cadre de condotta, des contrats qui leur permettaient de louer leurs services pendant une durée déterminée à des puissances belligérantes. Les Bandes étaient des unités combattantes autonomes, copiées sur les Lansquenets, formées de quatre cents hommes environ, avec les 2/3 des effectifs sous forme de piquiers, le tiers restant étant formé d’arquebusiers et de hallebardiers (pour tuer au défaut de la cuirasse). Il semble cependant que les bandes noires ne Jean de Médicis ne comportaient pas d’arquebusiers.
[vii] L’ordre de saint-Michel avait été créé à Amboise par le roi Louis XI en 1469 et fut fondé en réplique de l’Ordre bourguignon de la Toison d’Or sur le modèle duquel il fut établi.
[viii] John Stuart, deuxième duc d’Albany est l’ancien Régent d’Ecosse de 1515 à 1524, passé au service de François 1er en 1524. Il est le fils d’Alexandre Stuart et d’Anne de la Tour d’Auvergne. Il est donc le cousin germain par alliance de Madeleine de la Tour d’Auvergne, feue l’épouse de Laurent de Médicis, duc d’Urbin, morte en 1519 en donnant le jour à Catherine de Médicis.


Laisser un commentaire