Le mouvement évangéliste a précédé la Réforme protestante en France. Véritable réseau[i] protégé par Marguerite d’Alençon, sœur du roi de France, il est partisan d’une réforme de l’intérieur de l’Eglise sans porter atteinte à son existence. Il prône, comme Luther, le retour à l’Evangile : « rénover la vie chrétienne par la prédication de l’évangile, rendu accessible à tous »[ii]. Ce mouvement, porté par Marguerite d’Alençon avec le soutien discret de son frère, incarna un moment, l’idée d’une troisième voie, à la française, entre la rupture et le soutien aux dogmes de l’Eglise catholique. C’est la politique royale qui modula sa capacité d’expression entre 1519 et 1525.
L’évangélisme eut pour théologiens Jacques Lefèvre d’Etaples et Guillaume Briçonnet. Il eut pour hommes de lettres, Clément Marot et peut-être François Rabelais. Il exerça une profonde influence sur la littérature et les humanistes.
Il disposa de son terrain d’expériences : la réforme du diocèse de Meaux.
Guillaume Briçonnet Evêque de Meaux
Guillaume Briçonnet (1470-1534), Evêque de Meaux était le fils de Raoulette de Beaune et du Cardinal Briçonnet, Evêque de Saint Malo[iii], le grand financier de Charles VIII. Ce dernier avait embrassé la carrière ecclésiastique après la mort de sa femme, à l’instar de plusieurs de ses contemporains.
Portrait de Guillaume Briçonnet (1472-1536) Tableau proposé par le Site Tourisme Pays de Meaux
Guillaume Briçonnet fait partie d’un groupe familial très puissant au sein de la monarchie : « parmi les oncles et les cousins de Guillaume et leurs parents, il y avait des conseillers du Roi, des présidents et des conseillers au Parlement, des présidents de la Chambre des comptes, de la Cour des aides et de la Cour des monnaies, des chanceliers de France et de Bretagne, surtout des généraux des finances, des receveurs généraux des finances de Languedoïl, de Languedoc, de Provence et de Dauphiné, des trésoriers des guerres et de l’Épargne, des maîtres de la Chambre aux deniers du Roi et de la Reine… En leurs mains était ainsi concentrée une part essentielle de l’autorité publique et Guillaume Briçonnet lui-même, au début de sa carrière, commença par exercer la haute charge de président en la Chambre des comptes, avant de la repasser à un de ses frères »[iv].
Ce groupe familial était né de l’ascension sous le roi Louis XI de la bourgeoisie de Tours : « sur trois générations, les familles Briçonnet, Berthelot, de Beaune, Ruzé et Burdelot — de Tours — et Gaillard — de Blois — n’ont pas eu entre elles moins de dix-huit alliances matrimoniales » (Article sur Briçonnet déjà cité). . Ce groupe familial truste les emplois publics et les charges anoblissantes : il concentre également de nombreux Evêchés et il forme un très important groupe de pression au profit de chacun de ses membres.
Guillaume Briçonnet (1445-1514), ministre de Charles VIII, cardinal en 1495 N° d’inventaire LP8.33.3 Fonds Estampes Crédit Photo Photo (C) Château de Versailles, Dist. RMN-Grand Palais / image château de Versailles Musée National des Châteaux de Versailles et de Trianon
Le jeune Guillaume fait ses études à Paris, à la Faculté de théologie et dans un des collèges parisiens : le collège royal de Navarre.
Source Wikipedia Le collège de Navarre Rue de la Montagne Sainte-Geneviève
Le cardinal Briçonnet avait fait élire son fils Guillaume, alors âgé de dix-huit ans, à l’Evêché de Lodève, en 1489, siège qu’il occupera physiquement jusqu’en 1516. En 1493, il est désigné par le roi Charles VIII pour représenter la France aux noces de Maximilien d’Autriche avec Bonne Sforza à Milan.
Pendant que son frère Denis, déjà évêque de Toulon, héritait de son père l’Evêché de Saint-Malo, Briçonnet hérita en 1507, de la riche abbaye parisienne de Saint-Germain-des-Prés. Il en profita pour démissionner de sa charge de Président de la Cour des Comptes qu’il avait occupée pendant neuf ans depuis 1498, qu’il céda à son frère, pour se consacrer exclusivement à ses fonctions religieuses.
Il engagea une réforme des moines de l’Abbaye : au commencement de 1514, il fit venir trente religieux pour faire revivre les anciennes règles et forcer les religieux à se conformer à la réforme des autres couvents de la Congrégation. Mais la plupart des moines, plutôt que de se soumettre à l’austérité d’une réforme, préférèrent s’enfuir secrètement. Ces premières tentatives furent l’occasion de nombreuses déceptions et de procès à répétition de la part des moines avant d’aboutir, en 1516, à une « réforme selon la vraie règle de Saint Benoît »[v].
Source Wikipedia Abbaye de Saint-Germain-des-Prés
Aussitôt devenu Abbé de Saint-Germain-des-Prés, il invita à le rejoindre, le professeur du Collège du Cardinal Lemoine qui l’avait ébloui dans sa jeunesse, Jacques Lefèvre d’Etaples, pour permettre à ce dernier de se consacrer uniquement à ses études et à ses publications. Ce dernier vint le retrouver suivi de ses disciples (Raulin, Pinelle et Clichtove), lesquels aspiraient tous à une réforme de l’Eglise.
Lorsque François 1er rechercha un homme du clergé, expérimenté, pour l’expédier comme Ambassadeur auprès de Léon X, le nom de Guillaume Briçonnet fut l’un des premiers à venir et c’est tout naturellement que François 1er le fit élire le 19 mars 1516 au diocèse de Meaux. Guillaume Briçonnet resta en Italie jusqu’en 1518.
De retour d’Italie, Briçonnet voulut réformer le Diocèse de Meaux comme il avait réformé l’Abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Et cette réforme était nécessaire : « le plus grand nombre des curés, au lieu de résider dans leurs paroisses, demeuraient à Paris, ne s’occupant qu’à manger leurs revenus et laissant le soin de leurs ouailles à des vicaires ignorants et incapables de prêcher. La prédication était ainsi tombée exclusivement entre les mains des frères Cordeliers de Meaux qui s’en acquittaient fort mal : ils ne prêchaient qu’au temps des quêtes, un seul prédicateur parcourait alors quatre ou cinq paroisses dans pour ne s’arrêter qu’à celles qui rapportaient le plus… »[vi]
La première mesure prise est de réorganiser la prédication en répartissant les paroisses en vingt-six stations, chacune confiée à un prédicateur. Il fait éditer le Missel de Meaux et entame la réforme des moines réguliers[vii]. En 1519, reprenant une tradition médiévale, il réunit tous les curés du diocèse pour leur faire connaître ses volontés par des ordonnances synodales. Les synodes de Meaux sont tenus en Octobre 1519, octobre 1520, octobre 1523. En 1521, Briçonnet participe au synode provincial de Sens, à la demande de François 1er soucieux de généraliser cette pratique à tout le royaume[viii].
Ces premières mesures sont tout à fait dans l’esprit des réformes recommandées par les « gallicans » et Briçonnet fait alors l’effet d’un évêque modèle. Le clergé « gallican » de France s’opposait alors au clergé « ultramontain » (italien) : le gallicanisme estime que la nécessaire réforme de l’église de France doit être entreprise par des évêques résidant effectivement dans leur diocèse et non pas décidée depuis Rome par le pape. Le gallicanisme s’accompagne de critiques sévères à l’égard de la papauté, qui paraît moins soucieuse de la conduite des âmes que de préserver sa richesse en cumulant des évêchés inoccupés la plupart du temps par leurs titulaires, résidant à Rome.
C’est sans doute ce qui lui vaut d’être désigné en 1521, aumônier de la duchesse d’Alençon, Marguerite d’Angoulême, sœur du roi, qui cherchait un directeur de conscience.
Lefèvre d’Etaples : le théoricien de l’évangélisme
A soixante-et-onze ans, c’est un homme âgé qui vient prendre la tête du groupe de Meaux.

Portrait de Lefevre d’Etaples GALLICA-BNF
Portrait de Jacques Lefèvre d’Etaples par Hendrick Hondius dit Hondius le vieux (1573-1649) Crédit photographique © Louis Deschamps Musée des Beaux Arts de Rennes
Il est né vers 1450 [ix] à Etaples en Picardie. Vers 1473 il est à Paris pour ses études. Auprès de quels maîtres fit-il ses études ? Apprit-il le grec ancien auprès de Grégoire Typhernas, le premier grec exilé à Paris après la prise de Constantinople par les Turcs ou auprès d’Hermonyme de Sparte ? La rhétorique auprès de Guillaume Tardif ou de Guillaume Fichet ? La littérature auprès de Jean de Lapide ?
Nul ne le sait. Il obtint le diplôme de Maître-es-Arts, « ce qui prouve qu’il dut faire un séjour assez long à Paris car pour obtenir ce diplôme, il fallait passer par la série d’épreuves prescrites par les statuts de l’Université : avant d’être admis aux cours de logique, il fallait subir un examen sur la grammaire, la rhétorique, le grec et la versification. Puis, après avoir suivi pendant deux ans divers cours dont celui de la dialectique, on pouvait obtenir le grade de bachelier et, un an après, celui de licencié. Pour être reçu Maître, il fallait encore suivre un cours de trois ans et demi et subir les examens correspondants. » [x] Les études duraient donc entre six et huit ans. S’il est arrivé vers 1473, il ne dut pas repartir de Paris avant 1480.
Il fit un premier voyage en Italie pour y approfondir l’étude du grec, la philosophie de Platon et d’Aristote, les mathématiques, la théologie mystique. Il y fit un second voyage, vers 1492. Son esprit était alors beaucoup plus porté vers la philosophie et les mathématiques que vers l’étude des auteurs classiques.
« Il dut bientôt reconnaître combien la scholastique vide et le formalisme dialectique qu’on lui avaient enseignés, et qui s’appuyait sur un Aristote tronqué et défiguré, était loin de la véritable doctrine de ce philosophe. Quoique voué à l’étude des mathématiques, et ayant préféré la philosophie d’Aristote à celle de Platon, il était cependant loin d’avoir un esprit sec et froid : il aimait au contraire les écrits mystiques et il portait en lui un profond sentiment religieux. Ses études mathématiques l’empêchèrent de s’abandonner aux rêveries mystiques tandis que son mysticisme l’empêchait de tomber dans le scepticisme et l’incrédulité »[xi].
Le séjour ordinaire de Lefèvre fut à Paris, de 1480 à 1520, où le petit homme acquit bientôt une grande réputation d’enseignant de la philosophie d’Aristote et des mathématiques. Il enseignait alors au Collège du Cardinal Lemoine. Guillaume Briçonnet qui fréquentait les cours du Collège de Navarre pourrait l’y avoir rencontré dans les années 1480 tant la réputation de Lefèvre fut rapidement établie grâce à des dons de pédagogue exceptionnels.
Il ne se contenta pas d’enseigner la philosophie d’Aristote : il traduisit la plupart des œuvres du grand philosophe en latin, accompagnées d’introductions et d’explications. Il fut aidé dans cette tâche par Josse Clichtove, qui vint à Paris faire ses études et fut reçu docteur en Sorbonne (à la différence de Lefèvre) en 1505. Lefèvre s’appuya en outre sur le zèle des imprimeurs savants Josse Bade à Lyon et Henri Estienne (1470-1520) à Paris.
Avant 1517, Lefèvre s’est déjà fait connaître en France comme le spécialiste universel d’Aristote et comme traducteur de très nombreuses œuvres de philosophie et de religion (plus d’une trentaine). Il est apprécié de Louis XII qui lui adresse des signes d’estime.
A partir de 1512, il publia ses « Commentaires sur les Epîtres de Saint-Paul », œuvre majeure dans son évolution intellectuelle, à partir de laquelle il spécialisa ses études sur les Evangiles et les textes sacrés. Lefèvre d’Etaples devint alors le plus connu des savants, derrière Erasme.
Erasme écrivant (1467-1536) Holbein Hans, le Jeune (1497-1543) N° d’inventaire INV1345 huile sur toile 0,42 x 0,32 Crédit photo Photo (C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado Paris, musée du Louvre
Comme pour les traductions d’Aristote, Lefèvre prit conscience que le texte utilisé par l’Eglise depuis des siècles, attribué à Saint-Jérôme, était très éloigné, tronqué et corrompu par rapport à l’original. Il entreprit une nouvelle traduction en latin, mais il fut trahi par ses mauvaises connaissances en philologie, qui le firent assez facilement contredire, ultérieurement.
A partir de 1512, Lefèvre se met à étudier la Bible, y voyant l’expression de la volonté de Dieu, supérieure à toute volonté humaine, la seule règle de la vérité religieuse.
En niant dans ses « Commentaires… », le mérite des « œuvres », auxquelles il oppose la « justification par la foi » et en rapportant tout à la grâce divine, Lefèvre attaquait les fondements mêmes de la doctrine et de la pratique de l’église catholique. Il s’agit là d’une première attaque frontale d’où sortira la Réforme protestante. Et pourtant, l’auteur se défendait de vouloir attaquer ni l’Eglise ni son pontife auquel il reconnaissait son autorité.
« L’indépendance que montrait Lefèvre dans ses écrits, surtout dans ses « Commentaires… », son mépris pour les décrets de la scolastique et pour l’observance des pratiques de l’Eglise, ses déclarations sur la nullité des œuvres devant Dieu, devaient nécessairement lui attirer la haine des moines et des théologiens scolastiques » poursuit Charles-Henri Graf.
Quelques docteurs de la Sorbonne voulurent le faire condamner comme hérétique parce qu’il avait soutenu que la traduction de la Vulgate [xii] n’était pas de Saint-Jérôme, mais ils ne parvinrent pas à leur fin.
L’année suivante, en 1513, survint l’affaire de Reuchlin à Cologne : l’inquisiteur de Cologne et les frères Dominicains réclamèrent et obtinrent un ordre de l’Empereur Maximilien selon lequel tous les juifs devraient rapporter à la Maison de Ville tous leurs livres en hébreu, la Bible exceptée, pour y être brûlés. L’Empereur invita le savant Reuchlin à donner son opinion sur ces ouvrages. Reuchlin désigna les ouvrages qui étaient contre le christianisme mais il chercha à sauver les autres. A la suite de cet avis, les ouvrages furent rendus à leurs possesseurs.
L’Inquisiteur et les Dominicains, furieux, s’en prirent alors directement à Reuchlin qui fut déclaré hérétique et ils le menacèrent des fureurs de l’Inquisition. Reuchlin publia alors en 1513 une « Défense contre ses détracteurs de Cologne » et il s’adressa à Lefèvre d’Etaples à Paris, pour obtenir son soutien. Ce dernier qui n’était pas en odeur de sainteté auprès de la Sorbonne, fut impuissant à aider son ami. Les articles expédiés par l’Université de Cologne à la Sorbonne, furent condamnés.
Cette affaire porta l’exaspération des Dominicains et de l’Inquisiteur à leur comble : les écrits de Reuchlin furent déclarés hérétiques et condamnés à être brûlés. Reuchlin en appela alors au Pape, lequel n’aimait pas ces moines fanatiques et ignorants : il transmit l’affaire à l’évêque de Spire qui déclara Reuchlin innocent et condamna les Dominicains aux frais du procès.
Cette affaire fut de grande conséquence en Allemagne car elle souligna la mauvaise foi et l’ignorance des ordres monastiques. Elle provoqua l’union des humanistes et des savants contre l’obscurantisme, avec les réformateurs, qui allait contribuer à former le terreau sur lequel purent fleurir quelques années plus tard, les idées de Luther.
Lefèvre d’Etaples et la controverse de la Madeleine
En 1515, Lefèvre fit la connaissance du moine franciscain François de Moulins de Rochefort, qui avait été le précepteur de François 1er et qui était présentement au service de la mère du roi, Louise de Savoie. Ce dernier fut chargé par Louise de Savoie de faire une étude sur Marie Madeleine (voir à ce sujet l’article François de Moulins de Rochefort sur ce Blog). Lefèvre orienta les réflexions de Rochefort dans plusieurs directions dont celle de l’abbaye Saint Victor à Marseille, puis il se passionna pour le sujet car il constata que le personnage, traité par l’Eglise comme une seule et même personne, recouvrait en fait trois personnes différentes.
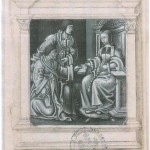
Rochefort et Lefèvre d’Etaples remettant leur livre à Louise de Savoie « Petit Livrect à Sainte Anne »
Rochefort et Lefèvre d’Etaples remettant leur livre à Louise de Savoie « Petit Livrect à Sainte Anne » Ms Fr 4009 BNF
Rochefort, homme d’église naïf et pusillanime souligna cet aspect de Marie Madeleine mais Louise de Savoie le dissuada de poursuivre dans cette voie. Louise de Savoie commanda par contre à Lefèvre d’Etaples de clarifier ce point. Ce que ce dernier fit dans son ouvrage « De Maria Magdalena » au printemps 1518, précédé d’une préface de Josse Clichtove.
Cette affaire fut le point de départ de la considérable controverse de la Madeleine qui allait agiter le brandon des premières querelles religieuses.
Aussitôt le livre paru, les moines et les théologiens de la Sorbonne poussèrent de hauts cris et accablèrent d’injures Lefèvre. L’évêque de Paris, Etienne Poncher, alors ambassadeur à Londres pour y signer le traité d’alliance entre François 1er et Henry VIII, expédia le livre de Lefèvre à Jean Fisher, évêque de Rochester et Chancelier de l’Université de Cambridge. Ce dernier réfuta les arguments de Lefèvre. A la suite de quoi Lefèvre admit qu’il n’y avait qu’une seule Madeleine mais deux Maries… dans une seconde dissertation. Fisher écrivit alors une seconde réfutation contre la deuxième dissertation de Lefèvre.
Etienne Poncher Gravure sur bois Fonds : Estampes Albums de Louis-Philippe N° d’inventaire INV.GRAV.LP 8.95.4 Musée National des Châteaux de Versailles et de Trianon
Les moines condamnèrent le livre sans l’avoir lu et en interdirent la lecture dans leurs prêches, en traitant Lefèvre de sot et d’ignorant : ils lui reprochaient de se mêler des affaires des docteurs de la Sorbonne alors qu’il n’était que Maître-es-Arts.
L’ouvrage de Lefevre d’Etaples, déchaîna les feux de la critique et de l’Université, gardienne du temple en matière religieuse.
Le plus fervent de ses opposants fut Noël Béda, doyen de la faculté de théologie de la Sorbonne, qui fut décrit par l’un de ses détracteurs en ces termes [xiii]: « retors au physique (il était, bedonnant, petit, bossu et boiteux), comme au moral, mais dialecticien habile, intègre de mœurs, zélateur d’autant plus intrépide de l’orthodoxie que lui-même avait été censuré pour des opinions téméraires, insensible aux attaques, indifférent aux moyens, toujours prêt à montrer les crocs contre ses collègues, aussi bien que contre ses ennemis ». C’est cet homme dangereux, impitoyable qui allait se dresser contre Lefèvre d’Etaples.
Beda commença par publier une exposition de la doctrine et du rite de l’Eglise par rapport à l’unique Madeleine, puis, transformant cette simple critique de Lefèvre en article de foi, il parvint à obtenir de la faculté de théologie de la Sorbonne un arrêt du 9 novembre 1521, par lequel il était défendu d’exprimer par livre ou en chaire une opinion contraire au principe de l’unicité de la Madeleine.
Après cette condamnation, Beda traduisit Lefèvre devant le parlement afin qu’il soit condamné comme hérétique. Mais François 1er qui protégeait les savants, ne voulut pas que l’on punisse Lefèvre pour une affaire d’aussi faible importance ; il chargea son confesseur Guillaume Petit d’examiner le livre en question. Ce dernier jugea le livre orthodoxe et il déclara que la question ne regardant qu’un point de critique, il devait être permis d’exposer les diverses opinions et de suivre celle que l’on croyait raisonnable.
Le roi défendit alors au Parlement d’inquiéter Lefèvre et l’affaire en resta là.
La pensée de Lefèvre d’Etaples : un catholique réformateur ?
Lefèvre vint, en 1520, à l’appel de Briçonnet pour mettre en œuvre une réforme du diocèse. Il en profita pour préciser les axes de sa réflexion qui avaient beaucoup mûri depuis les « Commentaires… ».
Plusieurs auteurs et non des moindres, à l’exemple de Michelet, déclarent en effet qu’avant 1521, la réflexion de la Réformation est au degré zéro en France. Les « Commentaires sur les Epîtres de Saint-Paul » contiennent des idées avancées, convergentes de celles de Luther, mais sans une véritable rupture, Lefèvre souhaitant en effet réformer l’église de l’intérieur. A la différence de plusieurs de ses disciples il ne rompra jamais formellement avec l’église. La plupart des auteurs estiment que la pénétration des idées de Lefèvre sur la base des « Commentaires… » fut nulle avant 1521, c’est-à-dire avant que ne pénètrent en France les thèses de Luther.
Henri de Sabatier-Plantier[xiv] note qu’il y a tout au plus chez Lefèvre « une tendance au protestantisme plutôt qu’une profession de foi anti-catholique ». Puaux dans son Histoire de la Réformation Française[xv], déclarera que Lefèvre « était une âme pieuse et tendre, un esprit vif et pénétrant, un homme de cabinet et de méditation ». Ce n’était pas un militant ni un martyr de la foi.
Lefèvre, Briçonnet, Michel d’Arande, Gérard Roussel, Josse Clichtove, avaient tous en horreur l’idée d’un schisme et ils souhaitaient une réforme de l’église de l’intérieur. C’est vers cette option également qu’inclinait la famille royale, Marguerite d’Angoulême, Louise de Savoie et François 1er.
Une des conséquences du dogme luthérien de la justification par la foi seule était l’adoption de la théorie du péché originel et la négation du Libre Arbitre, théories que Lefèvre a écartées. Pour Lefèvre, Dieu a donné à chacun le libre-arbitre mais ce n’est pas Dieu qui produit le mal, c’est l’homme : il n’y a aucun déterminisme chez Lefèvre, à l’inverse de Calvin.
Concernant les pénitences, rejetées par Luther, Lefèvre estime que l’apôtre Paul ne plaçait pas son salut dans ces mortifications, il le plaçait dans la grâce du Christ en qui il croyait alors ressembler. C’est donc la foi qui sauve : non la mortification.
En ce qui concerne le célibat des prêtres, Lefèvre estime qu’il est préférable au mariage mais il n’y a pas de péché pour un prêtre à se marier.
Le dogme de la justification par la foi aboutit chez les Luthériens au rejet de la messe. Chez Lefèvre, la messe quotidienne n’est pas un problème en soi.
Sur le sacrement du baptême, il estime que le bain ne justifie rien.
En résumé, Lefèvre reste fondamentalement catholique. Il se situe donc à l’écart de la théorie luthérienne, restant dans sa substance, dans une logique de réforme et non de Réformation.
Henri de Sabatier-Plantier porte ce jugement d’ensemble sur Lefèvre d’Etaples : « le principe de la justification par la foi animait Lefèvre dès 1512, comme Luther plus tard. Le professeur du Collège Lemoine a eu le germe de l’idée, c’est vrai. Mais il n’a pas fécondé ce germe, il n’a pas vulgarisé l’idée, il ne s’est même pas distingué des mystiques du moyen-âge : il ne mérite que le nom de Précurseur de la Réforme ».
Lefèvre d’Etaples : un protestant modéré ?
Si Lefèvre est resté au milieu du gué pour les protestants partisans de la rupture avec Rome, il n’en a pas moins été considéré par l’Eglise et par ses contemporains comme un hérétique.
La preuve en est dans la persécution acharnée dont il fut l’objet de la part du doyen de la faculté de Théologie de la Sorbonne, Noël Beda, qui lui valut censures et condamnations qui auraient pu avoir de pires conséquences s’il avait été moins bien protégé.
La lecture de certains de ses livres est interdite et certains seront mêmes brûlés. Le nonce du pape, Jérôme Aléandre est chargé de ramener Lefèvre dans le giron de l’Eglise : on considérait donc qu’il en était sorti.
Enfin, les amis de Lefèvre, presque tous protestants, le considèrent comme l’un des leurs.
En 1524, dans une lettre adressée à Farel, son ancien disciple de Meaux, citée par Henri Sabatier-Plantier, il « donne dans sa lettre une adhésion aussi explicite que possible aux thèses de Jean Hess de Breslau : « j’ai reçu avec ta dernière lettre ces thèses que Zwingler t’a remises, et qui lui arrivaient de Breslau : j’admire combien elles parlent avec un esprit conforme au mien, dans tout ce qui se rapporte à la Parole de Dieu, au souverain sacerdoce du Christ, au mariage… Oh Dieu bon, de quelle joie je suis saisi quand je vois cette grâce de voir purement Christ embrasser déjà une partie de l’Europe… » Or, poursuit Sabatier-Plantier, ces vingt et une thèses étaient fort hardies : elles étaient tout à fait contraires à l’enseignement de l’Eglise et exprimaient sans réticence des sentiments que l’on ne pouvait partager sans être réellement protestant ».
L’auteur estime donc qu’après 1520, il y avait tout lieu de penser qu’il est devenu protestant, d’autant qu’il s’est spécialisé sur les évangiles, abandonnant les saints, qu’il révérait encore en 1519. Il s’est placé en opposition ouverte avec l’Eglise en ce qui concerne les saints dont il rejette l’intercession et le mérite propre et en accusant la Papauté d’être responsable de l’affaiblissement de la foi.
Que s’est-il passé entre 1519 et 1520 pour provoquer cette évolution brutale de la pensée de Lefèvre ? D’après Sabatier-Plantier, l’explication ne saurait venir que de Luther : Lefèvre a lu en 1519 les écrits que Luther commençait à répandre en France et il a été convaincu qu’en prêchant la convergence avec les thèses de l’Eglise, il faisait fausse route.
Il y a tout lieu de penser, que Lefèvre a souhaité pratiquer un luthérianisme individualisé, assoupli, permettant de conserver l’illusion d’une réconciliation possible avec l’Eglise de Rome.
Le premier cercle de Meaux
Vers la fin de l’année 1520, Lefèvre rejoignit Briçonnet à Meaux et il forma le premier cercle de Meaux avec : « Gérard Roussel, docteur en théologie, prêtre qui devient curé à Meaux, François Vatable, helléniste et hébraïsant, lui aussi prêtre, Michel d’Arande, Martial Mazurier, docteur de Sorbonne, Clichtove, Bovelles, Farel… Un groupe homogène où dominent les rapports de maître à disciples autour de Lefèvre »[xvi].
Portrait de François Vatable extrait d’un recueil titré : Portraits de plusieurs Hommes illustres qui ont fleuri en France depuis l’an 1500 jusqu’à présent par Léonard Gaultier Estampe 1622 Burin ; cote P.587.B-120 Feuille entière H. en cm 5,3; L. en cm 3 Réseau des médiathèques de Pau
Sa conviction de la nécessité de purifier l’Eglise s’est appuyée d’abord sur la formation des prêtres, grâce à une meilleure connaissance des écritures. Il rend responsable la Papauté à Rome, de la décadence de la foi. Pour ce faire, il entreprend de traduire en langue vulgaire les livres saints et la Bible.
Car le seul moyen de redresser l’église déchue est de prêcher l’Evangile pur et dépouillé de toutes les inventions humaines qui l’ont défiguré. Car la parole de Dieu est tout, le reste est nul et vain. Cette église primitive teinte du sang des martyrs avait compris que ne rien savoir excepté l’évangile, c’est tout savoir. Ainsi martelait Lefèvre d’Etaples dans tous ses discours à ses disciples, lesquels allaient ensuite prêcher en chaires.
Lorsque Lefèvre se rend à Meaux, Briçonnet est « la vivante incarnation de ce qui restait du mysticisme du Moyen-Age » d’après Sabatier-Plantier.
François 1er, continue l’auteur, « avait subi jusqu’à un certain point l’ascendant de son protégé : ce qu’il aimait en lui, c’était surtout l’humaniste, le littérateur et le philosophe. Il favorisa la libre prédication de l’Evangile en septembre 1523 et encouragea la traduction du Nouveau Testament en français ».
Lefèvre, âgé de soixante-et-onze ans en 1521, ne prêche plus en chaire lui-même. Il influence ses disciples et provoque du reste la conversion, en 1521, de Farel, qui aura une carrière ultérieure importante de prédicateur protestant en Suisse.
Dans le diocèse de Meaux, l’équipe de Lefèvre s’emploie à simplifier le culte, à utiliser le français dans la liturgie à restreindre les quêtes et les manifestations de dévotion ostentatoires comme les pénitences. Ces actions sont en deçà de l’évolution intellectuelle de Lefèvre mais viennent en opposition directe avec les principes de l’Eglise.
Mais les Cordeliers de Meaux, privés d’une fraction notables du produit des quêtes, adressèrent une plainte contre leur évêque qu’ils accusèrent de propager des idées hérétiques. Le 15 octobre 1523, les livres et doctrines de Luther furent condamnés et le 13 décembre, les prédicateurs, dits Luthériens, furent bannis des chaires.
Le 2 Décembre 1523, la sentence de la Faculté de Théologie de Paris est publiée en 14 rubriques et 41 propositions, elle condamne les nouveautés et établit les doctrines. Au-delà de son caractère général, puisque la condamnation vaut pour toute la chrétienté, la sentence dans son particulier permet d’entamer des poursuites contre ceux des prédicateurs de Meaux (Caroli et Mazurier), cités devant la Faculté, puis devant le Parlement (Novembre, Décembre 1521). Le 1er Décembre 1523, l’évêque de Meaux révoque les pouvoirs des prédicateurs de son diocèse.
Lefèvre, qui avait été nommé le 1er mai 1523, Vicaire Général du diocèse de Meaux, fut confirmé à son poste, tandis que tous les prédicateurs de tendance luthérienne étaient contraints de démissionner et de s’exiler mettant fin au premier cercle de Meaux. Martial Mazurier, Pierre Caroli et Michel d’Arande remplacèrent les partants et vinrent renforcer Roussel et Vatable. Clichtove lui, décida de consacrer le reste de sa vie à combattre les doctrines de Luther, tandis que Farel s’exilait à Genève.
Portrait de Guillaume Farel (1489-1565) © S.H.P.F. Musée Protestant
Le deuxième cercle de Meaux était ainsi reconstitué.
Mais les persécutions commencent immédiatement après car la Sorbonne et Noël Beda regardaient avec suspicion l’action de Lefèvre et de ses disciples. Mazurier est bientôt arrêté en 1524 et condamné au bûcher. Il ne réussit à échapper à la peine de mort qu’en se rétractant. Il deviendra par la suite un opposant implacable aux Luthériens. .
Pendant que François 1er est employé à bouter hors de France l’armée impériale sous le commandement de l’ex connétable de Bourbon qui avait envahi la Provence, les persécutions reprennent, sans que la Régente, Louise de Savoie, la mère du roi, ne puisse s’y opposer.
Fin décembre, un cardeur de laine de Meaux, Jean Leclerc, est convaincu d’hérésie luthérienne, et condamné à être fouetté et marqué au fer rouge. Pierre Caroli, docteur en théologie, est convoqué au tribunal official (juge du diocèse) pour y expliquer ses thèses avant que le Parlement de Paris ne se saisisse de l’affaire. .
En 1525, ce fut pire avec la captivité de François 1er, analysée par tous comme une punition divine. «Les tribulations et calamités qui sont revenues en ce royaume procèdent des péchés énormes qui se commettent chaque jour dans le royaume où règnent et pullulent hérésie et blasphème…». Ce discours est dû au frère de l’évêque, Jean Briçonnet, et il a été prononcé devant la Chambre des Comptes, il résume la pensée de tous les sujets du Roi comme il illustre le texte des mandements épiscopaux pris à la demande du gouvernement pour ordonner des prières publiques (Mai 1525) »[xvii].
François 1er, roi de France, JeanClouet 1475-1540 INV3256 Musée du Louvre
La répression s’abattit sur tous ceux qui étaient suspectés d’hérésie à commencer par le cercle de Meaux.
La traduction du Nouveau Testament par Lefèvre fut condamnée au bûcher tandis que Lefèvre, Caroli, Mazurier, Roussel et d’Arande étaient poursuivis par des juges désignés par le Saint-Siège. François 1er demanda par lettre au Parlement, depuis sa prison madrilène, en octobre 1525, de surseoir à la procédure concernant Caroli et Lefèvre, mais le Parlement poursuivit le procès. Lefèvre avait pris la fuite et s’était réfugié à Strasbourg, en terre impériale, depuis le mois d’octobre 1525. Il y resta jusqu’en avril 1526 avec d’Arande et Roussel.
A son retour de captivité, le 17 mars 1526, François 1er réprimanda le Parlement de n’avoir tenu aucun compte de son courrier et il s’employa à faire cesser les poursuites contre Lefèvre qui fut chargé de l’éducation de son fils, âgé de cinq ans, le prince Charles de France, alors à Angoulême.
Le concordat de 1516 donnait au Roi le droit de présenter au Pape les candidats à l’épiscopat. François 1er usa de ce droit en faveur des membres du groupe de Meaux, en 1526 pour Michel d’Arande nommé évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux et en 1536 pour Gérard Roussel appelé à occuper le siège d’Oloron. Mazurier remplaça les deux précédents auprès de Marguerite de Navarre et Vatable devint professeur au Collège Royal.
Le cercle de Meaux était alors officiellement dissout et ses membres revenus dans le giron de l’église ou exilés.
Briçonnet Directeur de conscience de la duchesse d’Alençon
Marguerite d’Alençon, sœur du roi François 1er et épouse du duc d’Alençon, premier prince du sang, avait de multiples interrogations spirituelles comme du reste une grande partie de la population.
Marguerite d’Angoulême Tableau de Jean Clouet Huile sur bois 0,612 x 0,526 Walker Art Gallery à Liverpool
Les scandales à répétition de l’Eglise alimentées par le trafic des indulgences pour financer l’érection de la cathédrale Saint-Pierre de Rome, avaient semé le doute dans les esprits qui aspiraient à des réponses que l’église était impuissante à leur donner.
Les humanistes, en redécouvrant les textes anciens se mirent à les traduire et ils furent stupéfaits des différences qu’ils virent apparaître entre la réalité de ces textes et ceux présentés par l’Eglise depuis des siècles : l’Eglise leur avait-elle menti ?
Dès lors, les humanistes souhaitèrent disposer de traductions exactes, si possible en langues vulgaires, des textes fondamentaux, des évangiles qui devinrent dès lors, en opposition aux constructions théologiques de l’Eglise, des phares de la réflexion spirituelle.
En 1521, les idées de Luther se sont déjà répandues depuis plus de deux ans en France dans l’aristocratie et chez les humanistes. Elles cristallisent le doute chez Marguerite qui est alors en proie à une crise de mysticisme.
Marguerite connaissait Briçonnet depuis longtemps : elle l’avait croisé à plusieurs reprises à la Cour mais elle en avait surtout entendu parler à propos de la réforme entreprise dans son abbaye de Saint-Germain et, depuis 1518, dans son diocèse de Meaux. Par sa mère, Louise de Savoie, elle connaissait Jacques Lefèvre d’Etaples, à qui Louise de Savoie avait demandé en 1517, de développer son idée des trois Madeleines.
Lorsque Guillaume Briçonnet devient son directeur de conscience, en 1521, le contrat est clair : il s’agit pour Briçonnet d’obtenir le soutien de la princesse et, à travers elle, de sa mère, Louise de Savoie et du roi à l’expérience de Réforme du diocèse de Meaux, en contrepartie de réponses aux questions spirituelles de Marguerite.
Cette relation donnera lieu à une volumineuse correspondance, conservée dans les Manuscrits Français 11495 de la BNF et composée de 123 lettres, du 12 juin 1521 au 18 novembre 1524, dont 64 sont de la main de l’évêque et 59 de la duchesse. Les lettres de l’Evêque sont des exposés roboratifs fleuves, de quarante à cent pages, abscons et difficilement compréhensibles. Celles de Marguerite, très courtes, sont plus touchantes car ce sont des questions qu’elle pose. Cette relation aura une influence importante et durable sur l’œuvre écrite de Marguerite, qui en reprendra la plupart des thèmes plus tard.
Dès 1521, Michel d’Arande se trouve placé auprès de Marguerite comme une sorte d’ambassadeur du Cercle de Meaux [xviii]. Il apparaît régulièrement dans les lettres de Briçonnet et de Marguerite. Celle-ci, du reste, lui renvoie Michel d’Arande, en décembre 1521, en lui indiquant que « sa prédication a été appréciée à la cour où le roi et Madame sont plus que jamais affectionnés à la réformation de l’Eglise »[xix].
Au début de 1522, les espérances d’un plus large développement de la Réforme de Meaux sont au plus haut. La France avait été douloureusement blessée de l’élection d’Adrien d’Utrecht, l’ancien confesseur de Charles Quint, à la tiare. Briçonnet se rendit à la cour et il s’employa à convaincre le roi de la nécessité d’une réforme de l’Eglise, de l’intérieur. Il dut être convaincant car un ordre du roi demanda à ce que des conciles soient tenus dans chaque évêché du royaume, à partir du 8 mars 1522 « pour réformer l’Eglise, pour oster beaucoup d’abus et aussi pour pouvoir que, vacants, des bénéfices n’allassent plus hors du royaume de France ».
Adrien VI par Van Scorel au Centraal Museum d’Utrecht
Mais, à partir de la mi-1522, l’intérêt de la couronne pour la doctrine de l’évangélisme et la réforme de l’intérieur de l’Eglise, faiblit. D’abord le Pape avait adressé à François 1er les engagements exprès de neutralité dans les affaires de l’Empire et de la France et les relations avec Rome se réchauffèrent considérablement.
Marguerite d’Alençon qui adressa également un message amical au Pape, réduit alors au minimum ses relations avec Briçonnet. Puis, Lefèvre publie, avec l’autorisation du roi, ses « Commentaires sur les quatre évangiles ». Mais « quand Briçonnet présenta au roi un exemplaire de l’œuvre avec une lettre proposant des réformes, il n’obtint rien malgré les tentatives de Marguerite pour le soutenir ».
L’intérêt pour la réforme de Meaux resta poli à la Cour, tout le reste de l’année 1522, malgré la présence de Michel d’Arande, invité à expliquer l’Evangile à Marguerite et à sa mère dans leurs appartements.
Portrait de Louise de Savoie, mère de François 1er Anonyme Sanguine pierre noire H. 0,290 ; L. 0,205 Paris N° d’inventaire INV 33461, recto Crédit photo © Réunion des musées nationaux musée du Louvre département des Arts graphiques
En novembre 1522, le frère dominicain Guillaume Petit, confesseur du roi, se plaignit, lors d’une conférence à huis clos de la faculté de théologie de la Sorbonne, de l’influence d’Arande : il le dénonça comme « prêchant contre la vénération envers les saints, comme louant Luther et excusant ses erreurs ».
A partir de cette date, les exigences de la politique internationale prirent le dessus sur la volonté de réforme de l’Eglise et le roi François 1er se désintéressa de l’expérience évangéliste de Meaux, tout en continuant à exercer sa protection sur ses membres, à titre individuel.
_______________________________________
[i]Le terme de réseau a été utilisé pour la première fois par Jonathan Reid pour sa thèse sur « Marguerite de Navarre et son réseau évangéliste » cité dans « L’épithète et la connivence: écriture concertée chez les évangéliques » par Isabelle Garnier-Mathez.
[ii]Les évangiles étaient écrits en latin, langue du clergé et des juristes. La traduction en français était d’abord destinée à faire du prosélytisme, en rendant compréhensibles à tous les textes sacrés.
[iii]Voir l’article sur Semblançay sur ce même site
[iv]Article de Robert-Henri Bautier. « Guillaume Briçonnet, évêque de Meaux, et la haute administration du royaume ». In: Journal des savants.1987, N°1-2. pp. 79-88. doi : 10.3406/jds.1987.1503. Consulter également les articles sur Semblançay, l’oncle de Briçonnet, dans ce Blog.
[v]Article de Michel Péronnet. « Michel Veissière, L’évêque Guillaume Briçonnet (1479-1534) ». In: Bulletin de l’Association d’étude sur l’humanisme, la réforme et la renaissance. N°23, 1986. pp. 72-78.
[vi] Essai Sur La Vie Et Les Ecrits De Jacques Lefevre d’Etaples. Par Collectif
[vii]Les moines réguliers suivent la règle d’un Ordre monastique. Ils s’opposent aux moines séculiers, qui vivent dans le siècle. Le clergé régulier comprenait notamment les Bénédictins, les Chartreux, les Capucins, les Franciscains et les Cordeliers, les Génovéfains, les Minimes, etc… Le clergé séculier lui comprend toute la hiérarchie cléricale depuis les prêtres en paroisses jusqu’aux cardinaux.
[viii] Article de Michel.Péronnet sur PERSEE : « Michel Veissière, L’évêque Guillaume Briçonnet (1479-1534) ». In: Bulletin de l’Association d’étude sur l’humanisme, la réforme et la renaissance. N°23, 1986. pp. 72-78.
[ix] Selon la thèse de Charles-Henri Graf soutenue en 1842 auprès de la Faculté de théologie protestante de Strasbourg, « Essai sur la vie et les écrits de Jacques Lefèvre d’Etaples ».
[x] « Essai sur la vie et les écrits de Jacques Lefèvre d’Etaples » déjà cité.
[xi] Essai … Dejà cité.
[xii]Vulgate : traduction latine de la Bible par Saint-Jérôme.
[xiii]Voir la bio succincte de Noël Beda, ce personnage de roman sur le site
[xiv] Dans sa thèse sur le « Rôle de Jacques Lefèvre d’Etaples à l’origine de la Réformation française ».
[xv] Histoire de la Réformation Française F.Puaux.
[xvi]Michel Péronnet Article Persée déjà cité.
[xvii] Article de Michel Péronnet. « Michel Veissière, L’évêque Guillaume Briçonnet (1479-1534) ». In: Bulletin de l’Association d’étude sur l’humanisme, la réforme et la renaissance. N°23, 1986. pp. 72-78.
[xviii] Correspondance (1521-1524) Par Guillaume Briçonnet, Marguerite d’Angoulême Droz
[xix]Correspondance de Briçonnet et de Marguerite. Les développements qui suivent sont inspirés de cet ouvrage.





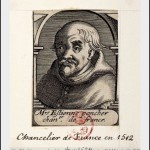






[…] un chrétien : il n’imagine même pas que ses écrits pourraient le faire taxer de paganisme. Lefèvre d’Etaples (voir l’article sur ce Blog) l’appelait « mon père » et Erasme connaissait […]